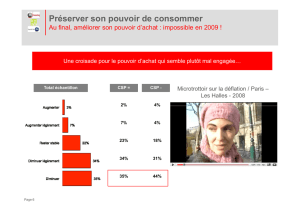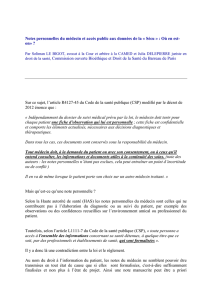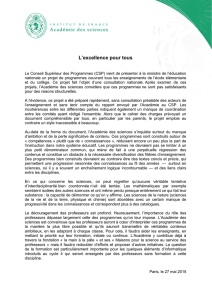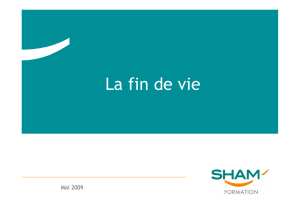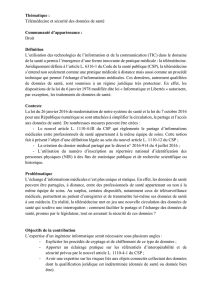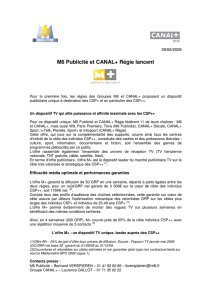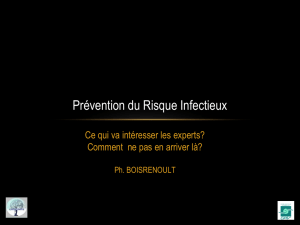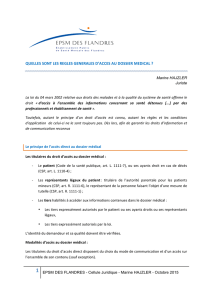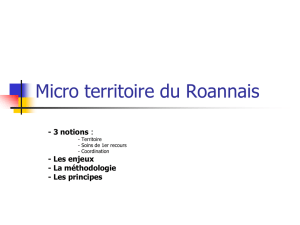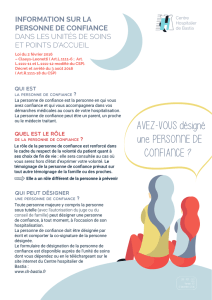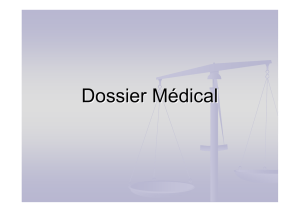Le patient-usager, acte ur de sa san

Juridique Analyse
52 - LA GAZETTE SANTÉ-SOCIAL N° 74 - Mai 2011
L’ESSENTIEL
n Jurisprudence avant-gardiste
Le patient « dominé » par la science du médecin doit aux juges sa reconnaissance
en tant qu’individu ayant droit au respect et à la prise en compte de sa dignité.
Le fil rouge de la protection des personnes guide les décisions judiciaires.
n Panoplie de droits
Les droits tels qu’ils découlent de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen sont repris dans les lois relatives à la santé, et complétés (information
claire et loyale, codécision et anticipation des volontés, accès au dossier médical,
réclamation et dédommagement).
n Démocratie sanitaire
Les usagers se regroupent au sein d’associations pour supporter la maladie, sen-
sibiliser les citoyens et agir sur les pouvoirs publics. Leurs représentants assistent
à de nombreuses réunions et les structures s’investissent, mais leurs moyens,
notamment financiers, restent insuffisants pour faire vivre la démocratie sanitaire.
Le patient-usager, acte ur de sa santé
L’usager au sens de la définition du dic-
tionnaire Larousse, c’est-à-dire « la
personne qui utilise un service, en par-
ticulier un service public », ou le détenteur de
droits tel qu’envisagé par la jurisprudence (lire
La Gazette Santé-Social n° 73, p. 42) bouscule l’ac-
ception de la personne malade obligée de se soi-
gner et le rapport déséquilibré entre le « soignant
sachant » et le « soigné patient ». D’autant que
l’usager du système de soins présente la particu-
larité d’être triple : utilisateur occasionnel, ma-
lade potentiel et contributeur permanent au sys-
tème de soins, catégories auxquelles il convient
d’ajouter la famille et les proches.
De l’objet au sujet
L’usager du système de soins est l’œuvre de la ju-
risprudence avant d’être celle de la loi. Dès 1942,
la Cour de cassation (8 janvier 1942, « Teyssier »)
en amorce la construction, en exigeant qu’un
chirurgien obtienne l’accord du patient avant
de procéder à une opération. Elle affirme ainsi
que le respect dû à la personne humaine et les
droits du malade priment l’activité médicale.
Après 1945, le passage de l’hôpital « asile » pour
les plus pauvres au producteur de soins pour tous
– malades, objets de soins – marque un tour-
nant. Cette transformation sociétale se poursuit
au niveau légal, avec le décret du 14 janvier 1974
(n° 74-27) sur le fonctionnement des centres hos-
pitaliers et des hôpitaux locaux. La circulaire du
20 septembre 1974 prise en application du texte
traduit cette évolution vers la reconnaissance du
statut d’usager du système sanitaire, avec la pre-
mière charte du malade hospitalisé. Celui-ci, dé-
sormais perçu comme un sujet de soins, dispose
de droits attachés à sa personne.
Dans les années 80-90, l’apparition des premiers
cas de VIH, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, l’af-
faire du sang contaminé ou celle de l’amiante dé-
clenchent un mouvement qui aboutira à doter le
patient du droit de participer à toute décision le
concernant et à donner la parole à l’usager dans
le cadre des décisions de santé publique.
Alors que les juges avaient déjà reconnu les droits
des malades en balisant le devoir d’informa-
tion du médecin (Cass. 1re civ., 17 février 1998,
n° 95- 21715), par exemple pour mettre en œuvre
sa responsabilité (Cass. 1re civ., 7 octobre 1998,
n° 97-10267, et 9 octobre 2001, n° 00-14564), la
loi du 4 mars 2002 consacre la remise en cause
des schémas traditionnels du monde sanitaire.
Le texte assoit le principe du patient acteur de
sa santé, au cœur du système, et pose les fonde-
ments d’une démocratie sanitaire. Tout d’abord,
dans ses relations avec les professionnels, l’usa-
ger du système de santé en établissement, public
ou privé, en ambulatoire ou à domicile, dispose
du droit de décider de sa prise en charge médi-
cale. Ensuite, il obtient le droit de demander des
comptes sur le traitement et les actes médicaux
dont il bénéficie. Enfin, par le biais des associa-
tions et de leurs représentants, il peut s’exprimer
à tous les niveaux de la politique de santé.
Les droits consentis, individuels et collectifs,
s’exercent sans contrepartie. La reconnaissance
des prérogatives de l’usager ne s’accompagne
d’aucun devoir, à l’exception de celui de res-
pecter ses interlocuteurs ou de ceux liés à la vie
en collectivité, comme ne pas troubler le repos
des autres malades ou respecter le règlement
intérieur. Toutefois, la loi rend l’usager respon-
sable du système de santé, de sa pérennité et de
ses principes (art. L.1111-1 du Code de la santé
publique, CSP).
Droits individuels
Droits de la personne
L’usager du système de santé dispose avant tout
de droits de la personne et du droit à l’égalité
devant le service public. Le patient ne peut pas
être discriminé à l’admission dans un hôpital
ou un établissement de santé privé ou public
(art. L.1110-3 du CSP) et doit recevoir les soins
requis par son état de santé (art. L.1110-5 du
CSP). A cet égard, la charte du patient hospita-
lisé de 1995, revue en 2006, et la loi « HPST » du
21 juillet 2009 rappellent les missions de service
public incombant aux établissements de santé,
quant à la permanence et à l’égal accès aux soins
de qualité (art. L.1110-1, L.6112-3 du CSP), quel
que soit l’état de santé, le handicap, l’origine, le
sexe, la situation de famille, les opinions poli-
tiques, la religion, la race ou les caractéristiques
génétiques de l’intéressé. En découlent le droit
de suivre une scolarité (art. L.1110-6 du CSP), la
liberté de choisir son établissement et son pra-
ticien (art. L.1110-8 du CSP) et, à l’hôpital pu-
blic, celui de pratiquer son culte (art. R.1112-46
du CSP).
En tant que personne, le malade a droit au respect
de sa dignité (art. L.1110-2 du CSP), un principe
posé par le Conseil constitutionnel, dès 1994. Sa
douleur doit être « prévenue, prise en compte et
traitée » (art. L.1110-5 al.4 du CSP), et des soins
palliatifs lui être prodigués (art. L.1110-5 al.5 du
CSP). Sa vie privée et son intimité doivent être
respectées (art. L.1110-4 du CSP). La confiden-
tialité due à l’usager est assurée par l’obligation
faite aux professionnels de santé de respecter le
secret professionnel (lire La Gazette Santé- Social
n° 71, p. 45). L’intéressé peut, par exemple, exiger
qu’aucune information concernant son hospitali-
sation ou son état de santé ne soit communiquée
(art. L.1110-4 et R.1112-45 du CSP), et recevoir
ou refuser des visites (art. R.1112-47 du CSP).
Principe de codécision
Corollaire du respect de la dignité, le malade
doit être considéré comme un interlocuteur va-
lable, capable de partager une information et de
prendre une décision. Aussi doit-il être informé
de façon claire et loyale sur son état de santé

N° 74 - Mai 2011 LA GAZETTE SANTÉ-SOCIAL - 53
>>
Le patient-usager, acte ur de sa santé
(art. L.1111-2 du CSP), le coût des soins, le prix
et le remboursement des actes en lien avec sa
maladie (art. L.1111-3, R.1111-21 à R.1111- 25
du CSP). Le droit à l’information porte sur le
diagnostic et sa vérification, notamment par
des examens complémentaires, la description
des traitements à entreprendre (urgence, utilité,
risques, suites) et les conséquences d’un refus de
se faire soigner. Le malade peut ainsi exercer son
choix en connaissance de cause, selon le principe
de codécision (art. L.1111-4 du CSP). Confor-
mément à une jurisprudence antérieure à la loi
(Cass. 1re civ., 25 février 1997, n° 94-19685), il in-
combe au professionnel de montrer « par tous
moyens » (Cass. 1re civ., 14 octobre 1997, n° 95-
19609) qu’il a respecté son devoir d’informa-
tion. La loi du 4 mars 2002 exige un entretien
individuel (art. L.1111-2 du CSP) et ne condi-
tionne pas la preuve de l’information à la signa-
ture d’un écrit.
Le droit à l’information est personnel, et un mi-
neur peut refuser que ses parents soient informés
de son état de santé (art. L.1111-5 du CSP). Tou-
tefois, la famille, les proches ou la personne de
confiance peuvent être informés d’un diagnostic
grave, afin qu’ils puissent apporter un soutien di-
rect au malade, sauf opposition de la part de ce-
lui-ci (art. L.1110-4 du CSP). Seul un médecin
responsable ou un membre du corps médical de
l’établissement peut délivrer cette information
(art. R.1112-1 du CSP).
Accès au dossier
Le droit de l’usager à être informé emporte le
droit à l’accès à son dossier, quel que soit le pro-
fessionnel de santé (public, privé, libéral, salarié)
et sa spécialité. L’intéressé peut demander à ac-
céder à tous les fichiers, les examens, les comptes
rendus de consultation, d’intervention, d’ex-
ploration ou d’hospitalisation, à tous les pro-
tocoles et les prescriptions thérapeutiques, les
feuilles de surveillance, les correspondances entre
professionnels, etc. Pour un mineur, les parents,
séparés ou non, exercent ce droit conjointement,
ou le parent qui détient l’autorité parentale (lire
La Gazette Santé-Social n° 62, p. 45). Passé un dé-
lai de réflexion de quarante-huit heures, la de-
mande de l’usager est satisfaite dans les huit jours,
ou dans les deux mois pour les informations da-
tant de plus de cinq ans. Cette transmission est
gratuite, à l’exception des coûts de photocopies et
d’affranchissement. L’usager peut se faire accom-
pagner pour consulter son dossier (art. L.1111-7
et L.1112-1 du CSP).
L’obtention du dossier médical peut permettre
à l’usager d’exercer son droit à solliciter un se-
cond avis avant décision. Après le décès du pa-
tient, le droit à l’information peut être exercé par
la famille (art. L.1110-4 al. 7, L.1111-7 du CSP).
Directives anticipées
Si le patient, acteur de sa santé, consent aux soins
qui lui sont prodigués, il peut également se trou-
ver dans l’impossibilité de s’exprimer. Il dispose
de deux moyens pour pallier cet état de fait. En
premier lieu, il peut formuler des directives anti-
cipées (art. L.1111-11 du CSP), c’est-à-dire indi-
quer dans un écrit daté et signé (art. R.1111- 17
du CSP) ses souhaits concernant les conditions
de sa fin de vie. Ces directives sont révocables
à tout moment et doivent avoir été rédigées
moins de trois ans avant l’état d’inconscience
(art. R.1111- 18 du CSP).
En second lieu, lors de l’admission à l’hôpital, le
patient peut désigner une personne de confiance
(art. L.1111-6 du CSP). Cette désignation inter-
vient pour la durée de l’hospitalisation ou de fa-
çon illimitée. Elle est révocable à tout moment.
L’usager doit être informé de cette possibilité et
obligatoirement choisir une personne, majeure
capable, qui accepte ce rôle. Celle-ci l’accom-
pagne dans toutes ses démarches à l’hôpital et
lors des entretiens médicaux. Elle est consultée
en cas d’impossibilité pour l’usager d’exprimer
sa volonté (art. L.1111-4 al 4 et L.1111-13 al.1
du CSP). Son avis prévaut sur celui des proches
(art. L.1111-12 du CSP).
Plaintes et réclamations
Disposer de droits suppose de les faire respecter et
d’être dédommagé en cas de préjudice. L’usager
peut se plaindre au cadre de santé du service dans
lequel il a séjourné ou à la direction des usagers
et de la clientèle. Ses plaintes et ses réclamations
sont examinées par la commission des relations
BURGER / PHANIE
Lors de son admission à l’hôpital, le patient peut désigner une personne de confiance,
majeure capable, qui l’accompagnera dans toutes ses démarches.
DÉJÀ PUBLIÉ
Au mois d’avril : l’usager,
citoyen au centre
de l’action sociale

Juridique Analyse
54 - LA GAZETTE SANTÉ-SOCIAL N° 74 - Mai 2011
>> avec les usagers et de la qualité de la prise en
charge (CRUQPC) [lire aussi p. 57]. Chargée de
veiller au respect des droits des usagers, celle-ci
émet des recommandations pour résoudre le li-
tige et informer le patient des voies de concilia-
tion ou de recours possibles (art. L.1112- 3 du
CSP). L’usager qui s’estime victime peut égale-
ment saisir le médiateur, médical ou non, le re-
présentant des usagers (art. L.1114-1 du CSP),
voire le tribunal.
Droits collectifs
Représentation des usagers
Les associations de malades et d’usagers du sys-
tème de santé montrent le volontarisme des pa-
tients à se placer en acteurs de leur santé. En 2008,
14 000 seraient recensées et compteraient 4 mil-
lions d’adhérents, selon l’Annuaire des associa-
tions de santé. Ces structures aident et soutien-
nent au quotidien les malades et leurs familles,
et défendent les droits des malades et des usa-
gers du système de santé. Par des actions d’in-
formation ou des brochures qu’elles diffusent,
elles interviennent également dans le champ de
la prévention.
Pour faire vivre la démocratie sanitaire et contri-
buer à la définition des politiques au niveau ré-
gional, la loi du 4 mars 2002 prévoit la participa-
tion des usagers au fonctionnement du système
de santé. Elle leur reconnaît des droits collectifs
par l’intermédiaire d’associations agréées exer-
çant une activité dans le domaine de la qualité
de la santé et de la prise en charge des malades
(art. L.1114-1 du CSP).
Sur proposition de ces associations, des repré-
sentants des usagers sont désignés pour siéger
à certaines instances de santé publique ou hos-
pitalières, au niveau national, par le ministre
de la Santé, et au niveau régional, par le direc-
teur de l’agence régionale de santé (ARS) [art.
R.1114- 9 du CSP]. Ces personnes sont présentes,
par exemple, dans les CRUQPC (art. R.1112-
81 du CSP), les comités de lutte contre les in-
fections nosocomiales (Clin) [art. L.1142-6 du
CSP], les conférences régionales de la santé et
de l’autonomie (CRSA) [art. L.1432- 4 CSP], les
commissions régionales de conciliation et d’in-
demnisation des accidents médicaux, des affec-
tions iatrogènes et des infections nosocomiales
(CRCI) [art. L.1114-4 du CSP] et la Commis-
sion nationale des accidents médicaux (Cnamed)
[art. L.1142-10 du CSP].
Lorsqu’il siège au sein de l’une de ces instances, le
représentant des usagers du système de santé béné-
ficie d’un congé de représentation (art. L.1114- 3
du CSP et L.3142-51 du Code du travail, CT)
limité à neuf jours par an, fractionnable en de-
mi-journées (art. L.3142-53 du CT). En cas de
perte de salaire, il perçoit des établissements de
santé concernés ou de l’Etat une indemnité de
7,10 euros par heure (art. L.3142-52 du CT).
De la présence
sans participation
En créant la Commission nationale d’agrément
des associations et en attribuant de nouvelles mis-
sions à la Conférence nationale de santé (CNS),
promue lieu de concertation sur les orientations
des politiques de santé, la loi du 9 août 2004 a
engagé la participation des usagers à la défini-
tion des politiques. La loi « HPST » du 21 juillet
2009 poursuit ce mouvement. Au niveau local,
elle instaure des instances de démocratie sani-
taire, les CRSA, dont les représentants doivent
siéger à la Conférence nationale de santé et dont
les rapports sur le respect des droits des usagers
doivent constituer la base du rapport annuel de
la CNS. Elle prévoit la nomination, par le préfet,
de deux représentants des usagers sur les quinze
membres du conseil de surveillance de l’établis-
sement de santé public ou privé (art. L.6143-5 du
CSP), établit une commission médicale d’établis-
sement chargée de l’amélioration de la qualité et
de la sécurité des soins et rend obligatoire la pu-
blication d’indicateurs de qualité (art. L.6144-1
du CSP). Elle confie à la conférence médicale des
établissements de santé privés l’élaboration de
la politique d’amélioration de la qualité et de la
s écurité des soins, d’accueil et de prise en charge
des usagers (art. L.6161-2 du CSP).
Mais, deux ans après la promulgation de la loi,
60 % des décrets d’application du titre II (accès
de tous à des soins de qualité) restent en suspens,
par exemple pour interdire les discriminations.
Et 46 % des textes prévus au titre III (prévention
et santé publique) manquent, notamment sur la
fondation à l’éducation à la santé (art. L.1171-1
du CSP). Les membres de la CNS n’ont pas été re-
nouvelés depuis la fin de l’année 2010, et un pro-
jet de décret relatif à la CNS prévoit la diminution
du nombre de représentants des usagers. Dans
son rapport d’activité 2006-2010, la Conférence
nationale de santé déplore le manque d’informa-
tions sur les suites données à ses recommanda-
tions et la faiblesse des crédits octroyés aux ins-
tances de démocratie sanitaire. Les associations
d’usagers du système de santé ne sont pas finan-
cées. Les représentants des usagers ne siègent pas
dans toutes les instances. Enfin, l’information est
délivrée au compte-goutte au malade.
Recommandations
L’usager du système sanitaire existe-t-il vrai-
ment ? On peut en douter. Malgré des dis-
positions – certaines étant en vigueur depuis
dix ans –, 70 % des Français déclarent avoir le
sentiment de ne pas savoir quels sont leurs droits
à ce titre, selon un sondage BVA du 31 septembre
2010. Le rapport remis au ministre de la Santé le
24 février 2011 sur le bilan et les propositions de
réformes de la loi du 4 mars 2002 va dans ce sens.
Les auteurs soulignent « que le mouvement initié
en 2002 peine à se mettre en place et qu’il faut ra-
pidement corriger certains aspects de la loi ». Ils
recommandent, notamment, pour « pérenniser
et renforcer une démocratie sanitaire encore bal-
butiante », d’« initier l’éducation de la population
aux politiques de santé » et d’« améliorer l’effecti-
vité de la représentation citoyenne de notre sys-
tème ». Autres préconisations : rendre les droits
individuels plus opérationnels et plus visibles, et
donner des moyens financiers aux associations et
aux représentants des usagers. n Nathalie Levray
2011, ANNÉE DES PATIENTS ET DE LEURS DROITS
La charte européenne des droits des patients, établie en 2002 par le Réseau actif de citoyen-
neté, reconnaît quatorze droits aux malades, dont ceux à être soigné de façon personnalisée,
à réclamer, à être dédommagé, ou encore le droit au respect du temps des patients. En 2006,
le 18 avril a été proclamé Journée européenne des droits des patients. Une initiative que la
France promeut à son tour, tout au long de 2011, avec l’Année des patients et de leurs droits.
A cette occasion, un rapport sur les nouvelles attentes du citoyen en matière de santé a été
publié (*). Y sont présentées des pistes pour « développer une démocratie sanitaire effective
et efficace ». Parmi elles, la reconnaissance de l’expertise des patients, le suivi personnalisé
et le parcours de soins pour les malades chroniques, l’instauration de médiateurs intercultu-
rels de santé pour les personnes les plus fragiles, le financement des associations de patients
ou une implication des usagers favorisée.
(*) Rapport de la mission « nouvelles attentes du citoyen, acteur de santé », Nicolas Brun, Emmanuel Hirsch,
Joëlle Kivits, janvier 2011,
REPÈRES
w Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme
de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires.
w Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la poli-
tique de santé publique.
w Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits
des malades et à la qualité du système de santé.
w Décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux
règles de fonctionnement des centres hospitaliers
et des hôpitaux locaux.
w Circulaire DHOS / E1 / DGS / SD1B / SD1C / SD4A
n° 2006-90 du 2 mars 2006 relative aux droits des
personnes hospitalisées et comportant une charte
de la personne hospitalisée.
w Circulaire GDS / DH n° 95-22 du 6 mai 1995 relative
aux droits des patients hospitalisés et comportant
la charte du patient hospitalisé.
w Décision n° 94-343 / 344 DC du Conseil constitution-
nel du 27 juillet 1994.
1
/
3
100%