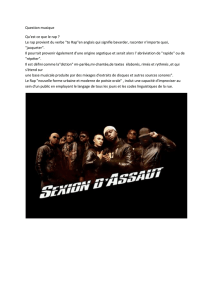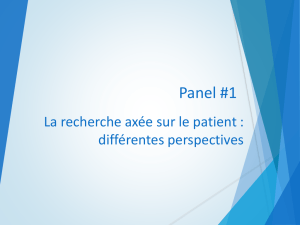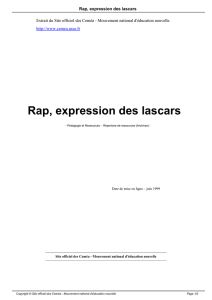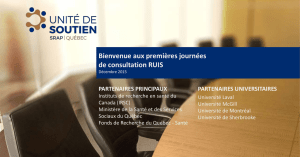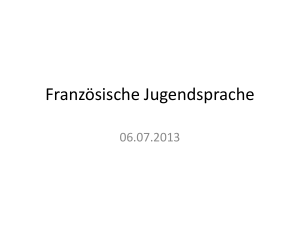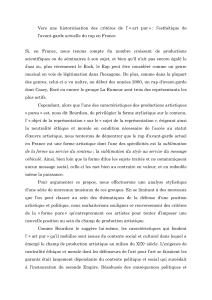Le rap à Libreville: aspects sociolinguistiques L`objectif de cet article

Education et Sociétés Plurilingues n°13-décembre 2002
Le rap à Libreville: aspects sociolinguistiques
Michelle AUZANNEAU
L'articolo che segue tratta della canzone rap a Libreville, e presenta questa forma di
espressione urbana come spazio di circolazione e produzione di modelli socio-culturali e
sociolinguistici. La scelta dei codici linguistici da utilizzare in tale contesto, fatta in
funzione dei contesti comunicativi presentati nelle canzoni, per certi versi rivela e influenza
le pratiche linguistiche, la differenziazione e le motivazioni della differenziazione della
gioventù di Libreville.
Discussing rap songs in Libreville (Gabon, Africa), this article presents this sort of city
music as a space where socio-cultural and socio-linguistic models circulate and are
produced and circulate. It attempts to show that the choice of languages or of their varieties
according to the type of communication represented in the songs reveals and to some extent
influences the way the young, urban Librevillians speak, their various speaking styles and
the motivations for such variety.
L’objectif de cet article est de présenter quelques caractéristiques
sociolinguistiques de la chanson rap librevilloise. Celles-ci sont tirées d’une
recherche plus large portant sur le rap à Libreville, à Dakar (Sénégal), à Saint-
Louis (Sénégal) et en région parisienne (France), réalisée en partie
collectivement à la croisée de différentes disciplines de la linguistique par le
GRAFEC, groupe informel travaillant sur la chanson rap dans une perspective
linguistique pluridisciplinaire (1).
L'urbanisation africaine
L’urbanisation croissante en Afrique depuis une quarantaine d’années (Agier,
1999) implique de nouvelles formes d’organisations sociales, distinctes de
celles de la société traditionnelle, de nouveaux modes de vie, de pensée, de
nouveaux comportements socio-culturels. Libreville, l’un des trois centres
urbains principaux du Gabon, a connu dans les années soixante-dix des
bouleversements considérables sur les plans physique, économique,
démographique et sociaux, liés à son développement rapide aux lendemains
de la décolonisation. Repoussant ses frontières géographiques, la ville
connaissait notamment l’immigration en provenance des zones rurales du pays
et d’autres pays (notamment d'Afrique Centrale et d'Afrique de l’Ouest),
l’expansion de zones d’habitat informel et précaire, une nouvelle organisation
des individus au sein de "familles symboliques" (Agier, 1999: 35; Auzanneau,
2001b), se définissant sur la base de solidarités sociales diverses (celles du
quartiers, de groupes d’activités, etc.) et remplaçant la famille élargie basée

M. Auzanneau, Le rap à Libreville: aspects sociolinguistiques
54
sur le lignage. La ville a connu ainsi une complexification des relations
sociales au sein de réseaux de communication se diversifiant et s’élargissant
sur le plan national et international. En 1993, au dernier recensement,
Libreville concentrait 41% de la population gabonaise et elle comptait parmi
ses habitants 22,3% de migrants, originaires notamment d'Afrique de l'Ouest
et d'Afrique Centrale.
Comme toute ville, Libreville agit sur les comportements de ses habitants, à la
fois dans le sens de l’uniformisation et de la différenciation. Pluriculturelle,
pluriethnique et plurilingue, elle leur offre de multiples possibilités de
manifester, dans l'interaction, leur appartenance à la ville (de se comporter
comme des citadins), mais aussi de montrer leur intégration à certains des
groupes sociaux dont elles est constituée (quartier, ethnie, génération, groupe
d'activité, etc.), et ce, successivement ou simultanément.
Le rap
Les membres du mouvement "rap" constituent une famille symbolique
privilégiée pour une bonne partie de la jeunesse librevilloise et plus largement
africaine. Le rap est porteur de ses propres idéologies, de ses propres modèles
comportementaux. Le rap africain, né à la fin des années quatre-vingt,
revendique sa filiation américaine et s’inspire des modèles occidentaux mais il
s’inscrit dans les réalités sociales et culturelles du pays et plus encore de la
ville dans laquelle les groupes évoluent. Comme d’autres formes d’expression
urbaine, il porte ainsi la triple empreinte des modèles culturels provenant de
l’extérieur, de ceux provenant de la société africaine et en particulier de ceux
provenant de la société urbaine, modèles toujours en gestation, en transition et
en négociation, comme le sont les identités plurielles et variables offertes par
la ville encore récente. Le rap intéresse le linguiste, l’anthropologue ou le
sociologue, parce qu’il exploite et exprime des pratiques et des modèles socio-
culturels et sociolinguistiques, dont il est un lieu de circulation,
d’appropriation mais aussi de gestation.
En Afrique, comme en France, bien que dans des contextes socio-
économiques différents, le rap apparaît ainsi lié aux questions de la recherche
et de la construction des cultures par de jeunes citadins, qui marquent de façon
symbolique l’usage des langues sous leurs différentes formes, notamment sous
leurs formes métissées.
L'enquête de terrain et le profil des rappeurs

M. Auzanneau, Le rap à Libreville: aspects sociolinguistiques
55
A Libreville, l'enquête de terrain a été principalement réalisée auprès de dix
groupes de rap. De façon à limiter l'influence exercée sur les choix
linguistiques par les stratégies commerciales des auteurs ou de leurs
producteurs, elle a porté sur des groupes qui bénéficiaient tout au plus d’une
audience nationale. De ce fait, la majorité des 81 chansons recueillies auprès
des dix groupes n’avaient pas donné lieu à la production d’un album
commercialisé, ni n'avaient été enregistrées par l’organisme de la protection
des droits d’auteurs. Les rappeurs solo ou les membres des groupes ayant
participé à cette recherche sont essentiellement des garçons (parmi les 42
rappeurs des ces groupes, trois sont des filles dont deux solos). Au moment du
recueil des données, en 1999, ils étaient âgés de 17 à 28 ans et sont entrés dans
le mouvement rap entre 12 et 21 ans. Ils avaient été ou étaient alors scolarisés
dans le secondaire et, pour quelques uns d'entre-eux, dans le supérieur. Ils
résident à Libreville et, pour la plupart, y sont nés.
Les langues parlées par les rappeurs
Dans leurs chansons, ils emploient, en dehors du français, quatre langues
gabonaises - pour faciliter la présentation, je n'incluerai dans cette catégorie ni
le français ni les langues de migration, bien qu'elles puissent être parfois
considérées par leurs locuteurs comme telles - sur la quarantaine présentes à
Libreville, à savoir le fang, le téké, le punu et le nzébi. Dans le cadre de leur
communication quotidienne, ils parlent généralement une à deux langues, le
français seul ou le français et une langue gabonaise, ou encore le français et
une langue de migration. Les langues parlées par cette population connaissent
des variations liées à l'appartenance sociale des locuteurs, à leur origine
géographique, au registre de langue qu'ils emploient ou encore aux
changements linguistiques qui se produisent avec le temps. Ces variations sont
particulièrement notables concernant le français (cf. Ploog, 2001). Cette
langue, qui se présente donc sous des formes plus ou moins standard, est
soumise à deux types de d'influences: celle exercée par la norme du français
de France ("norme exogène"), celle exercée par des normes produites
localement ("normes endogènes"), du fait du contact de langues et de
l'adaptation du français aux réalités socio-culturelles gabonaises. L'influence
des normes endogènes donne lieu à des formes de français particulières,
constituant le français dit "de Libreville" et relevant essentiellement du niveau
lexical. Les unités lexicales de ce français correspondent à diverses
transformations sémantiques et/ou formelles des unités du français, à des
emprunts à différentes langues (anglais, langues africaines, parfois espagnol) -
emprunts pouvant eux-mêmes avoir subi des transformations - ou à des
néologismes. Elles sont importées de France ou produites localement. Ce

M. Auzanneau, Le rap à Libreville: aspects sociolinguistiques
56
"français de Libreville" se présente sous des formes variables, dans la mesure
où la part des unités provenant de ces différents processus de re-lexification
varie selon l'identité sociale des sujets et les circonstances des interactions
(plus ou moins d'emprunts, de néologismes, de transformations, etc.).
Le français, sous sa forme standard, est la seule langue officielle du Gabon et
la seule langue servant à la communication interethnique urbaine. Les langues
gabonaises, de même que les formes re-lexifiées du français, occupent une
fonction vernaculaire. Aux fonctions et au statut social des langues mais aussi
à leur histoire au regard de la situation sociolinguistique du pays, sont
associées des valeurs sociales et symboliques. Ces valeurs ambivalentes sont
latentes et s'actualisent lors des interactions. Ainsi, le français peut-être
considéré comme une langue de culture, de pouvoir, l'une des langues de la
modernité, du développement socio-économique, la langue de la scolarisation,
mais aussi comme la langue de l'acculturation, de la colonisation et de
l'exploitation économique. Les langues gabonaises, considérées comme le
véhicule des valeurs traditionnelles, symbolisent l'identité gabonaise et plus
largement africaine, et l'authenticité, mais aussi l'archaïsme et l'arriération. Le
français relexifié, qui assure des fonctions grégaire, ludique et parfois
cryptique, supporte des valeurs identitaires et est considéré par les jeunes
comme le véhicule des valeurs auxquelles ils adhèrent et de la mixité de leur
identité.
Les langues dans la chanson rap
La chanson rap illustre cette variation des formes des langues et des choix qui
sont faits par les locuteurs. Les choix linguistiques des auteurs sont
interprétables par rapport à ces valeurs et fonctions des langues et par rapport
uax situations présentées dans la chanson. Les facteurs déterminants de ces
choix sont semblables à ceux qui interviennent dans la communication
quotidienne (sujet de conversation, lieu, relation des interlocuteurs, but, etc.).
Cependant, les choix linguistiques dans la chanson se distinguent de ceux que
font les locuteurs au cours de leur communication quotidienne en ce que,
relevant d'une création artistique, ils sont effectués, lors du travail de
composition, de façon plus consciente, relativement aux situations et aux
sociotypes mis en scènes de façon discursive et des buts recherchés (cf.
Auzanneau, 1999; Auzanneau et al., à paraître). Les "sociotypes" sont des
personnages sociaux récurrents, dotés de caractéristiques positives ou
négatives, qui traversent les répertoires des groupes locaux et sont construits
en partie par les chansons en référence aux réalités sociales vécues et aux
idéologies du groupe.

M. Auzanneau, Le rap à Libreville: aspects sociolinguistiques
57
Le sociotype principal est "le rappeur". Il s'agit d'un membre du groupe ou de
celui d’un autre groupe. Le rappeur membre du groupe est toujours présenté
positivement, ce qui n'est pas le cas pour les membres des autres groupes. Il
est montré comme doté d’un vécu, d’un savoir et d’un art, le rap lui permettant
de contester la gestion socio-politique du pays, de condamner certains
comportements sociaux et de dénoncer avec lucidité la misère sociale. Il
combat par les mots, et s’impose comme porte-parole des groupes sociaux
qu’il représente. Son art lui permet aussi de divertir en traitant des activités
propres au monde des jeunes, des relations que ceux-ci entretiennent et
notamment des relations amoureuses. Le ton est alors plus ou moins celui de
la satire sociale. Et même lorsque ses performances verbales et musicales ne
sont pas le centre de son propos, il fait toujours référence à ses propres
qualités. Selon les groupes se réclamant du mouvement hardcore, le
divertissement dans la chanson rap doit cependant être exploité avec mesure,
lorsqu’il n’est pas purement et simplement rejeté, sous peine de ne plus
remplir la mission principale du rap définie sur le plan social. Obéir à cette
mission ou se préoccuper davantage de faire danser les foules, sont des
objectifs qui, selon ces groupes, distinguent le "vrai rappeur" du "faux
rappeur". Les faux rappeurs sont toujours des membres extérieurs au groupe,
et même si des solidarités entre groupes «de la place» sont manifestées, les
auteurs d’une chanson se positionnent souvent, même indirectement, dans une
position de supériorité par rapport aux membres de tout autre groupe.
Ainsi, la chanson doit-elle non seulement combattre le sociotype du faux
rappeur, pour son intrusion sur la scène rap, mais aussi, notamment, le
sociotype de l’homme politique de tout bord, et généralement tout
représentant de l’Etat, pour sa mauvaise gestion du pays et sa corruption. Elle
doit combattre aussi le sociotype du blanc, considéré comme le colonisateur,
l’exploiteur économique du pays, le responsable des phénomènes
d’acculturation, ainsi que le sociotype du membre de groupes sociaux divers
(la société gabonaise ou librevilloise, le quartier, une tranche générationnelle,
les filles, les garçons, etc.), pour sa naïveté, son manque de discernement face
aux causes des conditions de vie difficiles et pour sa complaisance vis-à-vis
des responsables. Mais à ce dernier sociotype, contrairement aux autres, le
rappeur propose l’alliance. Cette proposition peut s’exprimer directement ou
non et plus ou moins violemment (prise à partie verbale, usage de l’insulte, de
l’agressivité visant à provoquer l’attention du public).
Les chansons recueillies
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%