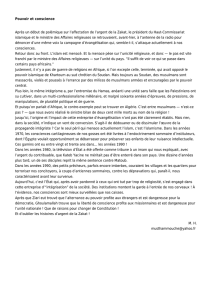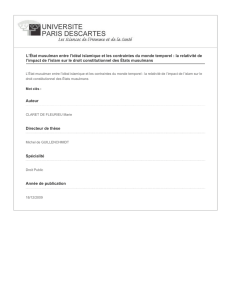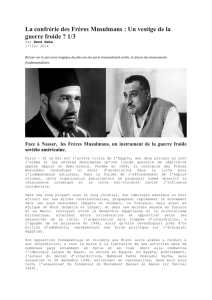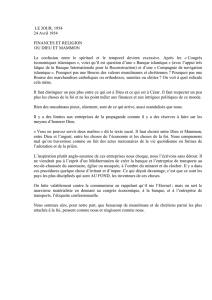Le « capitalisme extrême » des Frères musulmans, par Gilbert

BONNES FEUILLES DU LIVRE « LE PEUPLE VEUT »
Le « capitalisme extrême » des Frères musulmans
Aux affaires en Egypte, les Frères musulmans ne peuvent plus se contenter du slogan
« L’islam est la solution ». Car leur politique libérale risque de susciter de fortes oppositions.
par Gilbert Achcar, février 2013
Soutenez-nous, faites un don
M. Khairat Al-Shater est le numéro deux des Frères musulmans, et le représentant de son aile la plus
conservatrice. Quant au richissime Hassan Malek, après avoir débuté dans les affaires en partenariat avec
M. Al-Shater, il dirige aujourd’hui avec son fils un réseau d’entreprises dans le textile, l’ameublement et le
commerce employant plus de quatre cents personnes. Ces deux hommes incarnent bien le credo
économique des Frères musulmans en faveur de la libre entreprise, qui se conforme davantage à la
doctrine néolibérale que la forme de capitalisme développée sous la présidence de M. Hosni Moubarak.
Le portrait de M. Malek dressé par Bloomberg Businessweek aurait pu s’intituler « L’éthique frériste et
l’esprit du capitalisme », tant il semble paraphraser l’ouvrage classique du sociologue Max Weber. Les
Malek, explique le magazine, « font partie d’une génération de conservateurs religieux ascendante dans
le monde musulman, dont la dévotion stimule la détermination à réussir dans les affaires et la politique.
Comme le dit Malek : “Je n’ai rien d’autre dans ma vie que le travail et la famille.” Ces islamistes posent
un formidable défi à la gouvernance laïque dans des pays comme l’Egypte, non seulement à cause de
leur conservatisme, mais aussi en raison de leur éthique de travail, de leur détermination et de leur
abstention apparente du péché de paresse. (…) “Le fonds de la vision économique de la confrérie, s’il
fallait la définir d’une façon classique, est un capitalisme extrême”, dit Sameh Elbarqy, ancien membre
de la confrérie (1) ».
Ce « capitalisme extrême » se manifeste dans le choix des experts en économie participant à l’assemblée
chargée de rédiger le projet de Constitution égyptienne, largement dominée par les Frères musulmans et
les salafistes, et boycottée par l’opposition libérale et de gauche. « M. Tareq Al-Dessouki est un homme
d’affaires, député du parti Nour [salafiste]. Il dirige la commission économique du nouveau Parlement et
a pour mission de résoudre les conflits éventuels avec les investisseurs saoudiens en Egypte. M. Hussein
Hamed Hassan, 80 ans, est un expert en finance islamique qui a occupé des postes exécutifs à la Banque
internationale islamique, à la Banque islamique de Dubaï, à la Banque nationale islamique d’Al-Sharja
et à l’Union internationale des banques islamiques. M. Maabed Ali Al-Garhi préside l’Association
internationale pour la science économique islamique. [Il occupe également de hautes fonctions à la
Banque islamique des Emirats et à la Bourse de Dubaï.] M. Ibrahim Al-Arabi, homme d’affaires proche
des Frères musulmans, est membre de la chambre de commerce du Caire. M. Hussein Al-Qazzaz, qui
dirige une entreprise de conseil destinée aux milieux d’affaires, est un ami du candidat à la présidence
Khairat Al-Shater (2). En revanche, l’Assemblée constituante de cent membres, proposée par la
confrérie, ne comprend que trois représentants des ouvriers (3). »
L’ex-Frère musulman interrogé par Bloomberg Businessweek a posé la bonne question : le doute ne porte
pas sur l’adhésion de la confrérie au capitalisme de l’ère Moubarak, mais sur sa capacité à rompre avec ses
pires travers. « Ce qui reste à voir, c’est si le capitalisme de compères [crony capitalism] qui a caractérisé
Le « capitalisme extrême » des Frères musulmans, par Gilber... http://www.monde-diplomatique.fr/2013/02/ACHCAR/48742
1 sur 4 26.11.13 12:00

le régime Moubarak va changer avec des dirigeants favorables à l’économie de marché comme Malek et
Al-Shater à la barre. Bien que la confrérie ait traditionnellement œuvré pour soulager les pauvres, “les
travailleurs et les paysans vont souffrir à cause de cette nouvelle classe d’hommes d’affaires”, dit
M. Elbarqy. “Un des grands problèmes avec la confrérie à présent — qu’ils ont en commun avec l’ancien
parti politique de Moubarak —, c’est le mariage du pouvoir avec le capital” (4). »
Le principal obstacle à la collaboration de la confrérie avec le capitalisme égyptien, la répression qu’elle
subissait sous M. Moubarak, est maintenant levé. Les Frères musulmans s’efforcent de prendre exemple
sur l’expérience turque en créant une association d’hommes d’affaires s’adressant en particulier aux
petites et moyennes entreprises, l’Egyptian Business Development Association (EBDA) (5). A l’instar du
Parti de la justice et du développement (AKP) et du gouvernement de M. Recep Tayyip Erdogan, la
confrérie et M. Mohamed Morsi estiment toutefois représenter les intérêts du capitalisme égyptien dans
toutes ses composantes, sans exclure la plupart des collaborateurs de l’ancien régime qui, par la force des
choses, en constituent une partie importante, surtout au sommet.
Ainsi, une délégation de quatre-vingts hommes d’affaires a accompagné M. Morsi en Chine en août 2012.
Le nouveau président souhaitant, à la manière des chefs d’Etat occidentaux, jouer les commis voyageurs
du capitalisme national, plusieurs chefs d’entreprise liés à l’ancien régime furent invités à faire partie du
voyage. Parmi eux, M. Mohamed Farid Khamis, patron d’Oriental Weavers, qui se vante d’être le plus
grand fabricant du monde de tapis et de moquettes tissés à la machine. M. Khamis appartenait au bureau
politique du Parti national démocratique (PND), l’ex-parti au pouvoir du temps de M. Moubarak, et était
alors parlementaire. Un autre membre du bureau politique du PND, réputé proche de M. Gamal
Moubarak, le fils de l’ancien président, participa également à la délégation : M. Sherif Al-Gabaly, membre
du conseil d’administration de la Fédération égyptienne des industries et patron de Polyserve, un groupe
spécialisé dans les engrais chimiques (6).
Comme M. Erdogan, M. Morsi se situe à la confluence des diverses fractions du capitalisme de son pays et
dans la continuité de sa trajectoire globale. La principale différence entre les Frères musulmans et l’AKP
— et donc entre MM. Morsi et Erdogan — n’est pas tant le poids relatif de la petite bourgeoisie et des
couches moyennes dans les deux organisations que la nature du régime dont elles représentent les
intérêts : dans le cas turc, un capitalisme de pays « émergent » à dominante industrielle et exportatrice ;
dans le cas égyptien, un Etat rentier et un capitalisme à dominante commerciale et spéculatrice, largement
marqué par des décennies de népotisme.
Le voyage en Chine visait à promouvoir les exportations égyptiennes, afin de réduire un déficit
commercial de 7 milliards de dollars dans les échanges bilatéraux. Il avait également pour but de
convaincre les dirigeants chinois d’investir en Egypte — sans grand succès. La continuité entre
MM. Moubarak et Morsi s’est toutefois manifestée par le maintien de la dépendance égyptienne envers les
capitaux des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) — à la différence près que le Qatar a pris la
place du royaume saoudien en tant que principal bailleur de fonds du nouveau régime, ce qui est
conforme aux rapports entre les Frères musulmans et l’émirat (7). Le Qatar a accordé un prêt de
2 milliards de dollars au Caire et s’est engagé à investir 18 milliards de dollars sur cinq ans dans des
projets pétrochimiques, industriels, touristiques ou fonciers, ainsi que dans le rachat de banques
égyptiennes. Par ailleurs, le gouvernement de M. Morsi a sollicité un prêt de 4,8 milliards de dollars
auprès du Fonds monétaire international (FMI), en indiquant qu’il était disposé à se conformer à ses
conditions, austérité budgétaire comprise.
Mise en cause des libertés syndicales
On trouve un avant-goût de ces exigences dans la note sur la région préparée par le FMI pour le sommet
des pays du G8 de mai 2011 : « Près de sept cent mille personnes entrent sur le marché du travail
égyptien tous les ans. Les absorber et réduire le nombre de celles qui sont actuellement au chômage
exigera une économie plus dynamique. Cela requiert des mesures courageuses, dont plusieurs devront
être mises en œuvre par le gouvernement issu des élections générales qui interviendront cette année. Les
principales réformes comprennent le renforcement de la concurrence afin que les marchés deviennent
Le « capitalisme extrême » des Frères musulmans, par Gilber... http://www.monde-diplomatique.fr/2013/02/ACHCAR/48742
2 sur 4 26.11.13 12:00

plus ouverts aux investisseurs locaux et étrangers ; la création d’un environnement économique qui
attire et retienne l’investissement privé et soutienne les petites entreprises ; la réforme du marché du
travail ; et la réduction du déficit budgétaire, y compris en diminuant le gaspillage provenant des
subventions. (…) L’appel au financement extérieur, y compris auprès du secteur privé, restera
souhaitable quelques années de plus (8). »
Mais ces nouveaux emprunts aggraveront le poids de l’endettement, avec un service de la dette qui
représente déjà le quart des dépenses budgétaires de l’Etat, lesquelles sont supérieures de 35 % aux
recettes. Accroître l’endettement en se maintenant dans une logique néolibérale signifie donc que l’Etat
devra réduire les salaires de la fonction publique, les subventions aux plus démunis et les retraites. En
septembre 2012, M. Morsi a d’ailleurs promis à une délégation d’hommes d’affaires américains qu’il ne
reculerait pas devant des réformes structurelles draconiennes afin de redresser l’économie (9). Ces
orientations laissent entrevoir une prochaine répression des luttes sociales et ouvrières. La volonté du
nouveau gouvernement de remettre en cause les libertés syndicales conquises à la faveur du soulèvement
et la multiplication des licenciements de syndicalistes vont dans ce sens.
M. Morsi, son gouvernement et les Frères musulmans conduisent l’Egypte vers une catastrophe
économique et sociale. Les recettes néolibérales ont déjà démontré leur incapacité à extraire le pays du
cercle vicieux du sous-développement et de la dépendance. Elles l’y ont au contraire enfoncé davantage.
L’instabilité politique et sociale créée par le soulèvement ne peut que contrarier la perspective d’une
croissance tirée par les investissements privés. Et il faut avoir la foi du charbonnier pour croire que le
Qatar suppléera à l’indigence des investissements publics.
Du temps de M. Moubarak, il restait aux pauvres le recours à la charité combinée avec l’« opium du
peuple » — « L’islam est la solution », promettaient les Frères musulmans depuis des décennies,
dissimulant derrière ce slogan creux leur incapacité à formuler un programme économique
fondamentalement différent de celui du pouvoir en place.
L’heure de vérité a sonné. Comme l’a souligné le chercheur Khaled Hroub, « dans la période qui vient, le
slogan “L’islam est la solution” et le discours au nom de la religion seront confrontés à une
expérimentation publique dans le laboratoire de la conscience populaire. Celle-ci durera peut-être
longtemps, et pourra consumer la vie de toute une génération ; mais il semble inévitable que les peuples
arabes traversent cette période historique afin que leur conscience évolue progressivement de l’obsession
de l’identité à la conscience de la réalité politique, sociale et économique. Afin que la conscience des
peuples et l’opinion publique passent de l’utopie qui consiste à fonder des espérances sur des slogans
rêveurs à la confrontation avec la réalité et à l’évaluation des partis et des mouvements en fonction des
programmes réels qu’ils présentent (10) ».
Les trafiquants de l’« opium du peuple » sont parvenus au pouvoir. La vertu soporifique de leurs
promesses s’en trouve forcément diminuée. Il y a plus d’un quart de siècle, un des meilleurs orientalistes
français, Maxime Rodinson, avait bien formulé le problème : « L’intégrisme islamique est un mouvement
temporaire, transitoire, mais il peut durer encore trente ans ou cinquante ans — je ne sais pas. Là où il
n’est pas au pouvoir, il restera comme idéal tant qu’il y aura cette frustration de base, cette
insatisfaction qui pousse les gens à s’engager à l’extrême. Il faut une longue expérience du cléricalisme
afin de s’en dégoûter : en Europe, cela a pris pas mal de temps ! La période restera longtemps dominée
par les intégristes musulmans. Si un régime intégriste islamique rencontrait des échecs très visibles, y
compris dans le registre du nationalisme, et débouchait sur une tyrannie manifeste, cela pourrait
amener beaucoup de gens à se tourner vers une solution de rechange qui dénonce ces tares. Mais il
faudrait une solution crédible, enthousiasmante et mobilisatrice — et ce ne sera pas facile (11). »
Gilbert Achcar
Professeur à l’Ecole des études
orientales et africaines (SOAS)
de l’université de Londres.
Auteur de l’ouvrage Le peuple
veut. Une exploration radicale
du soulèvement arabe,
Le « capitalisme extrême » des Frères musulmans, par Gilber... http://www.monde-diplomatique.fr/2013/02/ACHCAR/48742
3 sur 4 26.11.13 12:00

Islam Finance Travail Religion Économie Capitalisme Inégalités Parti politique Néolibéralisme
Égypte
Sindbad, Paris, 2013 (en
librairies le 20 février), dont ce
texte est extrait.
(1) « The economic vision of Egypt’s Muslim Brotherhood millionaires [http://www.businessweek.com/articles/2012-04-19/the-economic-vision-
of-egypts-muslim-brotherhood-millionaires] », Bloomberg Businessweek, New York, 19 avril 2012.
(2) M. Al-Shater avait été le premier candidat des Frères musulmans à l’élection présidentielle. Sa candidature ayant été rejetée, il fut remplacé par
M. Mohamed Morsi.
(3) « One sure thing : A pro-market Egyptian Constitution [http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/38404/Business/Economy/One-sure-
thing-A-promarket-Egyptian-constitution-.aspx] », Ahram Online, 4 avril 2012.
(4) « The economic vision of Egypt’s Muslim Brotherhood millionaires [http://www.businessweek.com/articles/2012-04-19/the-economic-vision-
of-egypts-muslim-brotherhood-millionaires] », op. cit.
(5) Cf. « Senior Brotherhood member launches Egyptian business association [http://www.egyptindependent.com/news/senior-brotherhood-
member-launches-egyptian-business-association] », Egypt Independent, Le Caire, 26 mars 2012.
(6) « Mubarak era tycoons join Egypt president in China [http://english.ahram.org.eg/News/51477.aspx] », Ahram Online, 28 août 2012.
(7) Lire Alain Gresh, « Les islamistes à l’épreuve du pouvoir », Le Monde diplomatique, novembre 2012.
(8) « Economic transformation in MENA : Delivering on the promise of shared prosperity [http://www.imf.org/external/np/g8/052611.htm] »,
note du FMI préparée pour le sommet du G8 à Deauville (France), 27 mai 2011.
(9) Cf. « Egypt vows structural reforms, meets US executives [http://news.yahoo.com/egypt-vows-structural-reforms-meets-us-executives-
220121343.html] », Associated Press, 9 septembre 2012.
(10) Khaled Hroub, Eloge de la révolution. La rivière contre le marécage (en arabe), Dar al-Saqi, Beyrouth, 2012, p. 119.
(11) « Maxime Rodinson : sur l’intégrisme islamique [http://www.cairn.info/revue-mouvements-2004-6-page-72.htm] », Mouvements, n° 36,
Paris, novembre-décembre 2004.
Le « capitalisme extrême » des Frères musulmans, par Gilber... http://www.monde-diplomatique.fr/2013/02/ACHCAR/48742
4 sur 4 26.11.13 12:00
1
/
4
100%