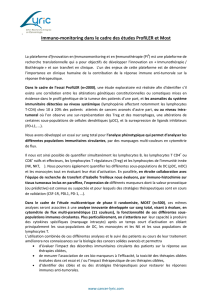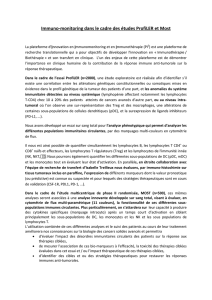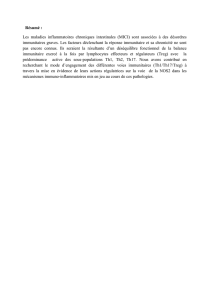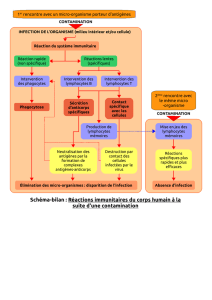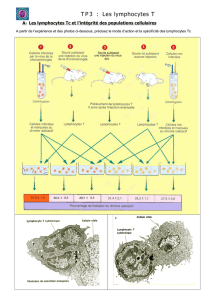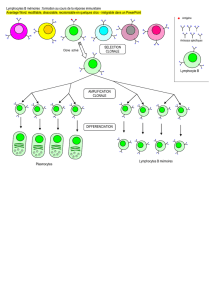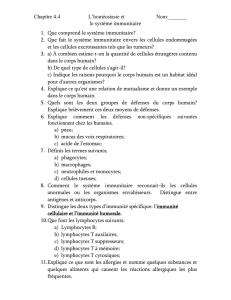atologie Injection de lymphocytes du donneur pour la

Correspondances en Onco-Hématologie - Vol. VII - n° 2 - avril-mai-juin 2012
83
Immunologie
et onco-hématologie
dossier thématique
www.edimark.fr
Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition
Périodique de formation
Société éditrice : EDIMARK SAS
CPPAP : 0114T88680 - ISSN : 1954-4820
Trimestriel
Prix du numéro : 36 €
Vol. VII - n° 1 - Janvier-février-mars 2012
DOSSIER
Les temps forts
en hématologie en 2011
Coordonné par Noël Milpied
•
Biologie : Next Generation Sequencing
raconté à Juliette - M.C. Béné, G. Cartron
•
Lymphomes - S. Le Gouill
•
Leucémies aiguës lymphoblastiques
de l’enfant - T. Leblanc
•
Allogreffes - N. Milpied…
…tout le sommaire
www.edimark.fr
O
F
F
R
E
S
P
É
C
I
A
L
E
A
B
O
N
N
E
M
E
N
T
-30%
Congrès
SFH
2012
Voir page 51
www.edimark.fr
Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition
Périodique de formation
Société éditrice : EDIMARK SAS
CPPAP : 0114T88680 - ISSN : 1954-4820
Trimestriel
Prix du numéro : 36 €
Vol. VII - n° 2 - Avril-mai-juin 2012
www.edimark.fr
DOSSIER
Immunologie
et onco-hématologie
Coordonné par Marie-Christine Béné
• Applications de la vaccination en oncologie
hématologique - É. Daguindau, C. Vauchy, Y. Godet, C. Ferrand,
O. Adotevi, C. Borg
• Injection de lymphocytes du donneur pour
la rechute d’une hémopathie maligne : comment
en améliorer l’efficacité ? - C. Alanio, J.L.Cohen, S. Maur y
• L’association des syndromes myélodysplasiques
aux manifestations auto-immunes - T. Braun, O. Fain, L. Adès
• Cellules NK et hémopathies malignes - N. Vey, D. Blaise
…tout le sommaire
ABONNEZ-VOUS ET BÉNÉFICIEZ DE NOMBREUX SERVICES - Oui, je m’abonne
4 numéros par an
Abonnez-vous à Correspondances en Onco-Hématologie
sur www.edimark.fr
12 BONNES RAISONS POUR ÊTRE UN ABONNÉ PRIVILÉGIÉ
TOUTE L'ACTUALITÉ
DE VOTRE SPÉCIALITÉ
DES SERVICES EXCLUSIFS
• Revue publiée en toute indépendance et répondant aux critères d’exigence
de la presse (adhésion au Syndicat de la presse et de l’édition des professions
de santé, indexation dans la base de données INIST-CNRS)
• Sous l’unique et entière responsabilité du directeur de la publication
et du rédacteur en chef
• Un comité de rédaction réuni 2 ou 3 fois par an pour débattre
des sujets et des auteurs à publier
•Un dossier thématique ou des mises au point dans chaque numéro
•Annonce professionnelle : 1 achetée = 1 gratuite
•Accès gratuit au site : www.edimark.fr
•Copyright gracieux
•Web-TV : l’actualité vue par les experts scientifiques
• Accès à plus de 12 ans d’archives des 20 revues du groupe de presse
• E-journaux, diaporamas, photothèque et calendrier des congrès en ligne...
•Toute l’actualité des grandes spécialités médicales
•Lecture de votre revue grâce aux applications iPhone* et iPad*
REJOIGNEZNOUS... ET BÉNÉFICIEZ D’UNE FORMATION CONTINUE
à Correspondances en Onco-Hématologie
Vous êtes :
Raison sociale : .........................................................................................................
(si collectivité : association, administration, société…)
M., Mme, Mlle : .........................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................
Pratique : o hospitalière o libérale o autre : .................................................
(cochez)
E-mail (indispensable pour bénéficier de nos services Internet : archives, newsletters…) :
Votre adresse postale : .....................................................................................
......................................................................................................................................
Ville : ...........................................................................................................................
Code postal : ................................ Pays : ................................................................
Tél. : ............................................... Fax : .............................................................
En cas de réabonnement, de changement d’adresse ou de demande de renseignements,
merci de joindre votre dernière étiquette-adresse.
Votre abonnement prendra effet dans un délai de 3 semaines à réception de votre règlement. Un justificatif de paiement vous
sera adressé.
Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des
données que vous avez transmises, en adressant un courrier à Edimark SAS. Les informations requises nous sont nécessaires
pour la mise en place de votre abonnement.
Votre tarif pour 1 AN d’abonnement (4 numéros) :
(Cochez la case qui vous correspond)
o Collectivité : 139 € TTC
o Particulier : 91 € TTC
o Étudiant : 70 € TTC*
* Merci de bien vouloir joindre la copie de votre carte d’étudiant
Votre tarif pour 2 ANS d’abonnement (8 numéros) :
(Cochez la case qui vous correspond)
o Collectivité : 237€ TTC
o Particulier : 152 € TTC
o Étudiant : 120 € TTC*
* Merci de bien vouloir joindre la copie de votre carte d’étudiant
Vous devez régler :
➊ VOTRE TARIF (inscrivez celui que vous avez coché) € TTC
➋ Frais de port (par avion) :
Votre revue vous sera envoyée :
o En France / DOM-TOM (GRATUIT)
o En Europe, Afrique 7 € TTC
o En Asie, Océanie, Amérique 14 € TTC
➌ TOTAL, FRAIS DE PORT INCLUS (= ➊ + ➋) € TTC
Vous réglez par (cochez) :
o Carte bancaire VISA, EUROCARD/MASTERCARD
N°
I I I I I I I I I I I I I I I I I
Date d’expiration
I I I I I
Date : N° C V V I I I I
Signature : (Trois derniers chiffres au dos de votre carte bancaire)
(obligatoire)
o Chèque à l’ordre de EDIMARK
o Virement bancaire à réception de la facture (réservé aux collectivités)
COH
* iPhone et iPad sont des marques d’Apple Computer Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.
COH Vol. VII - no 2
)
)au lieu de 144 €
(Tarif au numéro)
au lieu de 288 €
(Tarif au numéro)
Des questions ? Des suggestions ? Déjà abonné ?
Contactez le 01 46 67 62 87, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h, ou par fax au 01 46 67 63 09, ou e-mail à [email protected]
Bulletin à découper et à renvoyer complété et accompagné du réglement à : EDIMARK SAS – 2, rue Sainte-Marie – 92418 Courbevoie Cedex
Injection de lymphocytes du donneur
pour la rechute d’une hémopathie
maligne : comment en améliorer
l’efficacité ?
Searching to improve the antitumoral effect of donor lymphocyte infusions
C. Alanio*, J.L. Cohen**, S. Maury***
*Centre d’immunologie
humaine, département
d’immunologie, Institut
Pasteur, Paris.
**CIC biothérapie, hôpital
Henri-Mondor, Créteil.
***Service d'hématologie
clinique, hôpital Henri-
Mondor, Créteil.
RÉSUMÉ
Summary
»
Les injections de lymphocytes du donneur (ILD) sont
classiquement utilisées dans le traitement des rechutes
après allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, mais
leur efficacité reste incomplète. Afin d’augmenter leur effet
antitumoral (Graft versus Tumor [GvT]), plusieurs tentatives de
stimulation des lymphocytes du donneur ex vivo, ou in vivo après
leur réinjection, ont été développées. Bien que ces expériences
aient apporté des résultats encourageants, elles n’ont pas été
adoptées en pratique courante. Récemment, nous avons testé
la possibilité de dépléter les lymphocytes T régulateurs des ILD
avec l’idée de stimuler ainsi la prolifération des lymphocytes
alloréactifs. Chez des patients en rechute après allogreffe et sans
antécédent de maladie du greffon contre l’hôte, cette approche
permet d’induire des manifestations d’alloréactivité incluant un
effet GvT. Elle ouvre des perspectives pour l’optimisation des ILD
en pratique courante.
Mots-clés : Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques –
Injection de lymphocytes du donneur – Effet greffon contre tumeur –
Lymphocytes T régulateurs.
Although routinely used for relapse after allogeneic
hematopoietic stem cell transplantation (HSCT), donor
lymphocyte infusion (DLI) is often not successful in
controlling malignancy. Previous attempts to increase
response rates, using ex vivo or in vivo activated T-cells, have
provided encouraging preliminary results. However, these
strategies have not been incorporated into a wide clinical
use. Regulatory T-cells (Tregs) may reduce alloreactivity, the
major component of the graft versus tumor (GvT) effect. We
recently tested the possibility to deplete Tregs from DLI in
order to improve alloreactivity and likewise the GvT effect of
donor T-cells. In patients relapsing after HSCT and who did
not experience graft-versus-host disease before, this approach
permits to induce alloreactivity manifestations including a
GvT effect. It offers a rational for DLI optimization in a wide
clinical use.
Keywords: Allogeneic hematopoietic stem cell transplan-
tation – Donor lymphocyte infusion – Graft versus tumor
effect – Regulatory T-cells.
L’
efficacité de la greffe de cellules souches
hématopoïétiques (CSH) allogéniques pour le
traitement des hémopathies malignes repose
à la fois sur la myéloablation induite par le conditionne-
ment et sur le transfert, au sein du greffon, de cellules
immunocompétentes du donneur exerçant un effet
antitumoral (1). Cet effet Graft versus Tumor (GvT) a été
suggéré initialement en comparant les taux de rechute
entre des patients recevant un greffon non manipulé
et ceux recevant un greffon déplété en lymphocytes T
(2, 3). Il a ensuite été prouvé cliniquement dans le cadre
des rechutes de patients atteints d’une leucémie myé-
loïde chronique (LMC) après greffe, où l’injection de
lymphocytes du donneur (ILD, ou DLI en anglais, pour
Donor Lymphocytes Infusion) pouvait induire une nou-
velle rémission sans nécessiter de chimiothérapie com-
plémentaire (4).
Les ILD sont aujourd’hui utilisées dans presque toutes
les pathologies malignes concernées par la transplan-
tation médullaire, et notamment dans le cadre des
rechutes (5). On distingue les ILD thérapeutiques, majo-
ritaires, administrées aux patients en rechute de leur
maladie ou chez qui le chimérisme du donneur (après
conditionnement d’intensité réduite) reste incomplet, et
les ILD préventives, d’application plus restreinte, admi-
nistrées de façon programmée à des intervalles définis

Correspondances en Onco-Hématologie - Vol. VII - n° 2 - avril-mai-juin 2012
84
Immunologie
et onco-hématologie
dossier thématique
après la transplantation, le plus souvent dans le cadre
d’un greffon initialement déplété en lymphocytes T.
Les facteurs prédictifs de la réponse après ILD sont le
nombre de lymphocytes T CD3+/kg injectés (> 10 × 106)
et la survenue d’une GvH post-ILD (6, 7). La GvH, dans
sa forme aiguë ou chronique, représente à la fois la
principale complication, parfois létale, rencontrée
après ILD, et l’un des principaux facteurs significati-
vement associés à un effet bénéfique sur la maladie
hématologique. Cette dualité rend difficile la mise au
point de stratégies visant à diminuer l’incidence de
la GvH après ILD. Aujourd’hui, la principale approche
utilisée pour limiter ce risque consiste à injecter des
doses successives et progressivement croissantes de
lymphocytes du donneur, à des intervalles variables,
selon l’évolution clinique (8). L’idée sous-jacente à cette
utilisation est que l’incidence de la GvH augmente
avec la dose de lymphocytes injectés et que l’on peut
ainsi atteindre un juste équilibre entre la GvH et l’effet
GvT désiré. Les résultats obtenus avec cette approche,
bien que les schémas varient selon les études, sont
encourageants.
Chez des patients en rechute après allogreffe, pour
lesquels il y a peu d’alternatives et dont le pronostic
est sévère, l’ILD constitue une option thérapeutique
acceptable, même si son efficacité reste actuellement
très relative dans la plupart des pathologies considérées.
En effet, dans une série rétrospective de 140 patients
traités par ILD, les taux d’obtention d’une rémission
complète étaient de 60 % pour la LMC (n = 55, toutes
formes de la maladie confondues), mais de seulement
15 % pour la leucémie aiguë myéloïde (LAM) [n = 39]
et de 18 % pour la leucémie aiguë lymphoblastique
(LAL) [n = 11] (9). Dans ce cadre, de nombreux efforts
de recherche visent actuellement à améliorer l’efficacité
antitumorale de l’ILD sans pour autant augmenter la
mortalité. Ils sont présentés ci-après.
Stimulation des lymphocytes T du donneur
Une première approche consiste à stimuler les lympho-
cytes T du donneur avant de les injecter à des patients
ne répondant pas à une ILD standard. L’activation des
cellules peut se faire soit in vitro avant l’injection, soit
in vitro et in vivo après l’injection, par de l’IL-2 recom-
binante humaine (10, 11). Plus récemment, l’activation
des lymphocytes s’est faite in vitro par costimulation
par des billes anti-CD3 et anti-CD28 (12). Bien que ces
essais aient apporté des résultats encourageants, les
techniques qui s’y rattachent n’ont pas été adoptées
en pratique clinique courante.
Combiner chimiothérapie et ILD
Une deuxième approche consiste à combiner l’adminis-
tration d’une chimiothérapie à l’ILD afin d’en intensifier
l’effet. Cette approche repose sur 2 concepts :
✓
l’un suppose que l’effet antileucémique sur des cel-
lules tumorales en faible quantité aura plus de chances
de succès ;
✓
l’autre se fonde sur une activation plus forte (et donc
un effet GvT plus important) provoquée par les lympho-
cytes T du donneur dans un contexte lymphopénique
induit par la chimiothérapie. Dans le seul essai clinique
publié, utilisant de fortes doses de lymphocytes T, la
survenue de GvH gravissimes, souvent mortelles dans
le bras chimiothérapie, a conduit à l’interruption pré-
maturée de l’étude (13).
Améliorer la présentation des antigènes
tumoraux
Une troisième approche vise à améliorer la présentation
des antigènes tumoraux afin de rendre les patients plus
sensibles à l’effet GvL. Elle repose notamment sur des
données obtenues in vitro sur des cellules de leucémie
myéloïde, qui peuvent être différenciées en cellules
dendritiques (DC) à l’aide de cytokines telles que l’IFNα
ou le GM-CSF (14, 15). Cette méthode est en cours de
perfectionnement.
Manipulation ex vivo d’une sous-population
des lymphocytes du donneur
L’approche que nous présentons ici repose sur la mani-
pulation ex vivo, avant l’injection, d’une sous-population
des lymphocytes du donneur, à savoir les lymphocytes T
CD4+CD25+Foxp3 immunorégulateurs (T-régulateurs).
Présentation des lymphocytes T régulateurs
L’ensemble des mécanismes empêchant une activation
pathologique du système immunitaire contre les tissus
(le “soi”) tout en préservant les réponses dirigées contre
les agents exogènes (le “non-soi”) est appelé “tolérance
immunitaire”. Celle-ci a 2 composantes :
✓
la tolérance centrale, qui agit au lieu même de géné-
ration des lymphocytes ;
✓
la tolérance périphérique, qui contrôle les lympho-
cytes matures une fois ceux-ci libérés dans la circulation.
Les lymphocytes T régulateurs (Treg) sont des cellules
immunitaires qui jouent un rôle primordial dans la
tolérance périphérique et la régulation du système

Correspondances en Onco-Hématologie - Vol. VII - n° 2 - avril-mai-juin 2012
85
Injection de lymphocytes du donneur pour la rechute d’une hémopathie maligne :
comment en améliorer l’efficacité ?
immunitaire afin de conserver l’homéostasie lymphocy-
taire. Ils maintiennent la tolérance au soi et préviennent
l’auto-immunité. Ils modèrent l’inflammation induite par
les pathogènes et autres agressions environnementales
telles que les allergènes, et participent à l’établissement
et au maintien d’une flore microbiotique au niveau
intestinal. Cette population a été initialement identifiée
chez la souris (16). Elle y représente environ 5 % des
T CD4+ et se caractérise par une expression forte et
constitutive du marqueur CD25 (chaîne α du récepteur
à l’IL-2) ainsi que par des fonctions immunorégulatrices
observables in vitro et in vivo.
La complexité des travaux portant sur les Treg chez
l’homme vient en partie de la difficulté à identifier pré-
cisément cette population. En effet, les Treg expriment
de façon forte et constitutive le marqueur CD25, mais
celui-ci n’est pas spécifique, car il est également sur-
exprimé par les T effecteurs activés (Teff). En moyenne,
on retrouve dans le sang humain plus de 30 % de
T CD4+CD25+, dont seuls 2 à 4 % ont une expression
forte de CD25 et peuvent être considérés comme des
Treg. La difficulté est donc de bien définir la limite entre
les CD25 forts (Treg) et les CD25 intermédiaires (Teff),
et que celle-ci soit reproductible entre différents labo-
ratoires, différents patients et différents examinateurs.
D’autres marqueurs fortement surexprimés par les Treg
ont été identifiés et aident à leur identification. Le prin-
cipal est le facteur nucléaire de transcription Foxp3
(Forkhead box P3), dont la surexpression est primordiale
pour l’acquisition de fonctions régulatrices par ces cel-
lules. Une déficience en Foxp3 entraîne un syndrome
lymphoprolifératif avec des manifestations d’auto-
immunité qui touchent de multiples organes, que ce
soit chez la souris (mutant scurfy) ou chez l’homme (syn-
drome Immunodysregulation Polyendocrinopathy and
Enteropathy, X-linked [IPEX]). On peut citer également le
GITR et le CTLA-4 intracellulaire, et l’absence ou la faible
expression membranaire du récepteur à l’IL-7, CD127.
Cependant, tout comme CD25, aucun n’est totalement
spécifique des Treg, un pourcentage significatif de Teff
activés ayant un profil immunophénotypique semblable
sans pour autant avoir de propriétés régulatrices.
Les Treg Foxp3+ expriment un récepteur T à l’antigène
à leur surface, qu’ils utilisent pour reconnaître spéci-
fiquement leur antigène cible ; ils ont un répertoire
qualitativement distinct des T conventionnels. Leurs
mécanismes d’action sont nombreux et souvent mul-
tiples : inhibition de la prolifération des Teff, inhibi-
tion de la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires,
inhibition de la maturation des DC, inhibition de la
prise de contact des Teff avec les DC, production de
cytokines à action anti-inflammatoire (TGFβ, IL-10,
AMPc), ou encore conversion des DC en cellules
tolérogènes.
Treg et alloréactivité
L’allo-immunité correspond à la reconnaissance d’anti-
gènes étrangers codés par le système du complexe
majeur d’histocompatibilité (CMH), et par différents
loci d’antigènes mineurs d’histocompatibilité. Elle
implique à la fois l’immunité innée et l’immunité
acquise. Cette dernière joue un rôle primordial via les
lymphocytes T CD4+
et/ou CD8+, dits allogéniques,
qui peuvent directement reconnaître des molécules
étrangères du CMH et leurs peptides associés présentés
par des cellules présentatrices d’antigène allogéniques,
ou indirectement reconnaître des peptides étrangers
présentés par des cellules présentatrices d’antigène
syngéniques.
Les Treg naturels ont un rôle physiologique dans la
régulation de la tolérance aux alloantigènes paternels
durant la gestation, ainsi qu’aux allergènes de l’envi-
ronnement (17). Ainsi, chez la souris, l’élimination des
Treg par un anticorps anti-CD25 entraîne la perte des
fœtus en cours de gestation lorsque les 2 géniteurs sont
de fonds génétiques différents. En greffe d’organe, une
série d’études précliniques chez la souris a montré que
les Treg du receveur étaient critiques pour l’induction
de tolérance et la prise de greffe au long cours (18).
En transplantation hématopoïétique, plusieurs études
ont analysé le compartiment de Treg au sein du greffon
et/ou dans le sang du receveur, afin de corréler ces
données à l’incidence de la GvH aiguë ou chronique
(19). On pense aujourd’hui qu’il existe une corrélation
inverse entre le nombre absolu de Treg du greffon −
ou plutôt le ratio entre Treg et T conventionnels au
sein du greffon − et la survenue d’une GvH aiguë (20).
Concernant le nombre de Treg dans le sang des patients
greffés, les résultats des différentes études sont glo-
balement discordants. La localisation semble être un
élément important à prendre en considération : en effet,
les patients greffés présentant de forts taux de Treg
dans la muqueuse intestinale ont un risque diminué
de GvH aiguë ou chronique. Chez l’animal, dans un
modèle murin de greffe de CSH, la déplétion en CD25
chez le donneur accélère la GvH, alors que leur injection
prévient ou améliore la GvH aiguë ou chronique et
accélère la reconstitution immunitaire (21).
Enfin, en pathologie tumorale, les Treg chargés physio-
logiquement d’induire une tolérance vis-à-vis des anti-
gènes du soi ont un effet délétère en induisant une
puissante immunosuppression vis-à-vis des antigènes
tumoraux, qui sont justement souvent des antigènes du
soi. Ils représentent en pratique clinique un important

Correspondances en Onco-Hématologie - Vol. VII - n° 2 - avril-mai-juin 2012
86
Immunologie
et onco-hématologie
dossier thématique
mécanisme d’échappement tumoral, et un obstacle
important au succès de l’immunothérapie en patho-
logie tumorale (22). Ces cellules sont donc la cible de
nombreux essais cliniques visant à réduire leur nombre
et/ou leurs fonctions au sein du microenvironnement
tumoral, et donc à augmenter l’immunité naturelle
anticancéreuse.
La déplétion en Treg accentue l’effet GvH/GvT
après ILD
Depuis que l’on a découvert que les Treg participent à la
suppression des réponses antitumorales, la possibilité
d’inhiber leur fonction est devenue un atout pour le
développement d’immunothérapies anticancéreuses
efficaces (23). Dans le cadre de l’ILD, améliorer l’effica-
cité thérapeutique reste un défi important pour des
patients ayant souvent peu d’alternatives. Nous avons
ainsi cherché à optimiser l’effet antitumoral après ILD
par déplétion des lymphocytes T régulateurs CD25+
contenus dans la lymphaphérèse (figure 1). Cet essai
clinique s’adressait à des patients réfractaires à une ou
plusieurs ILD ; ils devaient également n’avoir jamais
présenté de manifestations de GvH par le passé, ni après
la greffe, ni après une ou plusieurs ILD antérieures. Chez
ces sujets, que l’on pourrait qualifier de réfractaires à
l’alloréactivité, l’objectif était de déclencher pour la
première fois depuis la greffe des stigmates cliniques
d’alloréactivité (GvH et/ou GvT) grâce à une ILD déplé-
tée en Treg (d-ILD).
Grâce à la collaboration de 5 centres français de greffe,
17 patients ont été inclus dans cet essai (24). Une dose
moyenne de 4,3 × 107 CD3+/kg (range: 1-10) a été
injectée aux receveurs sans aucune toxicité aiguë. Sur
les 17 patients, 2 ont développé une GvH après d-ILD
alors qu’ils n’en avaient jamais présenté au décours de
traitements antérieurs. Cet effet était associé à un effet
GvT documenté dans les 2 cas. Chez 3 autres patients,
un effet GvT sans manifestations cliniques de GvH a
été observé.
Chez les patients toujours résistants à l’alloréactivité,
nous avons ensuite émis l’hypothèse que les Treg
présents chez le receveur au moment de l’injection
pouvaient limiter l’aptitude de la d-ILD à induire l’allo-
réactivité. Nous avons donc administré une d-ILD dans
un contexte de lymphodéplétion du receveur, qui per-
met à la fois d’éliminer les Treg du receveur et d’entraîner
Figure 1. Déplétion des cellules CD25+ du donneur. Les cellules du donneur sont incubées avec un anticorps anti-CD25 couplé
à des microbilles, puis passées sur colonne magnétique. La fraction négative, déplétée en cellules CD25+, est alors collectée et
conditionnée en vue de son injection au receveur. L’analyse en cytométrie de flux de l’expression des molécules CD25 et Foxp3
parmi les lymphocytes T CD4+ atteste d’une déplétion en Treg constamment supérieure à 90 %.
Cytaphérèse Anti-CD25 Fraction positive
Fraction négative
(déplétée)
Fraction totale
CD4
CD4
CD25 Foxp3 CD25 Foxp3
Injection aux 17 patients
en rechute après
allogreffe

Correspondances en Onco-Hématologie - Vol. VII - n° 2 - avril-mai-juin 2012
87
Injection de lymphocytes du donneur pour la rechute d’une hémopathie maligne :
comment en améliorer l’efficacité ?
l’expansion et la prolifération homéostatique des cel-
lules effectrices infusées. Cette lymphodéplétion était
obtenue grâce à l’administration de cyclophosphamide
(1 g/m2 à J-5) et de fludarabine (30 mg/m2/j à J-5, J-4,
J-3 et J-2) avant l’injection de l’ILD déplétée. Ainsi, chez
4 patients qui avaient déjà reçu une d-ILD sans effet
notable, l’addition d’une lymphodéplétion a entraîné
de façon constante l’induction d’un effet GvH/GvT.
Globalement, nos résultats montrent que, chez ces
patients, l’injection de cellules T effectrices déplétées
en Treg dans un environnement lui-même déplété en
Treg est optimale pour l’induction d’une alloréactivité.
Conclusion
Ainsi, l’induction de GvH dans cette cohorte très spéci-
fique de patients était significativement associée à une
meilleure survie globale (83 % ± 15 % versus 27 % ± 13 %
[p = 0,035]). Cependant, certains sujets ont eu un effet
GvL sans GvH, et d’autres ont développé une maladie
progressive malgré l’induction d’une alloréactivité.
Point important : toutes les GvH induites après d-ILD
ont pu être contrôlées par une corticothérapie simple,
ce qui montre la sécurité de cette approche.
Même si l’efficacité de cette nouvelle stratégie devrait
idéalement être évaluée de manière contrôlée, la mise en
place d’un tel essai n’est pas simple, du fait notamment
de l’hétérogénéité des patients et de leur statut hémato-
logique au moment de l’ILD. D’ores et déjà, une utilisation
compassionnelle de cette approche est possible, sous
réserve d’un financement par le centre en charge du
patient. Tenant compte de notre expérience actuelle et
des données de la littérature, la place de l’ILD déplétée en
Treg peut être définie de la manière suivante (figure 2) :
✓
elle est réservée aux patients n’ayant pas développé
de stigmates francs de GvH après la ou les ILD précé-
dentes ;
✓
elle doit être combinée à un traitement lympho-
péniant de type Cy-Flu, qui augmente clairement son
efficacité ;
✓
elle doit, dans la mesure du possible, être précédée
d’une ILD non manipulée, combinée à ce même traite-
ment lymphopéniant.
■
Figure 2. ILD déplétée en Treg : proposition d’un schéma pour une extension d’utilisation en routine.
Greffe
allogénique
Absence de GvD
Cy-Flu
• Cyclophosphamide : 1 g/m2/j
J-5
• Fludarabine : 30 mg/m2/j
J-5 à J-2
Rechute
de l’hémopathie
maligne
Cy-Flu
+
ILD
non manipulée
Réponse
insuffisante
Réponse
insuffisante
ILD Cy-Flu
+
ILD
déplétée en Treg
1. Horowitz MM, Gale RP, Sondel PM et al. Graft-versus-
leukemia reactions after bone marrow transplantation. Blood
1990;75(3):555-62.
2. Martin PJ, Hansen JA, Buckner CD et al. Effects of in vitro
depletion of T cells in HLA-identical allogeneic marrow grafts.
Blood 1985;66(3):664-72.
3.
Kolb HJ. Graft-versus-leukemia effects of transplantation
and donor lymphocytes. Blood 2008;112(12):4371-83.
4. Kolb HJ, Mittermüller J, Clemm C et al. Donor leukocyte trans-
fusions for treatment of recurrent chronic myelogenous leuke-
mia in marrow transplant patients. Blood 1990;76(12):2462-5.
5. Tomblyn M, Lazarus HM. Donor lymphocyte infusions:
the long and winding road: how should it be traveled? Bone
Marrow Transplant 2008;42(9):569-79.
6. Fozza C, Szydlo RM, Abdel Rehim MM et al. Factors for graft-
versus-host disease after donor lymphocyte infusions with an
escalating dose regimen: lack of association with cell dose. Br
J Haematol 2007;136(6):833-6.
Références
>>>
 6
6
1
/
6
100%