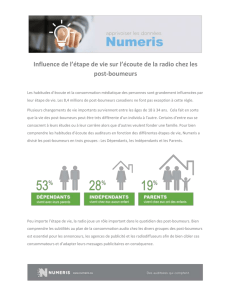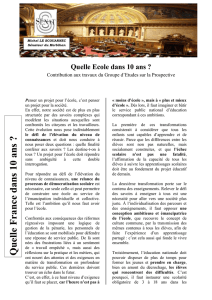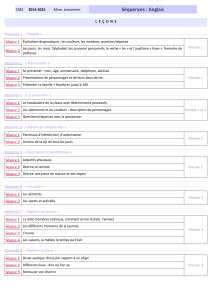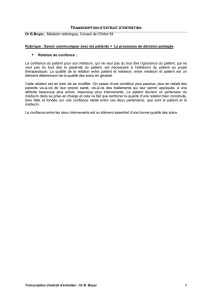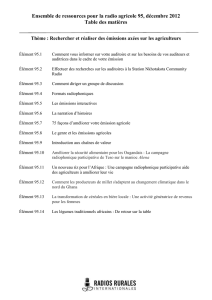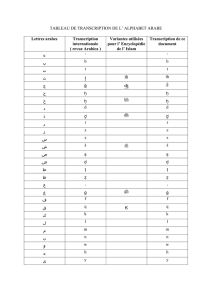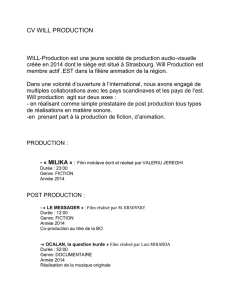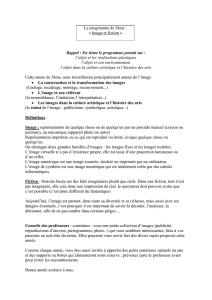Les passerelles entre les dramaturgies pour le théâtre et pour la

Les passerelles entre les dramaturgies pour le théâtre et pour la
radio : transcription d’un débat important
Découvrez d'autres articles sur ce sujet sur www.profession-spectacle.com | 1
Lundi 11 avril dernier, les Écrivains associés du théâtre (eat) organisaient, en
partenariat avec la SACD où se déroulait la rencontre, une table ronde autour des
passerelles existant entre les dramaturgies théâtrales et radiophoniques. Modéré
par Dominique Paquet et entrecoupé d’extraits choisis par les intervenants eux-
mêmes, le débat a abordé de nombreuses questions : l’écriture radiophonique
nécessite-t-elle une adaptation spécifique ? Est-elle plus proche du théâtre ou du
cinéma ? Qu’en est-il du cadre et des contraintes formelles ? Quelle place pour
l’auteur ? Profession Spectacle y était pour assurer une retranscription* à tous
ceux qui ne pouvaient être présents.
Intervenants :
Christophe BARREYRE, producteur de l’émission Affaires sensibles, France Inter.
Sophie-Aude PICON, réalisatrice, auteur et actrice.
Benjamin ABITAN, réalisateur, auteur, acteur et chargé de cours à Paris 8.
Jean-Pierre THIERCELIN, dramaturge.
Sabine REVILLET, dramaturge.
Rencontre modérée par Dominique PAQUET – secrétaire des eat.
Introduction de Dominique Paquet
La radio s’est beaucoup inspirée du théâtre : la première fiction, qui date de 1923, raconte
le naufrage d’un bateau, avec une grande modernité, à la fois textuelle et dans
l’interprétation des acteurs, sans emphase, avec un réalisme de jeu extraordinaire. Dans les
grandes périodes de la radio, autour des années 80, il y eut de nombreuses fictions
enregistrées. Je me souviens par exemple que, pour La guerre des sabotiers, il y avait pas
moins de 80 acteurs, avec quatre points d’enregistrement. La radio pouvait s’inspirer du
théâtre ; du moins y avait-il une très nette théâtralisation. Il s’agit donc ce soir d’avoir un
regard sur ces passerelles, sur ces différences et ressemblances entre théâtre et radio.
Sabine Revillet
Je ne suis pas spécialisée dans ce domaine, même si l’une de mes pièces a été enregistrée à
la radio. Il me semble qu’il y a trois étapes : au départ, les pièces étaient enregistrées sur le
vif et diffusées à la radio ; il y eut ensuite le temps des adaptations : les auteurs adaptaient
leur pièce pour les besoins de la radio ; enfin, il y eut l’émergence d’une écriture spécifique
pour la radio. Pour ma part, je ne sais pas comment écrire spécifiquement pour la radio. Ma

Les passerelles entre les dramaturgies pour le théâtre et pour la
radio : transcription d’un débat important
Découvrez d'autres articles sur ce sujet sur www.profession-spectacle.com | 2
pièce Les gens que j’aime, diffusée à France Culture, n’a pas été pensée pour la radio.
Nous sommes dans une société fragmentée : nous sommes traversés par de multiples voix,
nous avons de multiples écrans… Cette dimension se ressent dans les pièces. J’ai la
sensation que ce l’on écrit pour le théâtre ne s’adapte plus directement, il faut encore le
transposer pour la radio. Dans les pièces que j’écris, il y a souvent des voix sans corps. C’est
l’évolution du théâtre : il n’y a plus de personnages comme avant, on va vers de
l’immatériel. Samuel Beckett a écrit pour la radio et le cinéma ; au fur et à mesure, son
écriture s’est transformée, jusqu’à écrire pour des personnages sans visages, pour des voix
sans corps.
Jean-Pierre Thiercelin
La radio est un creuset de recherche, de la même manière que le théâtre. Ce sont deux arts
différents, mais pas si éloignés. Il y a 1001 possibilités d’écrire pour la radio, 1001
dramaturgies… Ce qui est intéressant, c’est que de la même manière que pour l’écriture
théâtrale, il y a toujours eu cette recherche : la radio est un laboratoire qui va des émissions
très populaires aux écritures plus complexes. J’écris aujourd’hui pour la radio : pour France
Inter, c’est un format très cadré, qui rejoint le phénomène de la commande. J’ai travaillé
pour « Nuits noires », « Nuits blanches », « Au fil de l’histoire » et « Affaires sensibles »… À
chaque fois, il y a un format précis.
Personnellement, je ne me dis pas : « j’écris pour la radio », même si je le sais bien. Car
l’écriture n’est pas spécifique parce qu’elle est pour la radio ; au niveau de la dramaturgie,
ce sont les mêmes conditions, les mêmes impératifs. Il s’agit toujours de créer des
personnages, d’avoir des situations, des affrontements, que ce soit lisible, que ce soit
véritablement une œuvre de théâtre, et plus précisément de radio. La différence est qu’on
travaille essentiellement sur le son, sur la voix. On évoque souvent les bruitages, le
narrateur, de l’illustration sonore… Je dirais qu’à la limite, dans l’écriture, on ne se pose pas
cette question vraiment ; cela devient une évidence dans l’écriture même. La seule chose
que l’on sait, c’est qu’on ne s’engueulera avec le metteur en scène, le scénographe… C’est
l’auditeur qui choisit son éclairage, sa scénographie, qui est la plus belle du monde parce
qu’il se la fait en écoutant la fiction.
Benjamin Abitan
Pour ma part, j’ai l’impression que l’écriture n’est pas la même entre le théâtre et la radio.
Le théâtre a réussi à prendre une autonomie, ou avait déjà une autonomie par rapport au
cinéma que la radio a du mal à prendre. On conçoit souvent l’émission radio comme une

Les passerelles entre les dramaturgies pour le théâtre et pour la
radio : transcription d’un débat important
Découvrez d'autres articles sur ce sujet sur www.profession-spectacle.com | 3
version sans image de l’écriture pour le cinéma : on appelle parfois les pièces
radiophoniques « scénarios ». Cela tient à la manière dont on les réalise, c’est-à-dire à la
manière dont sont construites les productions. Je pense que si l’on produisait autrement, on
envisagerait l’écriture autrement. J’écoutais par exemple des trucs du Belge Sebastian
Dicenaire, qui ne travaille pas du tout comme nous : du fait qu’il n’a pas les mêmes
impératifs de calendrier de production, cela donne des textes complètement différents, dans
lesquels les questions d’espace et de temps n’ont rien à voir avec le cinéma. On peut être
dans plusieurs lieux simultanément ; on peut être dans la tête du personnage ou à
l’extérieur. Il peut y avoir des personnages sans corps ou même avec, mais pas de la même
manière qu’au théâtre.
On a souvent l’impression de devoir se limiter à des successions de séquences intérieur-jour
et extérieur-nuit, alors que nous avons en réalité beaucoup de possibilités, autant qu’au
théâtre. À la radio, on a du mal à coloniser tout cet espace là. Quand ont été enregistrées les
premières fictions, tout le monde croyait que c’était pour de vrai ; il y avait un effet de réel.
Dans l’écriture radiophonique, peut-être même qu’on a régressé par rapport à une époque
durant laquelle on pouvait l’envisager, à la manière du théâtre, comme un champ de
possibles, sans limitation, sans borne. Cela tient pour moi au mode de production, au temps
que l’on passe à écrire, à l’ordre dans lequel on fait les choses – écrire, produire, enregistrer
–, la place de l’improvisation ou pas, le travail avec les comédiens… Au théâtre, l’écriture
dramaturgique ne veut parfois plus dire grand chose : on ne sait plus qui écrit ; certaines
créations sont collectives, avec 12 personnes qui écrivent en même temps ; certaines parties
sont improvisées, d’autres non. Tout cela nourrit l’écriture théâtrale. À la radio, cela reste
encore difficile. Ce doit être possible, mais ça demande d’inventer des façons d’écrire qui
soient aussi des façons d’envisager l’art radiophonique en soi, avec sa spécificité, avec ce
qu’il est le seul à pouvoir faire.
Sophie-Aude Picon
Je suis complètement d’accord avec ce que vient de dire Benjamin. On manque un peu
d’imagination pour les écritures radiophoniques. Effectivement, c’est beaucoup plus proche
de l’écriture scénaristique que de l’écriture théâtrale. Il existe des textes dans lesquels nous
trouvons une espèce d’ubiquité, un personnage à l’intérieur de la tête duquel on est, avec
l’écriture de monologue intérieur, tout en étant dans un espace et pouvant passer d’un
espace à l’autre, par le travail des ellipses temporelles. Tout cela est formidable : on peut
faire très facilement à la radio, alors que c’est plus délicat au théâtre. J’ai toutefois
l’impression qu’on ne nous provoque pas accès au niveau de la réalisation, pour trouver des
solutions. Nous sommes prêts à imaginer, mais parfois nous en rajoutons un peu par rapport
aux textes qui nous sont proposés, parce que nous voulons tenter des choses… Nous venons

Les passerelles entre les dramaturgies pour le théâtre et pour la
radio : transcription d’un débat important
Découvrez d'autres articles sur ce sujet sur www.profession-spectacle.com | 4
d’arriver dans le métier, si bien que nous avons envie de tester, de découvrir, de travailler
avec nos équipes techniques qui sont parfois dans une petite routine, ce qui accentue notre
désir d’exploration.
Mon conseil aux auteurs : écrivez, inventez, imaginez, même l’impossible. C’est aussi
comme cela que le théâtre a bougé. Pensez à ce qui n’est pas possible et dites-vous que
peut-être cela l’est ; on verra alors ce qui se passera. C’est un vrai projet que de faire
bouger l’écriture radiophonique qui est encore trop semblable à elle du scénario.
Christophe Barreyre
Je ne suis ni réalisateur, ni metteur en scène, ni acteur ; je parle donc en tant que
producteur. Il faut aussi voir le côté pratique. Que ce soit la télévision, le cinéma, le théâtre
ou la radio, il faut déjà savoir dans quel espace cela va être joué et quel public nous voulons
toucher. Je suis d’entrée pragmatique ; nous sommes quand même obligés d’y penser. C’est
vrai que pour l’émission dont je m’occupe, « Affaires sensibles », qui est une case
particulière d’une chaîne particulière, nous sommes liés à une façon de faire. Est-ce que
dans cette manière de faire, il n’y a pas des possibilités différentes d’inventer, de casser, de
bouger ? Oui, certes, c’est évident. C’est vrai en réalisation comme en production. Mais on
est limité : dans un studio d’enregistrement, c’est le temps qui compte premièrement, à la
différence du théâtre qui englobe l’espace. À la radio, nous sommes dans un temps très
court ; il faut donc aller à l’essentiel. Mais l’essentiel ne doit pas utile, parce que l’utile peut
devenir très ennuyeux à terme.
La radio est formidable parce que l’espace qu’elle ouvre aux auditeurs est immense, de la
même manière que le cinéma et le théâtre. Je pense qu’en radio aujourd’hui, il y a une chose
importante, c’est le mouvement. Les acteurs qui viennent jouer n’apprennent pas par cœur
leur texte, donc ils bougent, avec leur rôle dans la main. J’aimerais beaucoup que les
acteurs se regardent davantage, voire se touchent davantage. On le fait déjà un peu dans
« Affaires sensibles ». C’est compliqué, parce qu’on n’a pas beaucoup de temps, parce que
cela demande un travail du micro… L’enjeu est de créer une dynamique.
Autre chose, et là je m’adresse aux scénaristes : on s’adresse à des gens en 2016 ; les gens
qui écoutent ont une oreille de 2016. Avant la fiction, ils ont écouté des tonnes de truc : de
la musique, des vidéos sur internet, etc. Ils ont cette oreille d’aujourd’hui. Donc si tout à
coup on leur balance autre chose, alors le temps qu’ils vont mettre à s’adapter sera trop
long ; ils n’iront pas jusqu’au bout de la fiction, on aura raté notre effet et notre effort. Il
faut parler d’aujourd’hui, ce qui n’est pas si difficile, comme le prouve le cinéma ; en radio,
ce devrait être également possible.

Les passerelles entre les dramaturgies pour le théâtre et pour la
radio : transcription d’un débat important
Découvrez d'autres articles sur ce sujet sur www.profession-spectacle.com | 5
L’écoute de la radio n’est d’ailleurs plus la même : nos auditeurs doivent comprendre vite et
bien où il est, car ils peuvent être en voiture, chez eux, etc. Il faut penser à cela. Il est
intéressant de constater qu’en podcasts, on n’écoute pas la même chose et de la même
manière. Les études sur le podcast sont intéressantes car nous savons non seulement
combien de gens écoutent, mais encore qui écoutent : depuis 4-5 moi, nous connaissons une
forte progression d’écoute des 20-27 ans. C’est tout de même intéressant de savoir cela :
quand on parle avec ces jeunes, on s’aperçoit qu’ils écoutent parce qu’ils commencent à
reconnaître des éléments qui, chez eux, ont un son qui les touche. C’est l’actualité du
langage, c’est la façon dont c’est mise en scène, enregistré, mixé…
Finissons par une comparaison sur la question du très contemporain. Au théâtre, le très
contemporain est-il traité par des tics ? Et si on n’opte pas pour la ressemblance, comment
s’y prend-on pour faire comprendre qu’il s’agit de la même personne ? Dernièrement a été
joué à La Colline Bettencourt Boulevard. Il n’y a pas plus actuel que cette affaire, et il est
important de questionner un fait d’actualité au théâtre : la question de la mise en scène est
alors centrale. À la télé, on est de plus en plus sur les séries politiques : Baron noir. Ce ne
sont pas des personnages existants, mais cela rappelle des personnages existants ; ce n’est
plus directement une copie de quelqu’un, mais on laisse un espace qui fait penser à
quelqu’un… En radio, la question se pose aussi. Si nous avions un jour envie, sur France
Inter, de traiter des fictions politiques, ce serait passionnant : on interroge le réel,
l’aujourd’hui de l’histoire. Est-ce qu’on le fait plus proche de Bettencourt – avec des
personnages réels dans une affaire réelle – ou du Baron noir, autour de personnages réels
mais qui sont inventés ? C’est une vraie question ; j’ignore quelle méthode marcherait le
mieux en radio. C’est pourquoi il nous appartient d’inventer, de trouver notre propre
langage. Cet exemple permet de montrer qu’entre chaque endroit, théâtre, radio, cinéma,
etc., il y a des questions à se poser : les espaces et les moyens financiers sont différents. Il
ne faut pas oublier qu’en radio, on travaille avec rien… et je trouve qu’on fait vraiment de la
qualité.
DU LIEN ENTRE LE TEXTE ET LA RÉALISATION RADIOPHONIQUE
Jean-Pierre Thiercelin
Ce qui est intéressant dans « Affaire sensibles », dans le fait de travailler avec Christophe
Barreyre et Pascal Deux, c’est le travail d’échanges : le producteur a presque un rôle
d’éditeur. L’enjeu est de prendre un moment clef. Il n’y a plus, comme avant, de narrateur
entre deux séquences. Nous essayons d’éviter l’amas d’informations. Le travail de l’auteur
en amont consiste en une recherche, une imprégnation de la personnalité ou de l’événement
traité pour en faire un travail de pure fiction et non une énumération de faits, comme une
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%