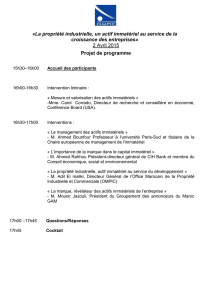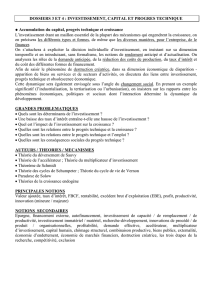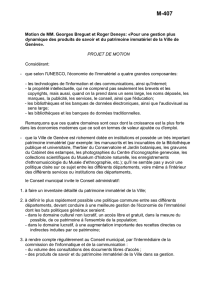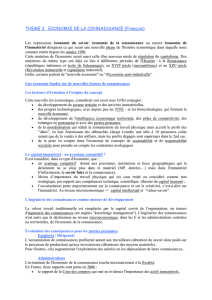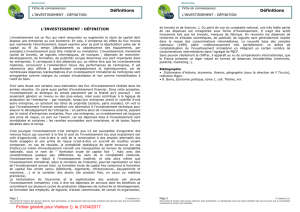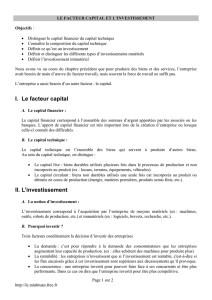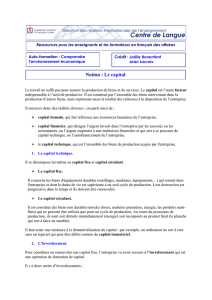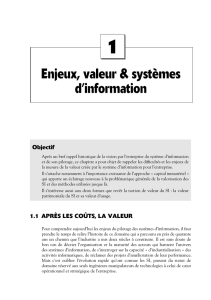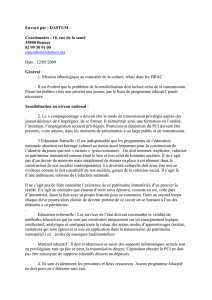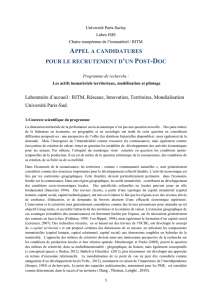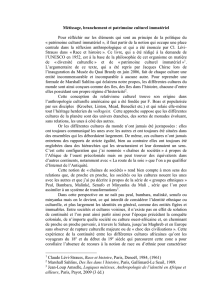Mettre enfin l`immatériel au service de la croissance

4eme trimestre 2009 •65
Mettre enfin l’immatériel
au service de la croissance
MarIe-ange andrIeux
Diecte de ptenit de Delitte
Diecte de l Tibne science P de l’écnmie de l’immtéiel
La crisepointedudoigt les limites d’une économie trop financiariséedans une courseeffrénée
auxprofits àcourt terme.Les fondamentaux d’une autrecroissancesontàconstruire en
intégrant mieuxles exigences de longterme de l’économie réelle qui,opportunément,
entrent en correspondanceavecunprofond changementdes besoins des consom-acteurs
et descitoyens,passés de l’«avoir plus»au «vivremieuxetautrement ».
Pour faire face à l’évolution présente et irréversible1,la croissance doit chan-
ger de nature:plus uniquement financière, elle se doit d’être également
équilibrée et équitable (allocation des richesses au sein des pays riches,
entre les pays développés, émergents et pauvres), verte (en réponse aux
enjeux climatiques et environnementaux), éthique (pour faire face à la recherche de
sens et limiter les risques de démobilisation ou de dérapages sociaux).
En conséquence,les racines de la croissance et de la compétitivité se déplacent du
capital technique et financier vers le capital immatériel, notamment des actifs imma-
tériels comme l’innovation et la connaissance.
Un facteur de croissance et de compétitivité
SelonleDictionnairedes scienceséconomiques, «l’investissementimmatériel se
définit comme un investissement intangible qui incorpore de manière durable une
1. Voir les travaux de la Tribune Sciences Po de l’économie de l’immatériel, dirigés par l’auteur et accessibles sur
easybourse.com ou deloitte.fr.

66 •S °66
Dss :é d ss
part de connaissance dominante dans le but de contribuer de manière spécifique ou
processuelle à la compétitivité et à la valeur de l’entreprise.»
D’après la Banque de France,«toute allocation de ressources d’une organisation ne
se concrétisant pas sous la formed’un bien physique et destinée à produire ses effets
pendant plus d’un cycled’exploitationoude production représenteuninvestisse-
ment immatériel. »
Ces approches esquissent plusieurs enjeux de l’économie de l’immatériel :
•l’investissement immatériel (définition par l’input) est évoqué comme contri-
buteur à la valeur durable,àla compétitivité long terme :l’essentiel serait alors
pour les agents économiques d’identifier et de maîtriser les processus qui per-
mettent àcette allocationderessources de générer un retour sur investisse-
ment, de devenir de la valeur immatérielle,ducapital immatériel et donc de
contribuer concrètement à la création de richesse ;
•pour éviter la critique (d’ailleursunpeu facile)du«ce quinesemesure pas
n’existe pas et ne se contrôle pas », on comprend l’utilité d’affiner les outils de
mesure–sans se cacher leurs limites –pour arriver àrendrevisible cet invisible
et mieux dimensionner l’impactdel’immatériel sur la croissance économique
et la valeur des entreprises commedes organisations(définitionpar l’output),
s’agissant d’organiser la reconnaissance de la collectivité économique et financière
quant au lien entrecroissance durable,compétitivité et actifsimmatériels.
Certes,les actifs immatériels sont progressivement identifiés par la communauté
économique et financière comme des facteurs de compétitivité représentant, au-delà
d’un atout pour des gains de part de marché de l’entreprise,un enjeu dans l’économie
de la connaissance.
Lestravaux de Solowfin 1980 ontlargement contribué au débat, en reconnaissant l’im-
pact d’un facteur endogène,infine de natureimmatérielle,pour expliquer une partsigni-
ficativededifférentiels de croissance entrepays.Déjà ThéodoreSchultz en 1961 écrivait :
«Bien qu’ilparaisse évident que l’on acquiertdes compétences et des savoirs utiles, on ne
semble pas accepter cette évidence que ces compétences et savoirs utiles sont une forme
de capital et que ce capital est, pour une partsubstantielle,lerésultat d’un investissement
délibéré. »Ses travaux ontété prolongés par GaryBecker dès 19642.
2. Tous deux ont obtenu le prix Nobel (respectivement en 1979 et 1992)… plus d’une vingtaine d’années après, ce
qui illustre peut-être le temps nécessaire à une idée pour s’incarner dans la conscience collective!

4eme trimestre 2009 •67
Mettre enn l’immatériel au service de la croissance
Paul Romer évoque (1986) les rendements croissantsliés àl’innovation, qui per-
mettent de soutenir la croissance (par compensation des rendements décroissants de
l’investissement matériel) voire de la catalyser (en fonction de la capacité d’accumu-
lation de l’innovation des acteurs économiques).
Des travaux de l’Insee,delaBanque de France et de l’OCDE ontanalysélelien entre
la croissance et l’investissement immatériel (dans la R&D,lecapital humain, les logi-
ciels, les activités commerciales), lequel contribuerait entre15%à90%de la crois-
sance de productivité,selonles analyses et les panels,
ainsi qu’au quartduPIB.Lacomptabilité nationale fran-
çaise aété aménagée avec la créationdu«PIB révisé »
intégrant les dépenses en logiciels, et prochainement la
R&D àl’instar de la comptabilité nationale américaine.
Une étude de l’OCDE sur la période 1994-2002 illustre la montée en puissance de
la connaissance dans les économies, certaines étant plus avancées que d’autres :
•la variation de l’investissement dans le savoir (R&D,éducation et logiciels) a
globalement augmenté plus rapidement que celle dans les machines, bien que
l’écart entre le rythme de progression de ces deux types d’investissement reste
encore limité pour l’Europe,notamment par rapport aux États-Unis ;
•les investissements dans le savoir en pourcentage du PIB ont dépassé (Finlande,
États-Unis) ou avoisiné (Suède) ceux dans les biens matériels.
En conclusiondeson étude,l’OCDEsouligne :«Le capitalhumain aunimpactsigni-
ficatifsur lesperformancesdel’économieetdes entreprises. L’évolution de la composi-
tiondelamain-d’œuvre joue un grandrôledanslacroissance de la productivité. »
L’Europe a reconnu le rôle de l’immatériel, en se fixant en 2000, lors du sommet de
Lisbonne,l’ambitiondedevenir un leader de la «knowledgeeconomy ». Volonté
réaffirmée àBarcelone en 2003, où est évoqué l’objectif d’atteindreen2010 un
investissement dans l’innovation équivalent à 3%du PIB européen… ce qui paraît
aujourd’hui peu réalisable !
Si l’économie de l’immatérielfigure au cœur de la stratégie de l’Europe de la
connaissance,le bilan, comme le constate le rapport Cohen-Tanugi3,est pour l’ins-
tant mitigé et l’Europe accuse un retard, notamment dans ses objectifs d’innovation.
3. Laurent Cohen-Tanugi, «Une stratégie européenne pour la mondialisation»,rapport d’étape,15janvier 2008.
l’vsss
bu
u qudu PiB.
l’vsss
bu
u qudu PiB.

68 •S °66
Dss :é d ss
De même,l’Union européenne reste largement distancée par les États-Unis pour
le nombre de brevets déposés ou les exportations de produits high-tech. D’autres
pays,conscients des enjeux, misent sur l’immatériel pour venir à la rescousse d’une
richesse en matières premières nonrenouvelablesdésormais limitée.Les Émirats
arabes unis, par exemple,ont engagé une démarche proactive en la matière (achat de
licences de marques publiques telle que le Louvre ou la Sorbonne) qui devrait leur
permettre d’asseoir leur croissance non plus sur l’or noir mais sur la matière grise
et de se construire un patrimoine immatériel national. Les pays émergents, les Bric
particulièrement, ont intégré ces enjeux et accélèrent leurs efforts dans l’immatériel.
LOIN DEVANT
Tableau1•Analyse comparéedelarépartitionet
de l’investissementencapital humaindanslemonde
Pays Répartition du
capital humain
Répartition de
l’investissement en
capital humain
États-Unis 27,5 %14,9 %
UE 25 16 %16,5 %
Autres pays avancés 11,9 %6,6 %
Bric 21,1 %34,1 %
Pays émergents 14,5 %16,2 %
Autres 9,5 %11,8 %
Source :Banque mondiale
Dès lors, comment arriver à capter en France et en Europe une meilleure part de
la croissance mondiale ? Rappelons que le taux de croissance du PIB (en volume
et moyenne annuelle sur 2003-2007)4s’est élevé dans les pays de l’OCDE à 3,8 %
alors que l’économie mondiale progressait de 4,8 %... et la Russie de 6,9 %, l’Inde
de 8,7 % et la Chine de 10,6 %!Sur les quinze dernières années, le poids relatif
dans le PIB mondial de la zone euro est passé de 18,9 % à 15,2 %, celui du Japon de
8,8 % à 6,4 %, alors que l’Inde passe de 4,4 % à 6,2 %, la Chine de 6,2 % à 15,8 %
et l’Asie de 17,5 % à 30,5 %, symbole d’un rattrapage des pays émergents qui ne
fait que commencer5.La mondialisation a conduit à une délocalisation des activités
d’abord à faible et désormais à forte valeur ajoutée.Pour rester compétitifs, les pays
développés doivent repousser les frontières de l’innovation!
4. Àl’exclusion de la période troublée actuelle,celle-ci ne modifiant pas fondamentalement les tendances moyennes.
Source :Economist Intelligence Unit.
5. Ces parts sont calculées en intégrant des calculs de parité des pouvoirs d’achat. Source :Rexecode.

4eme trimestre 2009 •69
Mettre enn l’immatériel au service de la croissance
Des actifs stratégiques
En paraphrasant le célèbre théorème d’Helmut Schmidt, on pourrait dire que les
investissements d’aujourd’hui dans l’immatériel sont les profits à long terme et les
emplois de demain. Lesenjeux sont considérables :enFrance,selonles experts,
jusqu’à 1%de croissance potentielle et 1 million d’emplois, si un ensemble de condi-
tions sont réunies et accompagnées d’une mobilisation globale de tous les acteurs.
Il est effectivement incontournable d’intégrer dans cette démarche, outre le secteur
marchand, le secteur non marchand, à la fois le secteur public, parapublic et privé
non lucratif (associatif,caritatif,humanitaire…).
La valeur des entreprises est d’ores et déjà majoritairement constituée d’actifs imma-
tériels,lacroissancedecertainssecteurs (services, industries pharmaceutiques et
agroalimentaires, luxe, NTIC, grande distribution…) étant plusdéterminée que
d’autres par l’immatériel.
La compétitivité et la croissance àlongterme des entreprises dépendent largement de
leur capacité àenrichir leur offre en exploitant leur capital immatériel, pour satisfaire
les besoinsimmatériels croissants que les consommateurs associent aux produits et
services mis sur le marché(santé,sécurité,savoir être, éthique,gain de temps, exigences
de développement durable,confiance…).
Concrètement, pour une entreprise,lacartographie du capital immatériel pourrait se
structurer autour des principales composantes suivantes :
•le capital structurel externe,d’abord, exprime la capacité de l’entreprise à créer
de la valeur et à la pérenniser dans ses relations avec ses partenaires extérieurs.
Il s’agit notamment du capital client, du capital marques, du relationnel – avec
les actionnaires, les parties prenantes de l’entreprise et plus généralement son
écosystème –, et de la capacité à travailler en réseau et avec les réseaux ;
•le capital structurel interne exprime,quant à lui, la capacité de l’entreprise à
créer et à pérenniser de la valeur au travers de son organisation et de ses sys-
tèmes d’information, de ses process, de son capital innovation, de son capital
créativité,de son risk management ;
•enfin, le capital humain exprime la capacité de l’entreprise àcréer et àpérenniser
de la valeur par sa forced’attractivité des compétences et des talents ciblés pour sa
stratégie et sa capacité àles fidéliser,laqualité de sonsavoir managérial, le potentiel
de créativité pour développer des produits ou des services répondant àl’attente des
clients, la capacité àtravailler en communauté d’intérêts et de pratique.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%