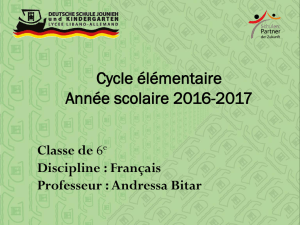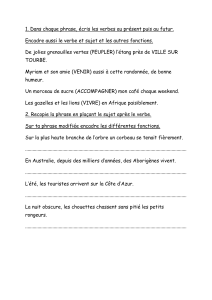1 À quoi sert la grammaire ?

G
R
A
M
M
A
I
R
E
102
1
À quoi sert la grammaire ?
Les objectifs
n Développer des compétences d’analyse de la langue (compétences métalinguistiques).
n Repérer les quatre grandes catégories grammaticales : noms, verbes, adjectifs, adverbes.
n Repérer les relations entre les mots par une pratique de la langue, sans formaliser les fonctions
grammaticales.
effet, si le texte 1 présente une situation « réaliste »,
le texte 2 « perturbe » les attentes conventionnelles :
les personnages ont changé de rôles (phrases 1 et 2) ;
les gants bleus deviennent le sujet et le chien l’objet
(phrase 3). Ces « perturbations » grammaticales per-
mettent une approche pertinente des rôles de sujet
et d’objet.
Il est nécessaire d’attirer aussi l’attention sur les éléments
communs aux deux textes (question 2) :
− aujourd’hui, par la fenêtre, dehors, vite q les
circonstances sont les mêmes.
− skier, regarder, enfiler q les actions sont les mêmes.
Je découvre
Dans la première activité, les illustrations prolongent
la démarche amorcée dans « J’observe ».
La seconde activité devrait donner l’occasion de
développer oralement les circonstances de ce départ
de paquebot : le ciel bleu, la ville, les immeubles…
Au tableau ou sur une affiche, les propositions des
élèves (« Je découvre » 1 et 2) devront être classées,
soit au fur et à mesure, soit dans un second temps :
ce dont on parle (le sujet), les actions (exprimées
par des verbes), des précisions apportées sur le sujet
(adjectifs) ou sur les circonstances indiquées par des
compléments circonstanciels (adverbes, GN…).
Pour aller plus loin
En binôme : deux élèves choisissent une phrase, par
exemple dans « Je m’exerce » 1 et 2 , dans laquelle ils
remplacent un mot (nom, verbe, adjectif ou adverbe)
par un mot de même catégorie. Puis deux binômes
échangent leurs phrases : un binôme entoure le mot à
changer ; l’autre binôme doit modifier le mot indiqué
en conservant la même catégorie grammaticale.
Vérification réciproque.
Les élèves pratiquent, sans qu’il soit indispensable
de nommer préalablement la nature grammaticale
du mot, des substitutions qui leur permettent de se
familiariser avec les catégories grammaticales.
Corrigés de tous les exercices p. 206
1. Voir dans l’introduction, « Quelle démarche pédagogique adopter ? », p. 25.
(pp. 165-166)
Repères théoriques
En matière de maîtrise de la langue écrite et
orale, l’élève a commencé en CE2 à structurer
sa perception des grandes catégories gram-
maticales et des fonctions essentielles dans la
phrase (sujet, complément). Au CM1, l’élève
poursuit cette structuration progressive.
La grammaire a toujours été conçue comme
une activité réflexive sur le fonctionnement
et sur l’usage de la langue. Cette activité sera
d’autant mieux perçue que les élèves en com-
prendront la finalité et les moyens, en référen-
ce aux activités de lecture et de production
d’écrits dans toutes les disciplines.
Tout comme les études dirigées permettent une
mise à distance, en les formalisant, de certaines
démarches méthodologiques, la question « À
quoi sert la grammaire ? » est l’occasion de
mettre à plat ce que l’on sait déjà avant d’aller
plus loin en matière d’analyse de la langue.
Dans cette séquence, on a choisi de mettre
l’accent sur les relations entre les mots d’une
phrase, d’un texte (relations syntagmatiques).
On pourra compléter cette approche avec des
activités de substitution (voir « Pour aller plus
loin ») de mots appartenant à la même caté-
gorie grammaticale : remplacement d’un verbe
par un autre verbe, d’un adjectif par un autre
adjectif, etc. (axe paradigmatique).
Commentaires et démarche1
À l’issue de cette séance, l’élève doit retenir le sens des
quatre classes grammaticales principales de la langue
(les noms, les verbes, les adjectifs et les adverbes).
Cette séance constitue un rappel des notions fonda-
mentales abordées en CE2, même si l’on y introduit
pour la première fois la notion d’adverbe.
J’observe
Les deux petits textes à observer permettent de déve-
lopper un questionnement sur le rôle des mots : en

103
G
R
A
M
M
A
I
R
E
2
Identifier une phrase simple
et une phrase complexe
Repères théoriques
Définition
La phrase se définit selon plusieurs critères :
– graphiquement, c’est un ensemble de mots
délimité par une majuscule au début et un point
à la fin ;
– phonétiquement, cet ensemble correspond à
une intonation qui varie avec le type de phrase ;
– sémantiquement, c’est une unité ayant un sens ;
– un quatrième critère insiste sur les relations des
mots entre eux (la syntaxe) et renvoie donc aux
fonctions grammaticales.
Dans la mesure où les phrases d’un texte ont
des relations entre elles et où l’analyse gram-
maticale est indissociable de la construction du
sens (anaphore qui renvoie à un antécédent, ex-
pressions diverses pour désigner un même per-
sonnage, etc.), il y a toujours avantage à déve-
lopper une approche textuelle de la grammaire.
(Rappelons que cette approche textuelle est
particulièrement développée dans la première
partie du manuel en lien avec l’expression écrite.)
La structure syntaxique
de la phrase simple
Elle est très diversifiée ; toutefois, au CM1, la
structure de la phrase simple à retenir est celle
d’une phrase affirmative : sujet + verbe + com-
plément/attribut (+ complément circonstanciel).
Exemple :
Le chat de la voisine aime la bonne cuisine.
sujet verbe COD
La structure syntaxique
de la phrase complexe
Une phrase est complexe dès lors qu’elle est
composée de plusieurs propositions. Quatre
types de composition sont possibles :
– la juxtaposition :
Les chiens aboient, la caravane passe.
– la coordination :
Les chiens aboient, mais la caravane passe.
– la subordination :
Les chiens aboient pendant que la caravane
passe.
– l’insertion : Les chiens, me dit-il, aboient.
Commentaires et démarche
Au CE2, les composants de la phrase simple (P q GN
+ GV) ont été analysés méthodiquement ; on peut
donc envisager au CM1 une approche progressive de
la phrase complexe. C’est l’objet des unités 8, 5, 12
et 15 de la progression grammaticale proposée.
Dans cette séquence, l’objectif est de repérer dans
chaque phrase le nombre de propositions. La
démarche proposée se réfère à l’unité constituante
de la phrase simple, c’est-à-dire au verbe. Il y a dans
la phrase complexe autant de propositions que de
verbes conjugués.
▲ Re m a R q u e : Même s’il n’y a aucune raison de
limiter la notion de verbe aux formes conjuguées
(les infinitifs et les participes peuvent constituer des
noyaux verbaux de propositions subordonnées), il
semble préférable, dans un premier temps à l’école
élémentaire, de s’appuyer sur le repérage des formes
conjuguées.
J’observe
Les questions posées ont pour objectif d’inciter à
construire le binôme « une action-une proposition »,
la recherche des verbes conjugués étant une démarche
relativement efficace à ce niveau du cycle 3.
Je découvre
Les activités de découverte et « Je m’exerce » 1
constituent des activités de repérage des propositions.
« Je m’exerce » 2 et 3 invitent les élèves à construire
la phrase à partir du noyau verbal, en se référant au
sens.
Pour aller plus loin
En binôme : deux élèves choisissent une phrase
complexe dans les textes lus ou produits en classe, la
recopient sur une bande de papier et la découpent en
propositions. Les binômes échangent leurs phrases
pour les reconstituer. Support possible : manuel, p. 6,
lignes 10-13 ; p. 8, lignes 2-4 et 20-21.
Corrigés de tous les exercices p. 206
L’objectif
n Identifier la phrase simple et la phrase complexe.
(pp. 167-168)
1
/
2
100%