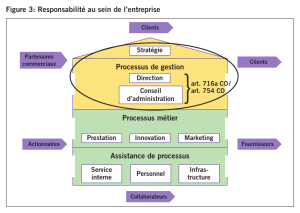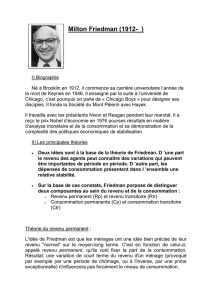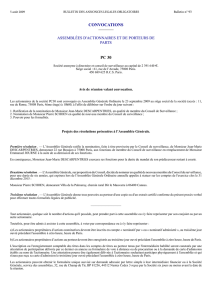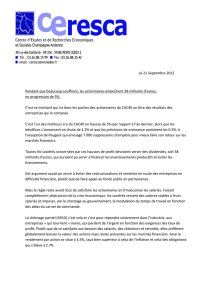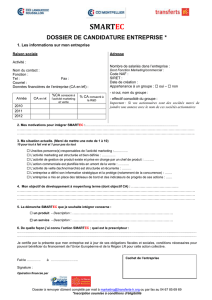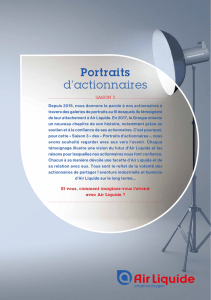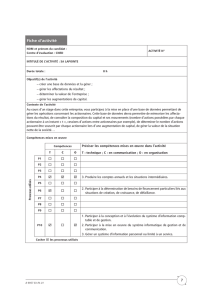retour sur un article de Milton Friedman

Responsabilité sociale des entreprises :
retour sur un article de Milton Friedman
Par Bernard Girard
Les cahiers de la CRSDD • collection recherche
No 04-2013

Bernard Girard Chercheur associé UQAM, 183 boulevard Saint-
Germain, 75007, Paris – [email protected]
Les cahiers de la CRSDD
Collection recherche • No 04-2013
Responsabilité sociale des entreprises : retour sur un article de Milton
Friedman
Par Bernard Girard
ISBN 978-2-923324-33-3
Dépôt Légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2013
École des sciences de la gestion
Université du Québec à Montréal
Case postale 8888, Succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3P8 Canada
http://www.crsdd.uqam.ca

Résumé en français et en anglais
L’article que Milton Friedman a publié en 1970 dans le New-York
Times a durablement affecté la réflexion sur la responsabilité des
entreprises. Il est aujourd’hui encore sans doute le papier le plus
cité dans ce domaine. Cet article affirme la prééminence de
l’actionnaire présenté comme le propriétaire de l’entreprise, une
thèse que d’autres économistes reprendront et approfondiront
par la suite mais à laquelle s’opposent vivement les juristes avec
d’excellents arguments. Ce qui amène à s’interroger sur la raison
d’être de ce texte. Obéit-il à des exigences théoriques propres au
champ de la théorie économique ou n’est-il qu’un instrument de
l’offensive néo-conservatrice et libérale dont Friedman fut l’un
des pionniers ?
The article Milton Friedman published in 1970 in the New York
Times has permanently affected the debate on corporate social
responsibility. It is still probably the most cited paper in this area.
It affirms the primacy of the shareholder presented as the
business owner, a thesis that other economists expanded later
on but that is strongly opposed by jurists with excellent
arguments. This brings to question the rationale of this text. Does
it obey theoretical requirements conditions specific to economic
theory or is it an instrument of the neo-conservative and liberal
revolution that Friedman promoted vigorously ?
Mots clefs : RSE, propriété, actionnaire – JEL K11
Keywords : CSR, ownership, shareholder – JEL K11


TABLE DES MATIÈRES
1. UN CONTEXTE HISTORIQUE AGITÉ .................................... 1
(2-1) AU-DELÀ DE L’ACTUALITÉ, UNE OFFENSIVE CONTRE LES
NOUVELLES THÉORIES DE L’ENTREPRISE ...................................... 3
(2-2) POURQUOI LES ACTIONNAIRES SERAIENT-IL PROPRIÉTAIRES ?
.................................................................................................. 8
(3-1) LA RISPOSTE DES JURISTES .............................................. 12
(3-2) LA RIGEUR TOUTE RELATIVE DES ÉCONOMISTES ................. 13
(3-3) UN GRAND ABSENT : L’ÉTAT ? ........................................... 17
CONCLUSION ............................................................................ 20
BIBLIOGRAPHIE ....................................................................... 23
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
1
/
30
100%