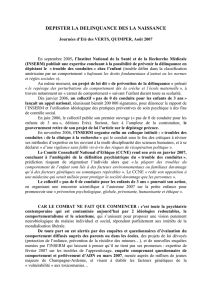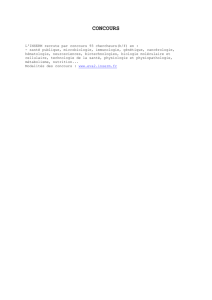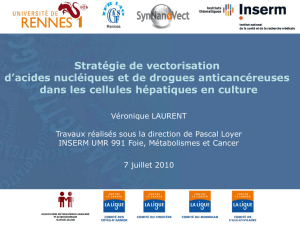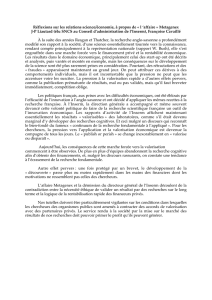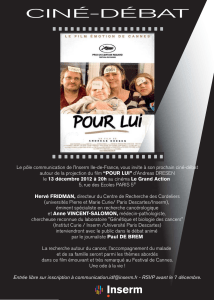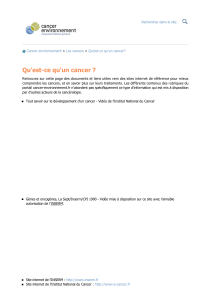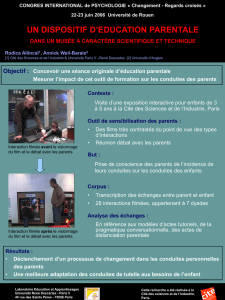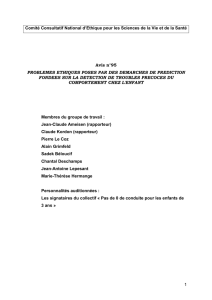Médicalisation des troubles de comportement : instrument de

CULTURE
ÉDUCATION PERMANENTE
EDUCATION PERMANENTE
ETHIQUE
Médicalisation des troubles
de comportement :
instrument de contrôle social
Médicalisation des troubles
de comportement :
instrument de contrôle social
Médicaliser délinqu 28/06/06 15:41 Page 1

Réalisation : Service Education permanente Question Santé asbl
Texte : Olivier Leroy
Secrétariat de rédaction : Isabelle Dossogne/Question Santé
Graphisme : Carine Simon/Question Santé
Avec le soutien de la DG Culture – Education permanente du Ministère de
la Communauté française
Editeur responsable : Patrick Tréfois - 72, rue du Viaduc – 1050 Bruxelles
D/2006/3543/11
2
Médicaliser délinqu 28/06/06 15:41 Page 2

Des actes de désobéissance, des colères ne sont pas des compor-
tements rares chez les enfants et adolescents. Pour certains
experts, qu’ils soient psychiatres, sociologues ou magistrats, ces com-
portements, selon leurs degrés de gravité et leurs fréquences, manifes-
tent des affirmations de l’identité ou résultent de difficultés familiales,
sociales ou environnementales.
Pour d’autres, leur origine est plutôt à rechercher dans un dysfonc-
tionnement organique, physiologique. Ces derniers préconisent donc
une médicalisation des comportements souvent qualifiés de
“ déviants ”, une option qui soulève de nombreuses questions : la
bonne ou la mauvaise conduite des enfants peut-elle ou doit-elle
être médicalement définie ? Le médecin ne risque-t-il pas dès lors
de devenir un instrument de contrôle social au service du poli-
tique ? S’agit-il de “ remettre dans le droit chemin ” ou de soigner ?
Des questions qui se posent avec d’autant plus d’acuité que la perte des
repères, le chômage endémique et la précarité de l’emploi que connaît
actuellement l’Europe semblent aller de pair avec une augmentation de
la délinquance. Il est donc légitime, dans ces conditions, de se deman-
der si la tentation n’est pas grande pour des gouvernements de médi-
caliser certaines conduites apparentées à la délinquance, ce qui,
sous couvert d’un alibi scientifique, leur permet de négliger la création
des conditions favorables à l’ordre public. Une démarche commode,
dans la mesure où l’Histoire montre que des médecins, notables et
simplement détenteurs d’un pouvoir sur autrui, se sont parfois prêtés
sans rechigner à ce type de pratiques. Mais aussi une démarche effica-
ce puisque l’avis et l’autorité du médecin sont généralement respectés.
La notion du «trouble des conduites »
Cette problématique des rapports qu’entretiennent à certaines époques
la médecine, et surtout la psychiatrie, avec le pouvoir politique vient
d’être ravivée en France à l’occasion de la publication par l’Institut
national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), à la veille de
la “ crise des banlieues ” de l’automne 2005, d’une expertise collec-
tive sur le “ trouble des conduites ” chez l’enfant et l’adoles-
3
Médicaliser délinqu 28/06/06 15:41 Page 3

cent(1). Un certain nombre de comportements, dont certains bénins et
d’autres plus graves, y sont considérés comme des symptômes caracté-
risant le trouble des conduites, lequel aurait des conséquences suffi-
samment importantes au niveau de l’individu et de la société pour que
soit envisagée une politique de prévention axée sur le dépistage et
la prise en charge précoce psychothérapeutique et médicamen-
teuse. La publication de cette expertise a d’emblée suscité un
tollé dans l’Hexagone, mais aussi un certain nombre de réac-
tions d’indignation en Belgique. Dès le lendemain de sa publica-
tion, le quotidien Le Monde titrait en première page : “ Les enfants
turbulents relèvent-ils de la médecine ? ” (2). En fait, le rapport va bien
au-delà de cette simple question, dans la mesure où l’on sent en fili-
grane, tout au long de sa lecture, que ce sont en fin de compte les com-
portements délinquants qui sont visés. Par son ambiguïté, la démarche
de l’Inserm crée donc un certain malaise. Quoi qu’il en soit, en faisant
du trouble des conduites et de la délinquance des problèmes relevant de
la médecine, une telle expertise collective apporte de l’eau au moulin
des politiques à tendance sécuritaire. Comme celle, musclée, souhaitée
par le Ministre français de l’Intérieur alors en exercice, Nicolas
Sarkozy, dont le discours sur les problèmes de société renvoie systé-
matiquement à la responsabilité individuelle.
Reste qu’à une époque où l’apathie et le consensus semblent générale-
ment de mise, le nombre et la véhémence des réactions à la publica-
tion de l’Inserm, qu’elles proviennent de spécialistes ou du grand
public, met du baume au cœur. Le citoyen ne semble pas encore
prêt à avaler la “ pilule d’obéissance ” (3) ni a fortiori à la faire
avaler à ses enfants.
Qu’entend-on par «trouble des conduites »
chez l’enfant et l’adolescent ?
Dans son expertise collective, établie par un groupe rassemblant diffé-
rentes compétences de la médecine (psychiatrie, épidémiologie, géné-
tique, neurobiologie, etc.), l’Inserm définit le trouble des conduites
4
Médicaliser délinqu 28/06/06 15:41 Page 4

chez l’enfant et l’adolescent comme un syndrome (4) caractérisé “ par
une palette de comportements très divers qui vont des crises de
colère et de désobéissance répétées de l’enfant difficile aux
agressions graves comme le viol, les coups et blessures et le vol
du délinquant ”. L’Institut souligne que le trouble des conduites se
caractérise avant tout “ par la répétition et la persistance de (ces)
conduites au travers desquelles sont bafoués les droits d’autrui et les
règles sociales ”. Pour cerner ce syndrome peu connu du grand public
en France et en Belgique et déterminer sa place dans le processus
menant à la délinquance, l’Inserm s’est basé sur une classification
comportementaliste anglo-saxonne, le DSM-IV (Diagnostic and sta-
tistical manual of mental disorder). Cette classification regroupe une
quinzaine de comportements ou symptômes regroupés en quatre caté-
gories principales (5). Si au moins trois comportements relevant de ces
catégories sont apparus au cours des douze derniers mois et un au
cours des six derniers, on est en droit, estiment les experts, de dia-
gnostiquer un trouble des conduites. Les études conduites de par le
monde estiment que 5 à 9% des garçons de 15 ans en seraient affec-
tés (le pourcentage est plus faible chez les filles et les formes agressives
très rares). En outre, deux tiers des enfants présentant un trouble des
conduites le présenteraient encore à l’adolescence. L’Inserm affirme
aussi que plus le trouble apparaît tôt (avant l’âge de dix ans), plus on
est en droit de s’attendre à une évolution de l’enfant vers une person-
nalité antisociale à l’âge adulte.
Colères et actes de désobéissance :
des “ maladies ” ou une manière d’affirmer son individualité?
À la lecture de la définition du trouble des conduites donnée par
l’Inserm, il est permis de s’interroger sur la validité de cette
notion elle-même, dans la mesure où elle s’appuie sur une
approche biologique de la psychiatrie centrée sur les symptômes
et les comportements, une approche très à la mode aux Etats-Unis
mais qualifiée de “ fourre-tout ” par les psychiatres d’orientation psy-
chanalytique. Dans un article collectif publié par Le Monde (6), certains
5
Médicaliser délinqu 28/06/06 15:41 Page 5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%