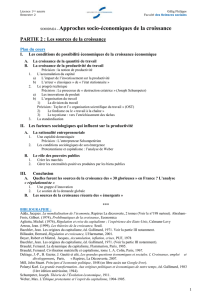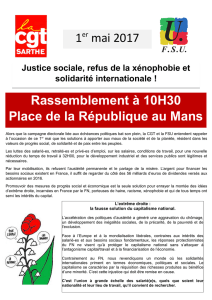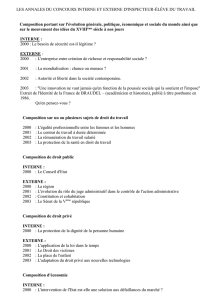Braudel F. : "La dynamique du capitalisme"

26/02/09 17:07Braudel F. : "La dynamique du capitalisme"
Page 1 sur 17http://www.cnam.fr/lipsor/dso/articles/fiche/braudel.html
LES FICHES DE LECTURE de la Chaire D.S.O.
CACHEUR Paul
LEBAS Romain
Mastère GIN
Economie Industrielle
Fernand Braudel
"La dynamique du capitalisme"
PLAN
I. L’Auteur : Biographie *
- Oeuvres principales *
- Biographies *
II. Introduction *
III. Questions posées par l’auteur *
IV. Postulats *
V. Hypothèses *
VI. Résumé *
Conférence n°1 : ‘En repensant à la vie matérielle et à la vie économique’
*
- La vie matérielle *
- Economie d’échange, économie de marché *
- Vie matérielle, vie économique et capitalisme *
Conférence n°2 : ‘Les jeux de l’échange’ *
- L’économie de marché *
- Le capitalisme *
- Le capitalisme, la société et l’état *
3eme conférence : ‘Le temps du monde’ *
- Economie mondiale et économie monde *
- Marchés nationaux et économies nationales *
- La révolution industrielle anglaise *
- Le Monde et le Capitalisme d’aujourd’hui à la lumière du Monde et du
Capitalisme d’hier *
VII. Commentaires et conclusions *

26/02/09 17:07Braudel F. : "La dynamique du capitalisme"
Page 2 sur 17http://www.cnam.fr/lipsor/dso/articles/fiche/braudel.html
I. L’Auteur : Biographie
Fernand Braudel (1902-1985)
Fernand naît en 1902 dans un petit village de la Meuse, Luméville-en-Ornois, à
une quarantaine de kilomètres au sud de Bar-le-Duc. Son père, instituteur en
région parisienne y a ses attaches familiales. De cette partie de la campagne
lorraine qu'il a tant aimé dans sa jeunesse et qu'il évoquera dans sa vieillesse, il
gardera la notion de l'importance de la vie quotidienne du peuple. "Je reste un
historien de souche paysanne", peut-il dire avec fierté.
Fernand est vite conscient du poids de l'Histoire dans cette région frontière et
c'est un garçon de 12 ans très patriote qui voit la guerre passer si près de la
région aimée.
"Au lieu d'avoir la France devant nous, autour de nous, nous, Lorrains, l'avons
derrière nous. Nous sommes adossés à la France." Le "nous, Lorrains" montre
l'attachement à ses racines. Son rêve de jeunesse est de faire une carrière de
professeur à Bar-le-Duc. "Si l'Université avait été gentille à mon endroit,
j'aurais été nommé en 1923 au lycée de Bar-le-Duc, j'y aurais fait toute ma
carrière". Son diplôme d'études supérieures est consacré à Bar-le-Duc pendant
les trois premières années de la Révolution
Braudel est attiré par la Méditerranée. Après son agrégation d'histoire en 1923,
le jeune professeur d'histoire ( il a 21 ans) ne peut obtenir de poste au lycée de
Bar-le-Duc et le hasard des nominations administratives l'envoie au lycée de
Constantine, dans l'Algérie française de l'époque. C'est la découverte de la
Méditerranée ! "J'ai passionnément aimé la Méditerranée, sans doute parce que
venu du Nord". Il a l'idée de sa thèse fondamentale : "La Méditerranée et le
monde méditerranéen au temps de Philippe II.". Cette thèse (plus de 1100
pages) est d'ailleurs, pour l'essentiel, rédigée en captivité. En effet, Braudel est
fait prisonnier en juin 1940 et passe tout le restant de la guerre dans des camps
de prisonniers en Allemagne. On peut imaginer les conditions de travail : pas
d'archives, peu d'échanges, un travail à partir de la mémoire des notes prises
avant la guerre. Il soutient sa thèse en mars 1947. Elle provoque un profond
bouleversement dans la manière d'écrire l'Histoire. Des apports fondamentaux :
une nouvelle conception de l'Histoire.
Si l'on voulait caricaturer le travail des historiens avant Braudel, on pourrait
insister sur leur attachement à la description des événements (d'où l'expression :
histoire événementielle). Braudel va introduire de nouveaux concepts. D'abord,
sa thèse est fondée sur une nouvelle partition du temps historique. Il distingue :
la longue durée (plusieurs siècles). Par exemple, le monde méditerranéen a des
constantes liées à son milieu géographique (climat, végétation),
l'histoire "lente" des groupes humains avec ses aspects économiques, sociaux,
culturels et l'histoire événementielle, au jour le jour, qui est plus le produit de

26/02/09 17:07Braudel F. : "La dynamique du capitalisme"
Page 3 sur 17http://www.cnam.fr/lipsor/dso/articles/fiche/braudel.html
l'histoire que sa productrice. On comprend que Braudel y attache moins
d'importance.
D'autre part, Braudel est un partisan fervent de l'interdisciplinarité des sciences
humaines et économiques. L'historien doit utiliser toutes les autres sciences pour
faire une histoire globale, dans la longue durée.
Ses conceptions seront mises en pratique par toute une génération d'historiens
formés par lui et qui porteront très haut la réputation de l'école historique
française. La revue ‘Les Annales’ sera le fer de lance de cette nouvelle
génération. Braudel va aussi se révéler un organisateur habile, voire despotique
au point de paraître, au soir de sa vie, en pleine gloire, comme un homme de
pouvoir, un mandarin universitaire, contrôlant avec soin ses créations, l'Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, la Maison des Sciences de l'Homme.
Braudel a vraiment marqué la pratique de l'Histoire, et dans les salles de classe,
on enseigne maintenant l'Histoire d'une manière très différente de celle qui
prévalait avant lui.
Dans la lignée de la célèbre Ecole des Annales*, instigatrice de toute
l'historiographie moderne, Fernand Braudel (1902-1985) a bouleversé la façon
de concevoir et d'écrire l'histoire. Puisant aux sources des différentes sciences
humaines - géographie et économie en tête -, et restituant à l'histoire humaine la
variété de ses rythmes, il a proposé une vision globale de l'Histoire dont le
rayonnement a dépassé les frontières de la France.
Disparu il y a quinze ans, Braudel est un de ces noms qui n'impressionnent pas
seulement les spécialistes mais aussi le grand public cultivé. Car si l'œuvre est
complexe, et riche de la prodigieuse mémoire de cet agrégé d'histoire qui
rédigea de mémoire sa thèse en captivité, elle développe une problématique
d'autant plus simple qu'une fois exposée elle paraît évidente.
L'histoire traditionnelle, jusqu'au début de ce siècle, s'organise autour des faits et
gestes des "grands hommes", personnalités politiques ou militaires, devenus des
héros de légende : Alexandre ou César, Gengis Khan, Louis XIV ou Napoléon.
Ces figures individuelles d'exception constituent l'échelle de l'histoire; lorsqu'ils
meurent, on change d'époque et souvent aussi de livres et d'auteurs.
Sans contester l'intérêt de ces récits, Fernand Braudel propose cependant de
déplacer le regard de l'historien. Sous l'oscillation rapide des événements à
dimension humaine, que l'historien compare aux rides de la surface de la mer,
F. Braudel cherche à naviguer, en eau profonde, afin de retrouver l'histoire plus
lente des groupes humains en rapport avec leur milieu, des structures qui
modèlent les sociétés, qu'il s'agisse des grandes routes du commerce et des voies
navigables, ou des mentalités.
Une histoire à "deux vitesses"
Avec lui, l'histoire change d'objet parce qu'elle change de temporalité. Au temps
rapide de l'événement, au souffle court et dramatique de la bataille, il substitue
le temps long des rythmes de la vie matérielle. Mais ce changement de
perspective le conduit aussi à repenser l'histoire. F. Braudel montre bien que

26/02/09 17:07Braudel F. : "La dynamique du capitalisme"
Page 4 sur 17http://www.cnam.fr/lipsor/dso/articles/fiche/braudel.html
l'histoire n'existe pas indépendamment du regard de l'historien. Ce dernier
intervient, comme dans tout savoir, à chaque étape de la constitution de
l'histoire, car il n'est pas d'histoire en soi, mais seulement des phénomènes
passés, engloutis dans la nuit d'un temps qui les dévore. La perspective adoptée
par F. Braudel le conduit à raconter une histoire qui ne fait plus seulement appel
aux témoignages et à la psychologie, mais à la géographie, à l'économie
politique, à la sociologie. Sur la palette de l'historien, F. Braudel dépose de
nouvelles disciplines qui sont comme de nouvelles couleurs : il introduit les
sciences sociales en histoire.
F. Braudel s'inscrit dans la lignée des historiens de l'Ecole des Annales qui
proposèrent de repenser l'espace-temps de l'histoire. Le Mahomet et
Charlemagne d'Henri Pirenne, la Société féodale de Marc Bloch, le Rabelais ou
le problème de l'incroyance au XVIe siècle de Lucien Febvre sont autant de
tentatives pour sortir l'histoire du cadre un peu étriqué du temps court. Mais à
cette dilatation du temps de l'histoire, F. Braudel ajoute encore le regard du
géographe.
Ainsi, dans la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II,
l'auteur s'intéresse d'abord au milieu dans lequel vivent les hommes du bassin
méditerranéen : montagnes et plaines, mer et fleuves, routes et villes. A ce
rythme presque immobile du "temps géographique", il combine celui, rapide, du
"temps individuel" et de la circulation des hommes et des idées.
Cette recherche le conduira à étudier les pôles d'activité humaine que sont
Venise, Milan, Gênes ou Florence, et leurs échanges entre elles, à faire l'histoire
du développement du capitalisme, des flux de communication et d'argent qu'il
induit, le déplacement des frontières qu'il entraîne, la modification même de la
structure de l'Etat qu'il détermine. L'horizon de cette incroyable reconstruction
de l'histoire est le monde, une histoire totale, peinte sur une toile géante.
Eric Maulin
* Née avec la revue des Annales d'histoire économique et sociale, l'Ecole des
Annales, fondée en 1929 par Marc Bloch et Lucien Febvre, rassemblait un
groupe d'historiens qui, rejetant l'histoire traditionnelle événementielle,
privilégiait la longue durée et cherchait à s'ouvrir aux autres sciences humaines.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'importance des Annales fut
reconnue avec la création de la VIe section de l'Ecole pratique des hautes études
confiée à Fernand Braudel.
Depuis les années 70, des historiens comme Georges Duby, Emmanuel Leroy-
Ladurie, François Furet ou Jacques Le Goff, poursuivent le projet
interdisciplinaire des fondateurs de l'Ecole des Annales, et s'appuient dans leurs
travaux sur l'anthropologie et la sociologie. Cette "nouvelle histoire" s'intéresse
particulièrement à l'histoire des mentalités.
Oeuvres principales
Ecrits sur l'histoire, éd. Flammarion, Paris, 1969, rééd. 1977.
La Dynamique du capitalisme, éd. Arthaud, Paris, 1985.

26/02/09 17:07Braudel F. : "La dynamique du capitalisme"
Page 5 sur 17http://www.cnam.fr/lipsor/dso/articles/fiche/braudel.html
L'Identité de la France, (3 vol.), éd. Arthaud, 1986.
Biographies
Fernand Braudel, Giuliana Gemelli, éd. Odile Jacob, Paris, 1995.
Braudel, Pierre Daix, éd. Flammarion, Paris, 1995.
II. Introduction
Avant toute chose, nous tenons à préciser que cet ouvrage représente une
réflexion intermédiaire entre deux ouvrages du même auteur. Ne les ayant pas
lu, la difficulté majeure que nous avons rencontré a d’abord été le manque de
recul par rapport aux références citées puis la non connaissance de nombre des
thèmes abordés dans ces mêmes ouvrages.
Ce livre reproduit le texte de trois conférences que Fernand Braudel fit à
l’université de Johns Hopkins aux Etats-Unis en 1976. Cette édition fut publiée
avant la sortie de son livre "Civilisation matérielle, Economie du capitalisme". Il
s’agit ici de la présentation de cet ouvrage.
III. Questions posées par l’auteur
Nous avons mentionné les principales questions posées par l’auteur dans le
résumé de l’ouvrage (partie : VI résumé).
IV. Postulats
Le marché caractérise la nature des objets entre
valeur d’usage : ce qui reste hors du marché
valeur d’échange : ce qui franchit la porte du marché
Le monde de l’échange se trouve strictement hiérarchisé : des métiers les plus
humbles jusqu’aux négociants capitalistes. Fernand Braudel oppose les trois
termes suivants : vie matérielle, vie économique et capitalisme.
- Vie matérielle : marquée par les balbutiements d’une économie d’échange
(1400 à 1800 en occident) qui réalise le lien entre production et consommation.
Une grande part de la production se perdant dans l’autoconsommation.
- Vie économique : marquée par une économie de marché organisant la
production et orientant (‘commandant’) la consommation et se distinguant en 2
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%