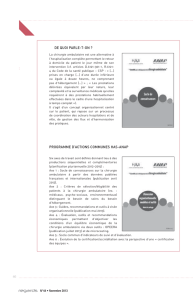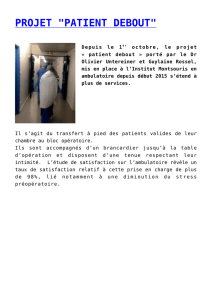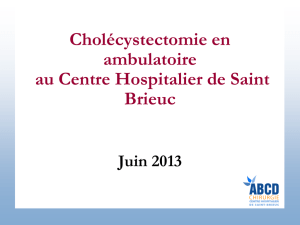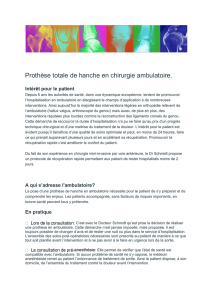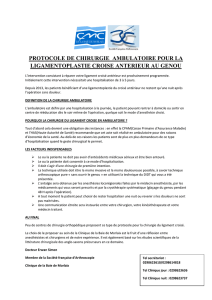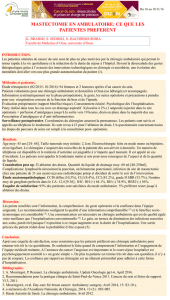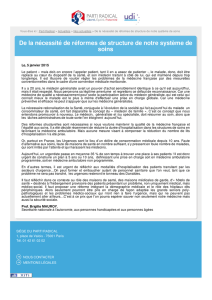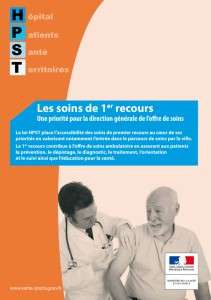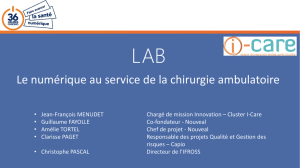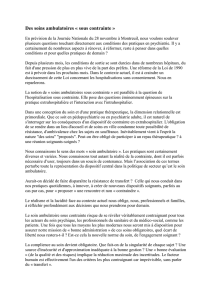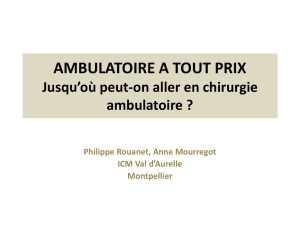Lire l`article complet

La Lettre du Sénologue - n° 36 - avril-mai-juin 2007
Dossier
Dossier
10
* Centre René-Gauducheau, Nantes.
Chirurgie sénologique oncologique en ambulatoire :
avantages et éléments limitants
Ambulatory procedure for breast cancer surgery: advantages and restrictive factors
IP F. Dravet, S. Robard, D. Labbe, R. Pioud, P. Peuvrel, J.-M. Classe*
La prise en charge ambulatoire de la chirurgie mammai-
re en France tarde à se développer, à l’opposé des pays
anglo-saxons qui utilisent préférentiellement ce mode
d’hospitalisation pour cette chirurgie. Au Centre Régional de
Lutte Contre le Cancer de Nantes, nous pratiquons la chirur-
gie ambulatoire depuis plus de 15 ans.
DÉFINITION
La chirurgie ambulatoire correspond à une alternative à l’hos-
pitalisation traditionnelle. L’accueil du patient, le geste opéra-
toire et sa sortie de la structure se font le même jour. Actuel-
lement, en France, les secteurs d’hospitalisation ambulatoire
sont ouverts pour une tranche horaire de 12 heures (1, 2). C’est
à différencier du système anglo-saxon (one day surgery) où les
structures sont ouvertes, même la nuit, mais l’hospitalisation
du patient est de moins de 24 heures consécutives.
Ces actes chirurgicaux sont programmés et à faible risque hé-
morragique (1-3). Actuellement, les principales activités réa-
lisées sous ce mode d’hospitalisation sont des gestes médico-
techniques, notamment les endoscopies.
LA CHIRURGIE SÉNOLOGIQUE ESTELLE FAISABLE
EN AMBULATOIRE ?
Dans les pays anglo-saxons, l’intégralité de la chirurgie séno-
logique est réalisée en ambulatoire, y compris les mastecto-
mies et certains gestes de reconstruction mammaire, mais le
contexte médico-économique est différent de la France.
Nous avons pris l’option, dans notre établissement, de réaliser
la chirurgie “conservatrice” du cancer du sein en ambulatoire,
mais d’exclure les chirurgies radicales (4, 5). Ce mode d’hospi-
talisation est proposé chaque fois que la patiente répond aux
critères d’éligibilité (ne pas être seule à domicile le premier
soir postopératoire, mais accompagnée d’un adulte, habiter à
moins de 100 km, avoir un téléphone fonctionnel au domi-
cile). Malgré cette politique incitative, une évaluation menée
dans notre service sur 18 mois a montré que le taux de chirur-
gie conservatrice réalisée en ambulatoire était globalement de
40,5 %. Ce taux varie en fonction du geste chirurgical réalisé et
de la complexité du circuit patient (figures 1, 2 et 3).
Figure 1.
Inuence de la simplicité du geste chirurgical sur le taux
d’ambulatoire. La diérence est statistiquement signicative.
Figure 2.
Inuence du geste ganglionnaire. Paradoxe : taux
chirurgie ambulatoire plus faible pour un geste plus simple. La
diérence est statistiquement signicative.
La chirurgie sénologique représente 21 % de notre activité de
chirurgie ambulatoire, les autres secteurs sont la pose de site
implantable pour chimiothérapie (76 %) (7), la gynécologie (2 % :
hystéroscopie, conisation), et des actes de radiothérapie (1 %).
Toute notre chirurgie mammaire est faite majoritairement sous
anesthésie générale, sauf la chirurgie mamelonnaire sous anes-
thésie locale. Nous pouvons proposer les curages axillaires en
ambulatoire grâce à une technique chirurgicale sans drainage (8).
Les principaux gestes de chirurgie sénologique
réalisables en ambulatoire (4-6, 8, 9)
Chirurgie à visée diagnostique : tumorectomie (TD), zonecto-

La Lettre du Sénologue - n° 36 - avril-mai-juin 2007
Dossier
Dossier
12
mie après repérage préopératoire pour des lésions infraclini-
ques (Z).
Chirurgie à visée thérapeutique : tumorectomie avec dé-
tection du ganglion axillaire sentinelle (TGAS), tumorectomie
avec curage, zonectomie avec détection du ganglion axillaire
sentinelle (ZGAS), zonectomie avec curage, reprise des ber-
ges, curage de complément.
ÉLÉMENTS ORGANISATIONNELS
L’hospitalisation en ambulatoire réduit de manière importante la
durée de l’hospitalisation. Cela impose une organisation rigou-
reuse et une segmentation de la prise en charge. Certains élé-
ments sont capitaux, notamment en cas de chirurgie sénologique
oncologique où le circuit patient est souvent multidisciplinaire.
Chronologiquement
Diagnostic préopératoire
Actuellement, il est fortement recommandé d’opérer les pa-
tients avec un diagnostic préopératoire, permettant ainsi une
meilleure organisation des soins et, notamment, une diminu-
tion des réinterventions chirurgicales pour complément d’exé-
rèse glandulaire ou curage ganglionnaire.
Ce diagnostic peut être porté au mieux par microbiopsie
percutanée en cas de lésions nodulaires ou par biopsie
par aspiration en cas de microcalcifications. Ces prélè-
vements sont fait en externe sous anesthésie locale.
L’élément primordial de ce diagnostic préopératoire est de
pouvoir informer, de manière précise, la patiente sur sa mala-
die et sur l’acte chirurgical prévu avec les effets indésirables at-
tendus en postopératoire immédiat, notamment la douleur.
Consultations couplées
Nous faisons en sorte que les consultations préopéra-
toires chirurgie-anesthésie soient couplées, afin que les
médecins anesthésistes confirment en temps réel la va-
lidation du mode ambulatoire de la prise en charge. Quand la
notion d’ambulatoire est confirmée, le médecin traitant et le
gynécologue médical en sont informés.
Prise de rendez-vous préopératoire
L’organisation en amont, dès la consultation, est indispensable
pour le bon déroulement de la prise en charge du patient et
de son circuit (tableaux I et II). La plus complexe est celle
d’une patiente qui doit être opérée d’un cancer infraclinique
pour lequel nous prévoyons de réaliser une zonectomie avec
détection de GAS. Cette situation clinique devient plus fré-
quente grâce au dépistage. Il faut donc prévoir le rendez-vous
de repérage préopératoire, celui de médecine nucléaire pour
l’injection du produit isotopique, ainsi que l’examen extempo-
ranée pour l’analyse peropératoire du ganglion sentinelle.
Visite d’autorisation de sortie
Elle est obligatoire et indispensable et doit être réalisée par le
médecin anesthésiste et le chirurgien. Elle permet de confirmer
la sortie ou, au contraire, de convertir en hospitalisation tradi-
tionnelle pour surveillance soit pour raisons médicales (nausées,
vomissement, douleur), soit pour raisons chirurgicales : héma-
tome nécessitant parfois une reprise chirurgicale. Cette notion
de conversion du séjour ambulatoire en séjour traditionnel est
à prendre en compte dans l’organisation d’un projet de mise en
place de l’ambulatoire, car cela suppose d’avoir des lits disponi-
bles dans le secteur traditionnel (5).
Documents de sortie
Les patientes sortent systématiquement avec ordonnances,
compte-rendu opératoire, lettre pour le médecin traitant, ren-
dez-vous postopératoire. Dans notre pratique, nous donnons
également, à titre systématique, une plaquette d’antalgiques
pour simplifier leur retour à domicile (10).
Appel du lendemain
Nous avons mis en place, depuis trois ans, un appel téléphoni-
que systématique du lendemain. L’infirmière chargée du secteur
ambulatoire appelle les patientes chez elle le lendemain matin
pour savoir si “tout va bien”, reformuler les consignes de sécurité
et vérifier que les patients ont bien eu tout leurs documents et
Tableau I.
Circuit patient comparatif entre chirurgie ambulatoire et tradition-
nelle : exemple tumorectomie avec détection ganglion axillaire sentinelle
(TGAS).
Chirurgie ambulatoire Chirurgie traditionnelle
Heure arrivée à l’hôpital 7 h 30 13 h 00 la veille
Heure injection produit isotopique 9 h 00 14 h 00
Lymphoscintigraphie Non Oui : 16 h 00-17 h 00
Heure de la chirurgie 11 h 00 Le lendemain matin
Heure retour en chambre 15 h 00-16 h 30 12 h 00-15 h 00
Heure départ hôpital 18 h 00-19 h 00 Le lendemain entre 10 h 00-11 h 00
Durée globale d’hospitalisation < 12 heures 48 heures
Figure 3.
Inuence de la complexité du circuit patient sur le
taux d’ambulatoire.
Un intervenant : chirurgien seul. Deux intervenants : chirurgien + médecin nucléaire ou chirurgien +
radiologue. Trois intervenants : chirurgien + médecin nucléaire + radiologue.

La Lettre du Sénologue - n° 36 - avril-mai-juin 2007
Dossier
Dossier
13
rendez-vous. Cet appel a été ressenti comme une continuité de
soins aussi bien par l’infirmière que par la patiente et sa famille.
Consultation postopératoire
Elle est indispensable et programmée entre J7 et J15. Elle a
pour but de compléter l’information des patientes en leur
communiquant leurs résultats définitifs et en organisant leurs
traitements complémentaires (chimiothérapie, radiothérapie,
hormonothérapie). Cette consultation est primordiale et s’in-
tègre dans le dispositif d’annonce.
POINTS FORTS
La chirurgie du sein en ambulatoire s’intègre complètement
dans le contexte de l’alternative à l’hospitalisation pendant les
traitements. Actuellement, les traitements de chimiothérapie
sont réalisés en hôpital de jour sur quelques heures, la radiothé-
rapie est faite en consultation externe. Cela permet une dimi-
nution de la rupture socio-professionnelle et familiale due aux
traitements.
La chirurgie ambulatoire sur le même principe doit être propo-
sée aux patientes, mais non imposée. Pour certaines femmes,
une hospitalisation courte (2 à 3 jours) peut être une période de
répit ou de sécurité que nous devons respecter. C’est pour cette
raison que toutes nos patientes éligibles pour l’ambulatoire ne
sont pas systématiquement programmées en ambulatoire.
Nous avons évalué à plusieurs reprises l’indice de satisfaction
de ce mode d’hospitalisation. Il a toujours été très bien perçu
avec des taux de satisfaction élevés supérieurs à 9/10 (10).
Le séquençage de la prise en charge des patientes s’intègre
bien dans le dispositif d’annonce et permet aux patientes de
mieux appréhender leur maladie et leurs traitements, laissant
ainsi, paradoxalement plus de temps pour comprendre et in-
tégrer l’information reçue.
ÉLÉMENTS LIMITANTS
Actuellement, il demeure des éléments limitatifs au dévelop-
pement de l’ambulatoire.
Figure 4.
Inuence du bassin de recrutement sur le taux de
chirurgie ambulatoire : bassin de recrutement du Centre René-
Gauducheau.
29 % patientes au-delà des 100 km. Si on exclut ces patientes, le taux d’ambulatoire passe de 40,5 %
à 57 %.
Tableau II.
Circuit patient en cas d’organisation mixte : exemple zo-
nectomie avec repérage et détection ganglion axillaire sentinelle
(ZGAS).
Patiente “proche”
Ambulatoire : 12 h
Patiente “éloignée”
Ambulatoire < 24 h
Heure d’arrivée à l’hôpital 7 h 30 9 h 30
Injection produit isotopique La veille en externe 10 h 00
Repérage La veille en externe 11 h 00
Heure de la chirurgie 8 h 00 Après-midi
Heure retour en chambre 12 h 00 Fin d’après-midi
Heure départ hôpital 18 h 00 Le lendemain entre
8 h 00-9 h 00
Durée globale d’hospitalisation < 12 heures 24 heures
Éloignements de l’hôpital
Ce facteur peut être prépondérant pour des établissements comme
le nôtre, à bassin de recrutement étendu. Ce facteur est moins im-
portant pour des hôpitaux de proximité. Pour notre expérience , si
on exclut les patientes au-delà de 100 km, notre taux d’ambulatoire
passerait automatiquement de 40,5 % à 57 % (figure 4).
Vieillissement de la population
Au-delà de 70-75 ans, l’hospitalisation en ambulatoire peut
poser plus de problème, car les femmes sans conjoint sont
plus nombreuses, ainsi que les contre-indications d’ordre mé-
dicale plus fréquentes pour pratiquer la chirurgie ambulatoire.
Toutefois, l’impact de cet élément sur la chirurgie sénologique
en ambulatoire est à pondérer, car le pic d’incidence des can-
cers du sein est entre 55 et 65 ans.
Complexité du circuit patient
Aujourd’hui, le dépistage organisé fait que la situation la plus
fréquemment rencontrée est une petite tumeur infraclinique qui
relève d’une zonectomie avec repérage et détection du GAS. Le
paradoxe de cette situation (plus propice à une prise en charge en
ambulatoire, car le geste chirurgical est plus simple avec un faible
risque hémorragique) est qu’elle est plus complexe à mettre en
place. Elle fait intervenir “plusieurs acteurs” : imagerie pour le re-
pérage, médecine nucléaire pour le GAS et, bien sûr, chirurgie et
anesthésie. Nous avons constaté cela dans notre service, pourtant
habitué à l’ambulatoire. Le taux d’ambulatoire passe de 30,5 % en
cas de tumorectomie avec curage axillaire (deux intervenants : le
chirurgien et l’anesthésiste) à 14,7 % en cas de zonectomie avec
repérage du GAS (quatre intervenants : le chirurgien, le radio-
logue, le médecin nucléaire et l’anesthésiste) (figure 3). Ce taux
s’est amélioré par un travail organisationnel inter-services.

La Lettre du Sénologue - n° 36 - avril-mai-juin 2007
Dossier
Dossier
14
Problème tarifaire
Ce critère non médical mais administratif reste également, en plus
de la volonté des équipes, un élément déterminant pour le déve-
loppement de l’ambulatoire. La tarification actuelle n’est pas très
incitative pour les structures hospitalières publiques financées par
le forfait du GHM. L’acte principal a été revalorisé, mais les actes
associés réalisés le même jour ne sont pas rémunérés. Deux exem-
ples très parlants : en cas de ZGAS, le repérage préopératoire et
l’injection isotopique ne sont pas pris en compte s’ils sont effectués
le même jour. De même, si un patient a la pose d’un site implanta-
ble et sa première cure de chimiothérapie le même jour, une seule
prise en charge est financée et c’est la pose du site qui n’est pas
comptabilisée. Ceci est pénalisant pour l’établissement, mais aussi
pour la patiente qui pourrait être amenée à faire deux séjours pour
que l’établissement obtienne une rémunération des deux actes.
QUE FAUTIL ENVISAGER POUR L’AVENIR ?
Développer la politique d’information médicale
et grand public
L’information grand public, mais aussi des médecins de ville, des
gynécologues, sur les possibilités de réaliser certains actes en am-
bulatoire est indispensable pour le développement de ce mode
d’hospitalisation. La chirurgie sénologique s’y prête bien. L’infor-
mation en amont de la prise en charge est primordiale notam-
ment auprès des médecins généralistes et des gynécologues.
Passage à un système anglo-saxon ou tout au moins mixte
Devant une prise en charge plus complexe à organiser, il sem-
ble intéressant que la classique hospitalisation ambulatoire
de 12 heures puisse évoluer vers un mode anglo-saxon où la
chirurgie ambulatoire (one day surgery) est, en fait, une hospi-
talisation de moins de 24 heures. Le secteur d’ambulatoire est
donc ouvert 24 heures sur 24. Cela permet de mieux étaler les
préparations et la surveillance postopératoire des patientes.
Une chirurgie peut donc ainsi être facilement réalisée l’après-
midi avec une sortie le lendemain matin, ce qui explique en
partie un taux de chirurgie ambulatoire plus important qu’en
France. Actuellement, l’évolution de la tarification va dans ce
sens puisque : une hospitalisation de moins de 12 heures ou
avec une nuit est assimilé à de l’ambulatoire. Néanmoins, la pro-
blématique demeure, car un établissement ne peut pas, pour
des raisons de rentabilité, laisser un service ouvert la nuit avec
du personnel pour un faible nombre de patients. Cet élément
est un véritable enjeu dans l’avenir pour le développement de
l’ambulatoire. Cela permettrait une meilleure organisation en
chirurgie sénologique où le circuit patient n’est pas toujours
simple et mono-disciplinaire. De même, la prise en charge des
patientes habitant loin de l’hôpital (au-delà des 100 km) serait
plus facile. La meilleure situation serait probablement un mo-
dèle mixte, tenant compte essentiellement de l’éloignement du
domicile (tableau II). Les patientes habitant près de l’hôpital
pourraient avoir une hospitalisation ambulatoire de moins de
12 heures et celles habitant loin, au-delà des 100 km, une hospi-
talisation ambulatoire de moins de 24 heures.
Élargir les indications opératoires
On peut évoquer un élargissement des indications. Actuelle-
ment, dans les pays anglo-saxons, les chirurgies radicales et
certaines reconstructions sont faites en ambulatoire. Toute-
fois, il ne faut pas “brûler les étapes”. Plus que de vouloir élargir
les indications, il semble préférable d’inciter les autres centres
hospitaliers français à faire de la chirurgie sénologique en am-
bulatoire. La chirurgie sénologique conservatrice se passe très
bien en ambulatoire. C’est avant tout celle-ci qu’il faut promou-
voir en routine. Pour l’avenir, nous devons ensemble affiner les
indications en tenant compte des conditions médicales, mais
aussi psychosociologiques. Le “tout en ambulatoire” en chirur-
gie sénologique oncologique pour l’avenir ne doit pas être un
dogme. Dans le contexte psychologique particulier de la cancé-
rologie, l’ambulatoire doit être proposée et non imposée.
CONCLUSION
La chirurgie sénologique en ambulatoire est bien acceptée par les
patientes. Elle évite une séparation familiale trop longue et entre
dans le concept d’alternative à l’hospitalisation pour le traitement
des cancers du sein. Les modalités d’hospitalisation en ambula-
toire méritent probablement d’être revues pour s’adapter à la fois
à un circuit patient plus complexe, multidisciplinaire, et à une
prise en charge de patientes éloignées. Ensemble, nous devons
définir au mieux les indications réalisables dans de bonnes condi-
tions médicales et psychosociologiques. n
RéféRences bibliogRaphiques
1. Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière. Journal
Officiel du 2 août 1991.
2. Décret n° 92-1102 du 2 octobre 1992 relatif aux conditions techniques
de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les structures de soins
alternatives à l’hospitalisation. Journal Officiel du 8 octobre 1992.
3. Chung F. Recovery pattern and home-readiness after ambulatory sur-
gery. Anesth Analg 1995;80:130-4.
4. Guihard P, Dravet F, Ricaud-Couprie M, Doutriaux-Dumoulin I,
Classe JM. La prise en charge chirurgicale des lésions mammaires non
palpables en ambulatoire. J Gynecol Obstet Biol Reprod 1999;28:330-4.
5. Dravet F, Belloin J, Dupré PF et al. Place de la chirurgie ambula-
toire en chirurgie sénologique. Étude prospective de faisabilité. Ann Chir
2000;125:668-76.
6. Dravet F, Dupré P, Peuvrel P et al. La chirurgie du sein peut-elle se
faire en ambulatoire, en France ? J Le Sein 2001;11,1-2 :161-6.
7. eard JL, Robard S. Outcome of usage protocols on implantable de-
vices. Ann Fr Anesth Reanim 1995;14(6):534-5.
8. Classe JM, Dupré PF, François T, Robard S, eard JL, Dravet F.
Axillary Padding as an alternative to closed suction drain for ambu-
latory axillary lymphadenectomy. A prospective cohort of 207 patients
with early breast cancer. Arch Surg 2002;137:169-73.
9. Athey N, Gilliam AD, Sinha P, Kurup VJ, Hennessey C, Leaper
DJ. Day-case breast cancer axillary surgery. Ann R Coll Surg Engl
2005;87(2):96-8.
10. Marchal F, Dravet F, Classe JM et al. Postoperative care and patient
satisfaction after ambulatory surgery for breast cancer patients. EJSO
2005;31:495-9.
1
/
4
100%