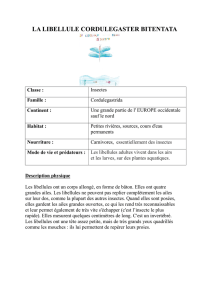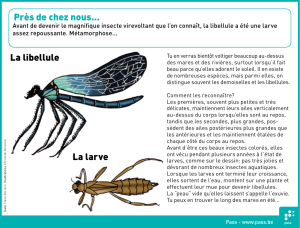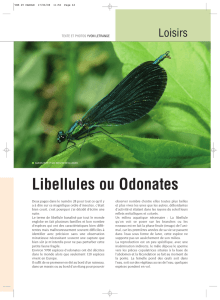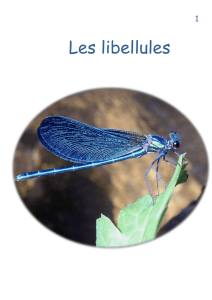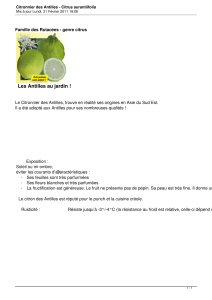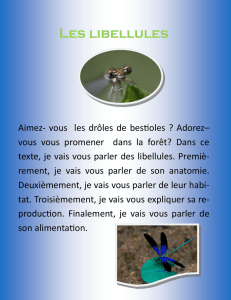Les Libellules des Petites Antilles, une diversité insoupçonnée

ESPÈCES №2 - Décembre 2011 ESPÈCES №2 - Décembre 2011ESPÈCES №2 - Décembre 2011
Biologie
RECHERCHE - Entomologie Herpétologie Géologie Entomologie Mycologie Phylogéographie Primatologie Microbiologie Paléontologie - Libellules
Archéozoologie Ichty
Libllules
des Petits Antilles Une diversité
insoupçonnée
D
,
.
M P A
, ’
,
’ ,
, ’
C D,
’
’
. O
, ’,
’
, ’ ’
.
Par François Meurgey est entomologiste
et Céline Poiron est entomologiste et cartographe
Société d’Histoire naturelle L’Herminier, Muséum
d’Histoire Naturelle, 12, rue Voltaire 44 000 Nantes, France
Les libellules, ou Odonates, constituent un ordre
d’insectes relativement peu nombreux. On en compte
environ 5 500 espèces actuellement dans le monde
(il existe environ 300 000 espèces de Coléoptères). Ces
espèces se répartissent en deux sous-ordres, les Zygoptères
ou “demoiselles”, et les Anisoptères ou “libellules”. Les
Zygoptères regroupent 18 familles, tandis que les Anisoptères
sont répartis en 11 familles environ.
En raison de leur beauté et de leur biologie originale (vie
larvaire aquatique et vie adulte terrestre), les Odonates ont
suscité, depuis une trentaine d’années, l’intérêt de nombreux
entomologistes amateurs ou professionnels. Aussi, cet ordre
d’insectes est l’un des mieux connus, surtout, il est vrai,
dans les pays où les prospections ont été suffisamment
nombreuses. C’est le cas de la France métropolitaine qui
possède une faune odonatologique relativement bien étudiée,
tant du point de vue de sa classification que de sa biologie
et de sa répartition. Celle-ci comporte environ 90 espèces,
appartenant à 4 familles de Zygoptères (Calopterygidés,
Lestidés, Platycnemididés, Coenagrionidés) et 6 familles
d’Anisoptères (Aeshnidés, Gomphidés, Cordulegastridés,
Macromiidés, Corduliidés et Libellulidés).
Mais, en dépit de l’intérêt désormais bien établi des libellules
dans la compréhension et la gestion des zones humides, il est
Legende

ESPÈCES №2 - Décembre 2011 ESPÈCES №2 - Décembre 2011
Biologie
RECHERCHE - Entomologie Herpétologie Géologie Entomologie Mycologie Phylogéographie Primatologie Microbiologie Paléontologie - Libellules
Archéozoologie Ichty
curieux de constater que ces insectes n’ont pas (ou très peu)
fait l’objet d’études dans les Antilles, qui font pourtant partie
des 34 “hot spots” de la biodiversité mondiale.
De nombreuses îles les et îlots à prospecter
La Société d’Histoire naturelle L’Herminier et le Muséum
d’Histoire naturelle de Nantes se sont engagés conjointement
dans un vaste programme de recherche visant à mieux
connaître la diversité des libellules des Petites Antilles. La
première étape de ces recherches a été d’établir un inventaire
des espèces dans chacune des îles de l’archipel, une base
indispensable pour ensuite caractériser les habitats dans
lesquels se développent leurs larves. Ce sont ces informations
qui permettent ensuite de définir des degrés de rareté, de
menaces et les mesures de gestion ou de conservation à
mettre en place.
Ces recherches ont permis d’estimer la faune odonatologique
des Petites Antilles à 49 espèces, diversement réparties sur la
quinzaine de grandes îles et les très nombreux petits îlots
inhabités que compte l’archipel. Ces espèces se répartissent
en 5 familles : 3 Lestidés, 2 Protoneuridés (famille de petites
et délicates demoiselles non représentée en Europe), 7
Un peu de biogéographie
Le domaine biogéographique néotropical, auquel appartiennent
l’Amérique du Sud, une partie de l’Amérique Centrale et du Nord, et
l’arc antillais, compte aujourd’hui environ 1 650 espèces de libellules
et la diversité y est telle que de nouvelles espèces sont décrites chaque
année dans les revues scientiques. L’odonatofaune des Antilles se
compose actuellement de 114 espèces (respectivement 98 et 49
espèces pour les Grandes et les Petites Antilles) parmi lesquelles une
importante proportion d’endémiques. Les îles des Petites Antilles ont
vu se développer au l du temps une faune et une ore qui leur sont
spéciques et, à beaucoup d’égards, uniques au monde.
Mais comment sont-elles parvenues à coloniser ces îles ? C’est l’objet
de la biogéographie, branche de la géographie et de l’écologie qui
étudie la vie à la surface du globe par des analyses descriptives et
explicatives de la répartition des êtres vivants, et plus particulièrement
des communautés d’êtres vivants.
Les îles qui composent les Petites Antilles sont les plus éloignées
des foyers de dispersion que sont l’Amérique du Sud et les Grandes
Antilles. Pourtant, comme l’a constaté Charles Darwin, la plupart des
espèces insulaires entretiennent des liens de parenté étroits avec les
espèces des îles voisines et du continent le plus proche. La théorie
de la biogéographie insulaire prétend que la richesse en espèces
d’une île dépend de sa taille et de son éloignement par rapport à
un continent. Plus une île est grande et proche d’un continent, plus
son peuplement est important en terme d’espèces. Le continent est
considéré comme un “réservoir d’espèces” et le peuplement de l’île se
fait au gré de l’immigration.
Ainsi, la Guadeloupe avec une supercie de 1 434 km² accueille
l’odonatofaune la plus riche des Petites Antilles avec 38 espèces
d’Odonates (78 %, n = 49). La Martinique, moins éloignée d’un
continent, mais 1,3 fois moins grande, n’accueille que 30 espèces
(61 %, n = 49). Ces interprétations sont toutefois à modérer dans la
mesure où les données manquent encore.
Une des raisons qui expliquent que certaines îles soient moins riches
en espèces, mais pourtant plus proches des foyers de dispersion, réside
dans la nature et la disponibilité des habitats aquatiques dont dépendent
étroitement les libellules. D’une manière générale, les libellules sont
surtout des habitantes des milieux stagnants (jusqu’à 90 % aux Antilles)
et se développent majoritairement dans les mares ou les étangs qui
font défaut dans certaines îles, comme Saint-Vincent ou Grenade par
exemple. La faune odonatologique y est donc plus pauvre.
Les premiers Odonates sont apparus il y a 300 Ma lors de la formation de
la Pangée (continent unique). La division de ce continent en Gondwana
et Laurasia semble être à l’origine de la dispersion des espèces sur
chaque fragment de continent. Puis, lors de la formation des Proto-
Antilles au Paléocène des échanges ont pu exister entre les faunes
gondwaniennes au nord et laurasiennes au sud car elles formaient une
continuité entre l’Amérique du Nord et du Sud. Mais il est également
envisageable que les nombreux déplacements de terres et la création
de fosses océaniques aient pu conduire à la séparation des taxons
appartenant à des populations autrefois communes. Pour valider une
ou l’autre des hypothèses, des études génétiques sont indispensables
pour dénir le pourcentage d’homologie de chaque spécimen et donc
l’ancêtre commun de chaque taxon.
Localisation des Grandes et Petites Antilles à l’échelle régionale
(réalisation C. Poiron, 2011 - infographie A. Rafaelian).
Histoire géomorphologique des Antilles et principales voies
de colonisation (en rouge) (d’après Meurgey & Picard, 2011).
Coenagrionidés, 9 Aeshnidés et 28 Libellulidés. Parmi ces 49
espèces de libellules recensées, 8 sont endémiques* à cette
région du monde Protoneura ailsa, que l’on ne rencontre
qu’en Martinique, Dominique et Sainte-Lucie. Protoneura
romanae et Macrothemis meurgeyi ne peuvent être observés
qu’en Guadeloupe. Le Coenagrionidé Argia concinna est,
quant à lui, endémique de Guadeloupe et de la Dominique.
Argia telesfordi, découverte et décrite pour la première fois
en 2009, est endémique de Saint-Vincent et de Grenade.
Dythemis sterilis multipunctata (une sous-espèce de Dythemis
La dépouille larvaire (ou exuvie) est un des meilleurs moyens de prouver
l’autochtonie (reproduction) dans un milieu donné (cliché C. Poiron).
Le Grand Étang en Guadeloupe,
habitats de plus de 15 espèces d’odonates (cliché F. Meurgey).

ESPÈCES №2 - Décembre 2011 ESPÈCES №2 - Décembre 2011
Biologie
RECHERCHE - Entomologie Herpétologie Géologie Entomologie Mycologie Phylogéographie Primatologie Microbiologie Paléontologie - Libellules
Archéozoologie Ichty
Libellules insulaires inconnues
À l’heure où la biodiversité est mise à mal dans de très
nombreuses régions du monde, la découverte d’espèces
nouvelles constitue toujours un évènement d’un grand
intérêt. Outre le fait que ces découvertes contribuent à une
meilleure connaissance des espèces qui nous entourent, leur
étude permet également de mieux connaître leurs exigences
écologiques, préalable indispensable pour envisager la
protection de leur habitat et donc de notre environnement.
sterilis), décrite pour la première fois en 1894, endémique de
Saint-Vincent, n’a été retrouvée qu’en 2010 au cours d’une
de nos missions sur cette île. Brechmorhoga praecox grenadensis
est endémique de Grenade alors que Brechmorhoga archboldi
est endémique de Guadeloupe, Dominique, Martinique
et Sainte-Lucie. Le statut taxonomique de ces espèces est
à l’étude et une prochaine mission à Saint-Vincent nous
permettra peut-être de collecter l’un de ces deux taxa, et de
préciser leur origine. Les autres espèces se rencontrent aussi
sur le continent américain.
Un prédateur du vecteur de la Dengue
Outre l’intérêt des libellules dans les études sur la biodiversité,
cet ordre d’insectes prédateur au stade larvaire et imago peut
avoir un impact sur les populations d’insectes ayant une
action néfaste sur les activités humaines (transmission de
maladies, prédation sur les pollinisateurs). Une expérience,
conduite en Birmanie dans les années soixante-dix a
montré que l’introduction de larves de Crocothemis servilia
(Libellulidae) dans les réservoirs d’eau domestique a permis
de faire baisser la densité du moustique vecteur de la Dengue
(Aedes aegypti) très en dessous du seuil que l’on aurait pu
atteindre en employant des pesticides. Cette expérience
a dû son succès à un important facteur : le fait que les
prédateurs et leurs proies sont confinés dans un système
clos. Aux Antilles, où les épidémies de Dengue sont de
plus en plus fréquentes, de nombreux milieux aquatiques
clos sont favorables au développement des moustiques. Si
certains, comme les réservoirs et citernes domestiques, sont
connus de tous, d’autres, tels les innombrables macrodéchets
Protoneura romanae, Guadeloupe.
(cliché Pierre et Claudine Guezennec).
Argia telesfordi, mâle, Saint-Vincent.
(cliché F. Meurgey).
Source du Carbet ????
Source du Carbet ????
Protoneura romanae a été découverte en Guadeloupe
et décrite en 2006. Cette petite espèce, dont l’abdomen
n’excède pas 300 µm de diamètre, ne laisse souvent voir dans
la pénombre de la forêt que ses yeux rouges. Cette découverte
récente s’explique par le fait que cette libellule est tout à fait
semblable à sa voisine : Protoneura ailsa, mais en diffère par
certains critères morphologiques issus de la spéciation de ces
taxons dans des îles relativement éloignées. Outre le fait que
cette libellule soit endémique de la Guadeloupe, son habitat
(les forêts marécageuses de la Grande Terre notamment) est
également menacé non seulement par l’accroissement du
tissu urbain, mais aussi par l’extension des surfaces agricoles
au détriment de cette forêt particulière.
Argia telefordi n’a, quant à elle, été découverte qu’en 2009
dans l’île de Grenade. Les informations les plus récentes sur
les libellules de cette île à l’extrême sud de l’archipel des
Petites Antilles dataient des années 1940 ! Une mission de
deux semaines a permis de mettre à jour les connaissances
sur les 19 espèces présentent sur cette île et de découvrir
cette petite espèce dans les forêts humides du centre de l’île.
L’année suivante, Argia telesfordi est également observée dans
l’île voisine de Saint-Vincent. Bien que cette espèce présente
des populations importantes sur les deux îles, celles-ci ne
sont présentes que sur une superficie réduite, de moins de
800 km² !

ESPÈCES №2 - Décembre 2011 ESPÈCES №2 - Décembre 2011
Biologie
RECHERCHE - Entomologie Herpétologie Géologie Entomologie Mycologie Phylogéographie Primatologie Microbiologie Paléontologie - Libellules
Archéozoologie Ichty
Les libellules racontent l’histoire
des Antilles françaises
Si l’on analyse le peuplement actuel des odonates des
Antilles françaises, on remarque que la majorité des espèces
se développe dans les milieux stagnants (les mares ou les
étangs notamment). Mais ces milieux n’existaient pas (ou
très rarement) sur des îles majoritairement volcaniques
avant la colonisation par les Européens au xviie siècle. Dans
des îles volcaniques où les milieux aquatiques sont surtout
ménagers qui parsèment les campagnes, le sont moins pour
être autant de réservoirs potentiels pour d’importantes
populations de moustiques. Certaines mares périurbaines,
lorsqu’elles sont utilisées comme décharge, peuvent favoriser
le développement des moustiques au détriment de leurs
prédateurs comme les libellules. Des expériences sur le
modèle de celle réalisée en Birmanie pourraient être mises
en place aux Antilles avec, comme préalable, l’élaboration
d’un protocole rigoureux, mais également l’implication de
la population.
Urbanisation, lessives et espèces envahissantes
Comme dans de nombreuses régions du monde, les libellules
sont directement ou indirectement menacées par la perte ou
la modification de leurs habitats. Une des principales menaces,
aux Antilles, réside dans l’accroissement du tissu urbain avec,
comme conséquence, l’assèchement et le comblement de
mares et des étangs. À cela, s’ajoute l’usage inconsidéré et
massif de produits phytosanitaires (nitrates, chlordécone,
fongicides, nématocides…) qui dégradent dangereusement
les qualités écologiques des milieux.
Le lavage du linge et des véhicules dans les rivières, pratiqué
de façon régulière, à également un impact important sur les
invertébrés aquatiques et leurs habitats, non seulement par
dérangement ou la, destruction des populations larvaires,
mais aussi, mécaniquement, par la modification des
berges (éboulements, piétinements…) ou chimiquement
(détergents).
Une mare de Grande-Terre en Guadeloupe (cliché F. Meurgey).
Nettoyage de véhicules dans une rivière de Sainte-Lucie
(cliché C. Poiron).
Glossaire
Endémique : une espèce endémique est spécique à une région
géographique particulière, bien délimitée, et on ne la trouve nulle part
ailleurs dans le monde. L’endémisme peut être considéré à l’échelle
d’un continent, d’une île ou même de quelques hectares.
Envahissement d’un cours d’eau de Sainte-Lucie
par la Jacinthe d’eau (Eichhornia crassipes). (cliché C. Poiron).
L’introduction et la dispersion d’espèces végétales aquatiques
par l’homme dans les milieux stagnants, notamment
en Guadeloupe et en Martinique, deviennent assez
préoccupantes et menace directement les mares et les étangs.
En cause, la laitue d’eau (Pistia stratiotes) et la jacinthe d’eau
(Eichhornia crassipes), fréquemment utilisées pour orner
les bassins et les mares, peuvent se développer rapidement
jusqu’à former des tapis denses qui privent les invertébrés de
lumière et réduisent la concentration en oxygène dans l’eau.
Il en résulte une réduction dramatique de la diversité animale
(et végétale) dans les milieux colonisés par ces plantes.
> Meurgey F., Picard L., 2011 - Les libellules des Antilles
françaises. Biotope, Mèze (Collection Parthénope). Muséum
national d’Histoire naturelle, Paris.
> Sites internet :
Site de photographies de Pierre et Claudine Guezennec
http://www. Ti.racoon.free.fr
Site de la Société d’Histoire Naturelle L’Herminier :
http://www.shnlh.org
représentés par les rivières montagnardes, la création de
mares pour combler les besoins en eau de la population et
du bétail a eu comme effet de favoriser une diversité qui
n’existait sans doute pas avant cette époque.
On serait donc tenté - pour une fois - de considérer que
l’action de l’homme a été favorable à l’accroissement de
la diversité des libellules. Mais quelle diversité ? Celle-ci
doit, de nos jours, être envisagée de manière quantitative
et non qualitative. En effet, la plupart des milieux stagnants
accueillent une faune odonatologique basée sur des espèces
possédant une vaste répartition géographique, d’importantes
capacités à la colonisation et généralement très tolérantes vis-
à-vis des conditions écologiques des milieux.
La progressive destruction de la forêt, depuis environ 300
ans, en parallèle à la création de nouveaux milieux, a induit
un biais dans l’appréhension de la faune odonatologique
des Antilles. Malgré une importante diversité actuelle, nous
ne saurons jamais ce que les forêts de la Grande-Terre de
Guadeloupe ou les grands ensembles de forêts marécageuses
pouvaient recéler par le passé et combien d’espèces fragiles
et spécialisées ont ainsi disparu. Pour autant, il faut éviter
de considérer les mares comme des milieux que l’on peut
supprimer au titre d’une diversité moins emblématique que
celle des forêts. La diversité actuelle des odonates des Antilles
françaises est le résultat de transformations des paysages
d’origine naturelle et humaine, et doit être considérée
comme un ensemble reflétant l’histoire de ces îles.
Légende
1
/
4
100%