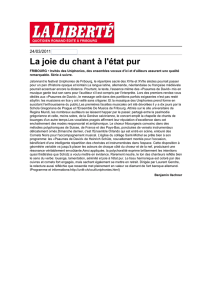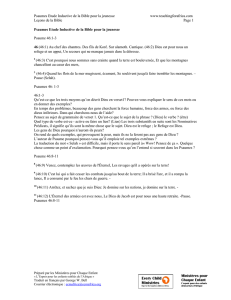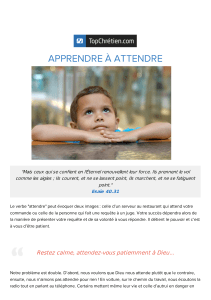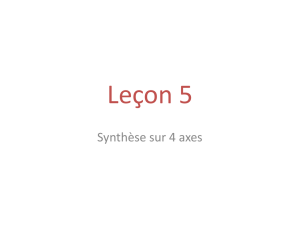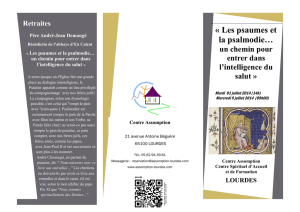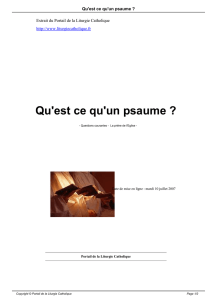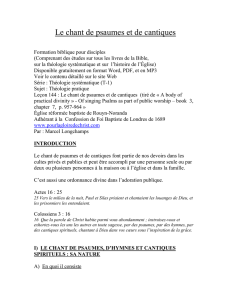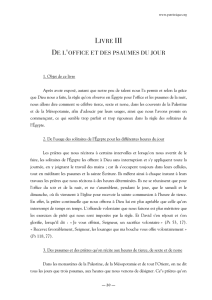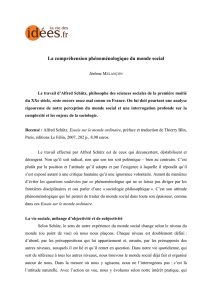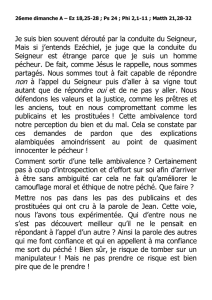Les psaumes de david

Le 1er juin 1619 à Dresde, ville dont il était devenu deux ans plus tôt le maître de chapelle, Heinrich Schütz
épouse Magdalena Waldeck. De manière fort symbolique, c’est cette date précise qu’il choisit d’apposer à son
opus 2, les Psaumes de David, révélant ainsi la place à part qu’il attribue à ce recueil.
Le début de la composition des vingt-six psaumes remonte cependant à plusieurs années auparavant. En
1609, Schütz bénécie d’une bourse du landgrave de Kassel pour se rendre à Venise et étudier auprès de Gio-
vanni Gabrieli. Parti pour deux ans, il publie à Venise en 1611 un recueil de madrigaux italiens. Le succès de
ce premier opus lui permet de prolonger son séjour et ce n’est qu’en 1613 qu’il rentrera à Kassel. Il va y occuper
le poste d’organiste et composer une série de concerts à plusieurs chœurs à la manière italienne. Cependant,
il en retarde la publication car il souhaite, selon ses propres mots «continuer à se perfectionner en musique».
En 1614, le prince électeur de Saxe s’intéresse au jeune Schütz et demande au landgrave Moritz l’autorisation
de l’inviter à Dresde, où se trouvait alors la plus importante chapelle de l’Allemagne protestante. Dès 1615,
engagé ociellement comme organiste et professeur, le compositeur y remplace Rogier Michael, malade, et
devient de facto maître de chapelle, fonction à laquelle il sera dénitivement nommé en 1617. Durant ces
années, il a non seulement mûri le savoir-faire acquis à Venise en matière de polychoralité, mais il a surtout
transposé et repensé complètement la technique de «Johann Gabriel» à la lumière de la langue allemande.
Ces concerts à plusieurs chœurs, des «Psaumes allemands écrits à la manière italienne» constituent, en même
temps que son premier opus religieux, le point de départ d’un style fortement personnalisé. La disposition en
plusieurs chœurs s’inspire de la pratique vénitienne des cori spezzati. Mais l’innovation réside surtout dans
la déclamation verticale in stile recitativo de la langue allemande, dont le verbe engendre à la fois le rythme
et l’harmonie, aux recherches symboliques parfois poussées. Avec ces psaumes, un style proprement germa-
nique est né.
Alors que certains psaumes suivent l’écriture traditionnelle à double chœur, mettant en œuvre deux groupes
d’égale importance (SWV 24, 29, 37, 25), d’autres proposent des eectifs plus grands, évoluant entre huit
et seize voix vocales et instrumentales (SWV 23, 38, 26, 40, 22). Il y a de longues successions de grappes
sonores verticales et des passages très contrapuntiques. Certaines pièces présentent une structure harmo-
nique simple, d’autres sont plus chromatiques (SWV 29). Le caractère dansant y alterne avec des pages plus
sombres, et l’un des psaumes est composé entièrement en écho (SWV 36).
En ce qui concerne la distribution des voix, le compositeur présente dans sa préface le grand éventail de pos-
sibilités dont dispose l’interprète. Chaque partie peut être soit chantée, soit jouée, ou alors les deux à la fois en
colla parte. La seule obligation est que le texte soit présenté dans son entier par une voix au moins. Dans les
psaumes à trois ou quatre choeurs, il y a d’un côté les «Favorit-Chöre», qui sont indispensables et contiennent
la substance musicale et textuelle, et de l’autre les «Capell-Chöre», qui peuvent être instrumentaux, vocaux,
ou alors laissés de côté. On remarquera dans ces derniers les tessitures parfois extrêmes des voix aigües et
graves: ces parties sont de toute évidence destinées aux instruments.
Comme c’est souvent le cas des compositeurs au 17ème siècle, Schütz était soucieux que l’on puisse jouer ses
œuvres avec des eectifs plus ou moins grands. L’eectif minimal requis ici est de huit chanteurs et d’un ins-
trument de continuo. Lors des grandes occasions, l’ensemble pouvait être beaucoup plus important et réunir
un grand nombre de chanteurs et d’instrumentistes.
LES PSAUMES DE DAVID
Heinrich Schütz (1585-1672)
1
/
1
100%