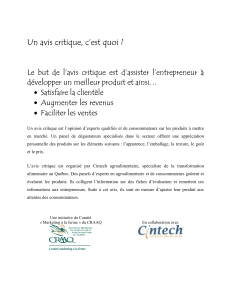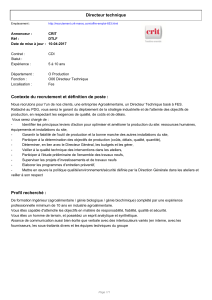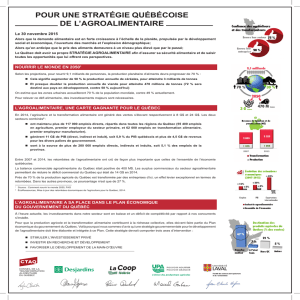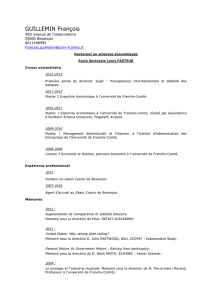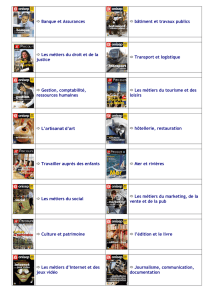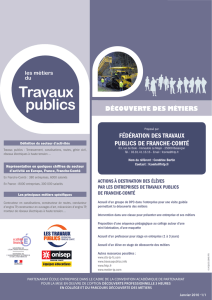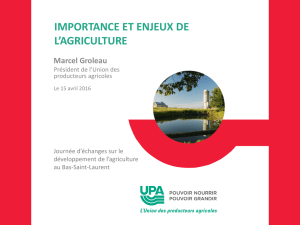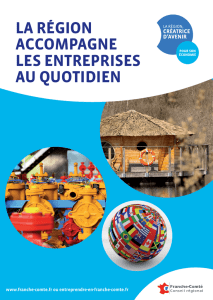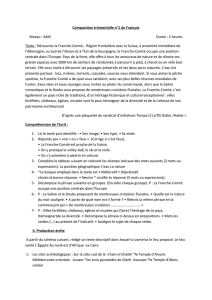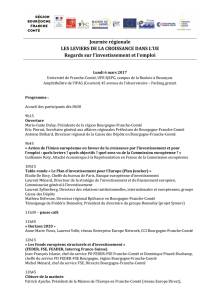L`agroalimentaire, valeur sûre de l`économie franc

L’agroalimentaire,
valeur sûre
de l’économie
franc-comtoise
Janvier 2012
Conseil économique, social et environnemental de Franche-Comté

État des lieux
L’agroalimentaire, en France, à grands traits 5
Les spécicités de l’agroalimentaire franc-comtois 6
L’environnement de l’agroalimentaire franc-comtois
Les pouvoirs publics 14
Les acteurs de la recherche 15
Les acteurs de la formation 18
Les acteurs de la promotion 19
Les acteurs de l’animation des lières 21
Propositions pour une politique régionale de l’agroalimentaire
Conrmer l’ARIATT comme interlocuteur majeur de ce secteur 27
Construire une politique régionale d’appui à l’innovation 28
Assurer une cohérence de promotion 29
Répondre aux besoins de la lière viande 30
Soutenir une politique de formation professionnelle spécique 31
Annexes 33
sommaire

Ce secteur et son tissu de PME repré-
sentent un élément incontournable
pour l’image et l’économie de la
Franche-Comté, en permettant le
maintien d’une activité porteuse de
valeur ajoutée sur l’ensemble du
territoire.
[ Avant-propos ]
E
n Franche-Comté, les entreprises du secteur agroalimentaire (AA) sont
principalement des petites et moyennes entreprises (PME) riches d’un
savoir-faire spécique souvent caractérisé par des produits identiés
sous signes de qualité : Appellation d’origine contrôlée (AOC), Appellation
d’origine protégée (AOP), Indication géographique protégée (IGP), labels et
parfois par des marques propres. Dans leur grande majorité, elles ont un lien
fort avec le territoire. Leurs productions, fortement ancrées dans le terroir as-
surent une pérennité certaine de l’activité agroalimentaire en Franche-Comté.
Pour la plupart, elles sont de ce fait non délocalisables.
La petite taille qui caractérise le tissu des entreprises agroalimentaires de
Franche-Comté peut présenter des inconvénients évidents, liés notamment à
une capacité limitée d’investissement.
Pour répondre aux dicultés engendrées par cette situation, les entreprises ont
mis en place des structures collectives - syndicats de produits, interprofessions,
représentations de lières… - qui sont sources de dynamisme et de progrès
parce qu’elles assurent une mise en commun et une solidarité certaine.
Cette solidarité est une des composantes marquantes de l’identité de notre région
qui, faut-il le rappeler, possède une forte tradition coopérative ; l’exemple le plus
frappant est celui des fruitières qui dynamisent l’économie laitière.
AOP, AOC et IGP sont ainsi le fruit de cette longue marche au travers des siècles
qui a vu les nécessaires adaptations aux technologies et à l’évolution du marché.
Les signes de qualité, et quelquefois les marques
régionales fortes, ont un eet d’entraînement sur
l’ensemble du secteur agroalimentaire.
Ce secteur et son tissu de PME représentent un élé-
ment incontournable pour l’image et l’économie
de la Franche-Comté, en permettant le maintien
d’une activité porteuse de valeur ajoutée sur
l’ensemble du territoire. Pour autant, l’environ-
nement national et international est très concur-
rentiel et très mobile. En outre, nos PME sont
quelquefois confrontées à des fragilités internes
(faiblesse de l’encadrement, de l’accès à la recherche et à l’export, dicultés de
transmission…). Vigilance et lucidité s’imposent donc.
De nombreux organismes interviennent dans l’environnement de ces entreprises.
Un Contrat d’aide à la compétitivité (CAC), des conventions entre partenaires ont
été signés et visent à organiser leurs relations.
Conscient du grand potentiel de notre secteur agroalimentaire, de l’évolution
économique actuelle et du contexte de forte concurrence dans lequel il doit
s’inscrire, le Conseil économique, social et environnemental a souhaité formaliser
cette réexion singulière. Elle doit, au-delà de l’état des lieux et de l’analyse d’un
secteur injustement méconnu, souvent abordé avec des préjugés tenaces, faire
prendre conscience des enjeux représentés par le maintien et l’expansion de ce
secteur indispensable à notre territoire.
Les recommandations du CESE s’adressent aux diérents acteurs de la lière
et aux milieux institutionnels, en tout premier lieu le Conseil régional. Elles
visent à conforter et développer ce secteur clé de l’économie franc-comtoise
en ayant le souci de la transversalité et de la coopération.
Le groupe de travail composé de Noëlle Barberet, Jacques Bauquier, Jean-
Pierre Benoît - rapporteur, Daniel Dubois, Pierre Leroy, Jacques Mazzolini,
Dominique Roy et Claude Vermot-Desroches a été le creuset de cette réexion;
par la diversité de sa composition, il a exercé un regard attentif sur ce secteur,
euron de l’économie franc-comtoise et porteur de l’identité de la région.
Ce rapport a été adopté à la majorité : 48 voix pour, 4 contre (représentants de
l’environnement) et 8 abstentions (CGT, Maison régionale de santé et personnalité
qualiée au titre de l’environnement).

PORTRAIT
DU SECTEUR
AGROALIMENTAIRE
Les principales lières de l’agroalimentaire franc-comtois
disposent d’indéniables atouts : un fort ancrage territorial,
de nombreuses reconnaissances de produit de qualité
(AOP, AOC, IGP) et une organisation collective solide et
ancienne. Pour autant, dans un contexte de compétition
internationale, les entreprises - souvent de petite taille-
sont confrontées à un certain nombre d’enjeux majeurs
pour leur pérennité et leur développement.

PORTRAIT
DU SECTEUR
AGROALIMENTAIRE
L’agroalimentaire, valeur sûre de l’économie franc-comtoise - janvier 2012 - CESE de Franche-Comté 5
L’AGROALIMENTAIRE, EN FRANCE, À GRANDS
TRAITS
(source : ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche - enjeux des
industries agroalimentaires 2010)
La fonction essentielle des industries agricoles et alimentaires est la transformation
des produits de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, en aliments et bois-
sons pour l’homme ou l’animal.
Premier secteur industriel français, avant l’automobile, les Industries agroali-
mentaires (IAA) ont réalisé en 2008, 147 milliards d’euros de chire d’aaires et
31,7 milliards d’euros de valeur ajoutée.
Ce secteur valorise 70 % de la production agricole nationale et emploie en
France près de 557 000 salariés dans plus de 10 000 entreprises, dont 90 % sont
des PME.
Ces résultats globaux situent l’industrie agroalimentaire française dans le trio de
tête européen avec l’Allemagne et le Royaume-Uni.
Avec 3,7 milliards d’euros d’excédent commercial en 2009, ce secteur contribue
de façon extrêmement positive à notre balance commerciale.
Depuis 2008, la France se situe au quatrième rang des exportateurs mondiaux
de produits agricoles et agroalimentaires derrière les USA, les Pays-Bas et
l’Allemagne. Elle a longtemps été la première.
L’industrie agroalimentaire constitue donc, avec notre agriculture, un actif
stratégique en France comme en Europe.
Elle se caractérise par une grande diversité d’acteurs et de lières mais la plus
grande place est occupée par la transformation des produits de l’élevage, caracté-
ristique de la France au sein des pays européens.
Avec 31 % des entreprises, 1re et 2e transformation de la viande et du lait regroupent,
en 2007, 42 % de l’agroalimentaire total et un peu moins du tiers de la valeur
ajoutée et des exportations directes.
95 % du chire d’aaires et de la valeur ajoutée de l’industrie AA sont réalisés
par 3 000 entreprises de plus de 20 salariés.
Les organismes de statut coopératif (12 % des unités de l’AA) sont surtout présents
dans la vinication et, dans une moindre mesure, dans l’alimentation animale et
l’industrie laitière. Le périmètre coopératif s’étend toutefois et concerne environ
20 % de l’emploi salarié et du chire d’aaires global des unités considérées.
En France, comme en Europe, l’AA est surtout composé de PME, souvent d’origine
familiale. En 2007, près des 2/3 des entreprises agroalimentaires ont moins de
20 salariés et réalisent un peu plus de 4 % du chire d’aaires de l’industrie
agroalimentaire. Les nombreuses implantations en milieu rural représentent un
véritable enjeu en termes de maillage et d’équilibre du territoire.
Dans un contexte de mondialisation, les IAA peuvent paraître relativement
protégées dans la mesure où elles sont moins aisément délocalisables que
d’autres productions. Pour autant, elles restent soumises à la compétition in-
ternationale et sourent à cet égard de plusieurs fragilités : petite taille des
entreprises, faible taux d’encadrement, manque d’attractivité du secteur, poids
des contraintes réglementaires.
Le développement des PME suppose la conquête de nouveaux débouchés, ce
qui implique du dynamisme, de l’adaptabilité et, par conséquent, de la recherche
et de l’innovation, de la formation et de la solidarité. Dans le domaine de l’AA, les
innovations technologiques dites « de rupture » sont peu fréquentes ; l’innovation
porte surtout sur la modication, l’amélioration de produits et/ou de procédés
existants.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
1
/
48
100%