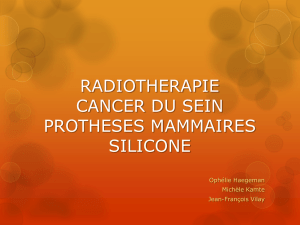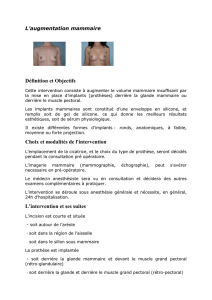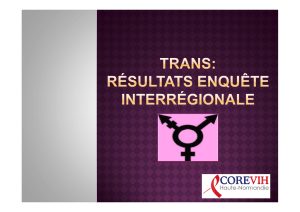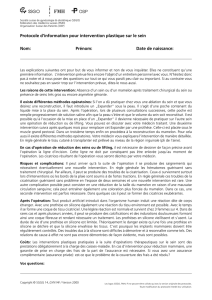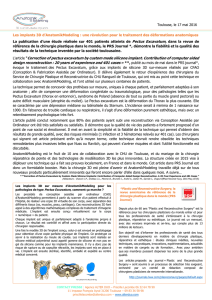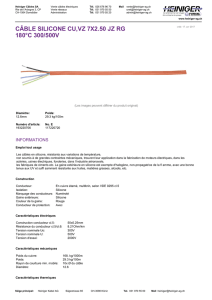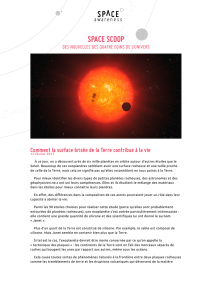L`information du malade : évolution de la jurisprudence

Progrès en Urologie (1998), 8, 188-192
188
L’information du malade : évolution de la jurisprudence.
L’exemple du silicone
Bernard MALAVAUD
Service d’Urologie et de Transplantation Rénale (Pr.J.P.Sarramon), CHU Toulouse-Purpan, Toulouse, France
RESUME
L'acte médical s'exerce dans le cadre d'un contrat
de moyens passé entre le médecin et son patient.
L'inobservation de ce contrat expose à la mise en
cause de la responsabilité du praticien. Longtemps
celle-ci a été engagée sur le motif d'une faute tech-
nique ou plus rarement d'un défaut d'information
ou de consentement, la charge de la preuve incom-
bant au patient.
En cas de litige, un arrêt récent de la Cour de
Cassation (25 février 1997) nous impose de démon-
trer que nous avons, effectivement et de manière
valide, informé notre patient.
Cet article étudie le contenu de cette information.
Il suggère une méthode qui, mise en place sous
l'autorité des Sociétés Savantes, permettrait la
p roposition au sein de notre discipline de fiches
d'information afin de répondre à la fois au souci
d'informer nos patients et à celui de préserver
n o t re responsabilité. Enfin cette démarche est
illustrée par l'étude de la tolérance des matériaux
contenant du silicone.
Mots clés: Consentement éclairé, élastomère de silicone, effets
indésirables.
Progrès en Urologie (1998), 8, 188-192.
A l'occasion de la réunion provinciale de la Société
Française d'Urologie sur la tolérance des biomatériaux,
nous avons voulu décrire les modifications récentes
concernant l'information du patient et illustrer leur
intérêt en les appliquant au cas particulier de la mise en
place d'implants ou de prothèses comportant du silico-
ne.
En effet, exercice médical et cadre juridique procè-
dent de deux logiques indépendantes, celles de la
Médecine et du Droit, toutes deux s'enrichissant de
leurs rencontres et de leurs conflits, avec de nom-
breuses conséquences pratiques dans nos relations
avec nos patients.
L’INFORMATION DU PATIENT
Le contrat médical et la faute médicale
Depuis l'arrêt Mercier en 1936, l'acte médical s'exerce
dans le cadre d'un contrat passé entre le patient et son
médecin [1], ce dernier s'engageant à "donner des soins
consciencieux, attentifs, conformes aux données
acquises par la Science", l'inobservation de ce contrat
exposant le médecin en cas de préjudice à la mise en
cause de sa responsabilité civile.
Ces mises en cause ont longtemps été fondées seule-
ment sur la notion de faute technique, celle-ci devant
être reliée par un lien de causalité certain avec un
dommage évaluable, l'action civile ayant pour objet de
réparer ce dommage en l'indemnisant.
Ce concept de faute médicale est d'application diffici-
le, car il suppose à l'origine l'existence d'une faute tech-
nique ou d'indication; la preuve de la faute, du lien et
du dommage étant à la charge de la victime. Cette
preuve, en particulier en cas de survenue d'accidents
rares et graves qualifiés d'"aléas thérapeutiques", ne
peut souvent pas être apportée.
C'est dans cette perspective qu'est apparue une évolu-
tion vers la notion de responsabilité sans faute dans le
cas de "dommages sans rapport avec l'état initial et pré-
sentant un caractère d'extrême gravité"(arrêt Bianchi)
[2], ceci ne s'appliquant qu'à la juridiction administra-
tive qui traite des actes réalisés à l'hôpital public (en
dehors de la faute lourde détachable du service).
Dans l'objectif d'une indemnisation on voit ainsi appa-
raître les limites de la recherche de la faute, en particu-
lier en médecine libérale et dans le cas d'accidents
exceptionnels.
Le défaut d'information et de consentement
Même en l'absence de faute technique, il est possible
d'intenter une action pour défaut ou insuffisance d'in-
formation et de consentement. Cette voie a été réguliè-
rement utilisée pour indemniser les séquelles graves
d'actes non fautifs diagnostiques ou thérapeutiques.
Manuscrit reçu : juin 1997, accepté : novembre 1997.
Adresse pour correspondance : Dr. B . Malavaud, Service d’Urologie et de
Transplantation Rénale, CHUToulouse-Purpan, 1, place du Docteur Baylac,
31059 Toulouse Cedex.

189
L'information est la conséquence logique de la notion
de contrat médical, elle doit permettre le consentement
- ou le refus - éclairé du patient. En 1965 la Cour de
Cassation précisait que l'information devait être
"simple, approximative, intelligible et loyale". Le nou-
veau Code de Déontologie utilise les termes "d'infor-
mation loyale, claire et appropriée" [3], et rappelle que
le "consentement doit être recherché dans tous les cas"
[4].
Jusqu'à très récemment les poursuites pour défaut d'in-
formation restaient d'application délicate car, en dehors
de cas particuliers comme les essais thérapeutiques [5,
23], la charge de la preuve de l'absence d'information et
de consentement éclairé incombait au patient.
Nous devons conserver la preuve de l'information
du patient.
Un arrêt de la Cour de Cassation du 25 février 1997
(arrêt Hédreul) a renversé cette situation et c'est main-
tenant au médecin de prouver qu'il a bien informé son
patient [6].
Cet arrêt s'appuie sur l'article 1315 du Code Civil qui
précise que "celui qui est tenu d'une obligation d'infor-
mer doit apporter la preuve de l'exécution de cette obli-
gation" [7].
Il s'agit d'une évolution jurisprudentielle majeure, bien
que cette lecture, renversant la charge de la preuve,
reste sujette à débats, y compris auprès des magistrats.
On peut craindre en effet que ce "formalisme informa-
tif" n'altère à terme la confiance nécessaire entre méde-
cin et malade et que l'énumération de risques non-
exceptionnels ne soit le sujet d'inquiétudes regrettables.
C'est pourquoi certains ont suggéré que cette discus-
sion soit portée devant l'Assemblée plénière de la Cour
de Cassation [16].
Dans plusieurs lois traitant de sujets à forte résonance
éthique comme la loi Veil, celle sur les recherches bio-
médicales (loi Huriet), les lois bioéthiques relatives au
respect du corps humain [8], les moyens de la preuve
étaient déjà prévus et le consentement y est exprimé
par écrit. Il apparaît logique d'utiliser le même moyen
surtout quand sont prises des décisions importantes,
comme une décision opératoire.
Quelles sont les limites de l'information?
Nous sommes tenus d'informer de "façon intelligible et
loyale" [9] le patient de son état (diagnostic), des trai-
tements proposés avec leurs risques, leurs suites, leurs
conséquences. Cette obligation d'information a été
modulée par l'usage; ainsi seuls les "risques normale-
ment prévisibles" doivent-ils être indiqués, par opposi-
tion aux risques ayant un "caractère exceptionnel" .
Cependant, y compris pour les instances judiciaires, le
caractère exceptionnel est difficile à traduire en
chiffres; ainsi un risque de 4 à 5% n'impose pas d'in-
formation dans un cas [10] alors que dans un autre un
risque évalué à 1,4% n'est pas considéré comme excep-
tionnel [11].
En autorisant une certaine modulation dans l'apprécia-
tion du risque en fonction des circonstances ce flou
permet d'éviter de rendre trop rigides les relations entre
Médecine et Justice. Cela peut cependant gêner l'appli-
cation des règles de l'information tant pour le praticien
individuel que pour l'ensemble des praticiens.
En effet ce qui peut apparaître comme "exceptionnel"
ici est peut-être "normalement prévisible" ailleurs,
selon la limite choisie ou que l'on se fonde sur les don-
nées de la littérature ou sur l'expérience (série person-
nelle).
On voit ainsi qu'il serait souhaitable qu'à l'intérieur
d'une discipline les Sociétés Savantes, sur la base d'une
méthodologie précise (limite choisie, données de la lit-
térature, enquêtes nationales, séries personnelles), défi-
nissent de manière consensuelle les "risques prévi-
sibles" et les reprennent dans une fiche d'information
avant de la soumettre à l'ensemble de la discipline.
Chaque praticien aurait ensuite la possibilité d'utiliser
ces fiches, de les adapter à sa pratique et surtout de les
commenter auprès de ses patients.
Un cas particulier est constitué par des risques dont la
fréquence n'est pas connue, voire dont la réalité n'est
pas réellement établie. Doit-on informer d'un risque qui
n'est pas prouvé?
Cette question pourrait paraître excessive mais deux
exemples montrent qu'il n'en est rien. Ainsi en 1992
aux Etats Unis la Food and Drug Administration
(FDA) [21] a retiré du marché les prothèses mam-
maires en silicone alors que les hypothèses de risques
accrus de maladies auto-immunes ou de cancer
n'avaient pas été confirmées; de même, en France en
1997, l'Académie de Médecine a recommandé que l'on
informe systématiquement les patients ayant reçu des
dérivés sanguins provenant de personnes ayant présen-
té une maladie de Creutzfeldt-Jakob de l'hypothèse,
non démontrée, de la transmission par ce moyen de la
maladie [12 bis, 25].
Nous avons voulu illustrer ce nouveau cadre en étu-
diant dans la littérature les données ayant trait à la tolé-
rance du silicone (réaction locale, auto-immunité, can-
cer) obtenues à partir d'une recherche bibliographique
informatisée Medline® utilisant comme mots-clés
"Silicone Elastomers" et "Adverse Effects". Cette
recherche a identifié pendant les 5 dernières années 91
articles, dont aucun n'avait trait avec l'Urologie. Par
comparaison, la même méthodologie appliquée au
Téflon® (Poly Tetra Fluoro Éthylène) a mis en éviden-
ce 104 articles dont 22 traitant d'Urologie.

LA TOLERANCE DES SILICONES
Les Silicones (poly-dimethyl Siloxane) sont des molé-
cules hydrophobes. D'abord utilisés en médecine pen-
dant la seconde guerre mondiale pour la lubrification
des pistons de seringue [17], ils ont vu leur utilisation
s'étendre rapidement sous forme liquide, de gel, semi-
solide ou solide (tubes, drains, prothèses). On les utili-
se en urologie sous formes de tubes dans les prothèses
péniennes, les sphincters artificiels, les matériels de
dialyse (pompes à galets), sous forme de gel dans les
prothèses testiculaires. Ces dernières ont un schéma de
construction analogue à celui des prothèses mammaires
: une enveloppe en silicone solide entourant un coeur
en gel de silicone.
Tolérance locale des Silicones
Dès sa mise en place le silicone est recouvert d'une
couche de protéines (albumine, immunoglobulines et
complément, fibrinogène). Celles-ci sont absorbées et la
liaison se fait de manière si forte qu'elles ne peuvent être
détachées, même avec de puissants détergents [12). Ces
liens pourraient modifier la structure même des pro-
téines en les déplissant et ainsi faire apparaître de nou-
veaux motifs antigéniques [31]. Une réaction inflamma-
toire apparaît autour de la prothèse, sans qu'il y ait de
contact direct entre les cellules inflammatoires et la sur-
face du silicone, ce qui explique l'existence d'un plan de
clivage évident autour de l'implant. Localement on note
une réaction inflammatoire chronique, avec des granu-
lomes à corps étrangers, des macrophages, des fibro-
blastes. Ces derniers forment autour de la prothèse une
pseudo-capsule où l'on retrouve des fragments de silico-
ne tant à l'intérieur des cellules qu'entre elles [33], ainsi
qu'au coeur de volumineux granulomes à corps étran-
gers. Une telle pseudo-capsule a été retrouvée autour
d'implants péniens ou de sphincters artificiels [29].
La réaction inflammatoire locale, en particulier par l'in-
termédiaire de phénomènes d'oxydation locale (radi-
caux libres), altère à sont tour progressivement la paroi
prothétique ("environmental stress cracking") [31]. La
FDA estime que de telles ruptures sont présentes chez
environ 5% des patientes porteuses de prothèses mam-
maires [21] avec une fuite progressive du gel de silico-
ne dans le milieu péri-prothétique ("bleed") [14].
Les fragments de silicone ainsi libérés sont phagocytés
par les macrophages. On peut les mettre en évidence
dans des ganglions lymphatiques de voisinage [30] ou
plus distants.
On peut observer des réactions inflammatoires chro-
niques, contenant des particules de silicone après une
exposition transitoire si elle est répétée; c'est le cas des
patients hémodialysés (tubes en silicone des pompes à
galet) chez lesquels ont retrouve des particules de sili-
cone dans des foyers de nécrose hépatique, dans la rate,
la moelle osseuse, le parenchyme pulmonaire [22].
Les prothèses en silicone sont-elles un facteur de
risque de maladie auto-immune?
On a publié dès les années quatre-vingts plusieurs cas
isolés de patientes présentant diverses maladies auto-
immunes après mise en place d'implants en silicone
[19, 32]. Des éléments immunologiques tels que la pro-
duction d'anticorps anti-silicone [20], la modification
des motifs antigéniques des protéines liées au silicone
[31], sans être parfaitement concluants, donnaient une
base rationnelle à l'hypothèse de l'induction de mala-
dies auto-immunes par les implants de silicone.
La présence de silicone dans les sites d'inflammation
chronique de 3 patientes souffrant de sclérodermie
(membrane synoviale, peau, macrophages alvéolaires)
et surtout leur nette amélioration clinique après abla-
tion des prothèses mammaires rendait cette hypothèse
tout à fait crédible. Les auteurs ont d'ailleurs recom-
mandé l'ablation en cas de maladie auto-immune de
toute prothèse contenant du silicone [30].
Ce type de recommandation, la décision de retrait de ce
type de prothèse par la FDA, la couverture que les
médias en ont faite, ont eu de lourdes d'implications
pratiques comme par exemple la diminution du pour-
centage de femmes satisfaites de leurs implants (un à
deux millions aux États Unis depuis 1960) ou l'induc-
tion de poursuites judiciaires [27].
Cependant en 1994 la première grande série rétrospec-
tive comparait 749 femmes ayant reçu un implant
mammaire contenant du silicone à un groupe contrôle
composé du double de patientes sans implant et ne
montrait pas d'association entre l'implant et l'apparition
d'une maladie auto-immune [18].
On ne peut donc pas démontrer actuellement de lien
entre maladie auto-immune et silicone. Cette éventua-
lité toute hypothétique est cependant reprise dans la
plupart des notices des fabriquants, en particulier pour
les prothèses testiculaires dont la structure est analogue
à celle des prothèses mammaires.
Les prothèses en silicone sont-elles un facteur de
risque de cancer?
L'injection de gel de silicone dans certains modèles
animaux, induit l'apparition de sarcomes [26] ou de
myélomes [28]. Dans ce dernier cas les seules données
préliminaires publiées chez l'homme ne montrent pas
d'augmentation du risque [24].
Les cancers épithéliaux, bien qu'ils n'aient jamais pu
être induits chez l'animal par le silicone [17], ont fait
l'objet de plusieurs études épidémiologiques.
Une étude de cohorte, tenant compte de l'âge, compa-
rant plus de 10.000 patientes ayant reçu un implant
mammaire à 13.000 patientes présentant un cancer du
sein, n'a pas montré de risque supplémentaire [13].
190

Cette étude confirmait une série antérieure [15] de
construction moins rigoureuse (suivi plus court, taux
plus important de perdues de vue).
On peut ainsi conclure, pour le cancer du sein, à l'ab-
sence vraisemblable d'induction par les prothèses
mammaires alors que pour les formes tumorales rares
(myélome) les données restent fragmentaires.
Doit-on informer les patients de ces hypothèses?
Dans l'information écrite qu'il nous faut donner avant
mise en place d'une prothèse pénienne ou testiculaire,
d'un sphincter artificiel, peut-on ne pas signaler les
hypothèses de l'induction par le silicone de maladies
auto-immunes ou de cancers?
En l'absence d'élément scientifique formel on pourrait
le faire afin de ne pas inquiéter inutilement notre
patient. Il semble cependant prudent d'en faire men-
tion, ne serait-ce que pour se prémunir de l'association
fortuite d'un implant en silicone et d'une pathologie
auto-immune, d'un cancer ou d'un myélome multiple.
En effet si le Code de Déontologie nous permet de limi-
ter l'information que nous donnons au patient, ceci ne
peut se faire que dans des cas très particuliers comme
un diagnostic ou un pronostic grave ou fatal [3], dans
les autres cas nous devons une information "claire,
loyale et appropriée". Quant à l'absence d'élément
scientifique formel, nous avons vu qu'elle n'a pas été
retenue par l'Académie de Médecine quand elle a
recommandé d'informer les patients transfusés de l'hy-
pothèse de la transmission de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob, ce par référence au "droit à l'information".
Un dernier indice, plus pragmatique, de l'importance
médico-légale de cette information est apporté par la
prudence extrême avec laquelle ces hypothèses sont
citées et discutées dans les notices des fabricants de
matériels implantables.
On doit enfin prendre en compte l'indication opératoi-
re et ne pas mettre sur le même plan un risque hypo-
thétique et un intérêt majeur. Il serait sûrement plus
facile de défendre l'utilisation d'un sphincter artificiel
chez quelqu'un dont la vie est rendue impossible par
des fuites permanentes que celle d'une prothèse testi-
culaire dont la justification serait la prévention de
"troubles du schéma corporel".
CONCLUSION
L'évolution de la jurisprudence a transféré à notre char-
ge la preuve de l'information du patient. Ceci rend
beaucoup plus aisée la mise en cause de notre respon-
sabilité devant une juridiction civile, même en l'absen-
ce de faute diagnostique, de thérapeutique ou de sur-
veillance.
Cette information doit porter sur l'ensemble de la
démarche médicale, des moyens du diagnostic à la pré-
vention des récidives, des complications intercurrentes
aux effets secondaires des traitements. Par analogie
avec la méthodologie d'information utilisée dans le
cadre des essais thérapeutiques il apparaît prudent de
remettre une fiche d'information et de recueillir un
consentement écrit. Dans un souci d'homogénéité au
sein d'une discipline, les Sociétés Savantes pourraient
prendre en charge la rédaction puis la validation de
telles fiches, selon une méthodologie univoque.
Remerciements
Nous tenons à remercier Madame A.M. Contreras du Service de
Documentation des Hôpitaux de Toulouse pour son aide.
REFERENCES
1. Cass. Civ. 20/5/1936.
2. Cons. Etat 9 avril 1993.
3. Code de Déontologie Médicale, art. 35.
4. Code de Déontologie Médicale, art. 36.
5. Loi N° 94-630 du 25 juillet 1994, intégrée au Code de la Santé
Publique (art. 209-1 à 209-17).
6. Cass. Civ., 25 juillet 1997.
7. Code Civil, art. 1315.
8. Loi N° 94-653
9. Cass. Civ. 21 février 1961.
10. Cass. Civ. 6 mars 1979.
11. Cass. Civ. 15 décembre 1993.
12. BAIER R.E., DUTTON R.C. Initial events in interactions of blood
with a foreign surface.J. Biomed. Mater.Res., 1969, 3, 191-206.
12 bis. BASTIN R. Rapport au nom d’un groupe de travail sur la possi-
bilité de transmission de l’agent de la maladie de Creutzfeldt-Jakob
(MCJ) par des composants du sang : information des personnes
ayant pu être contaminées. Bull.Acad. Natle. Méd., 181, 5, 949-
950, séance du 27 mai 1997.
13. BERKET H., BIRSELL D.C., JENKINS H. Breast Augmentation : a
risk factor for breast cancer? N. Eng. J. Med., 1992, 326, 1649-1653.
14. BRODY G.S. Fact and fiction about breast implant «bleed». Plast.
Reconst.Surg., 1977, 60, 615-616.
15. DEAPEN D.M., PIKE M.C., CASAGRANDE J.T., BRODY G.S. The
relationship between breast cancer and augmentation mammaplasty :
an epidemiological study?Plast. Reconstr.Surg., 1986, 77, 361-368.
16. DUBOUIS L. La preuve de l’information du patient incombe au
médecin : progrès ou régression de la condition des patients? R.D.
Sanit. Soc., 1997, 33, 288-295.
17. FISHER J.C. The silicone controversy - When will Science prevail?
N. Engl. J. Med., 1992, 326, 1696-1698.
18. GABRIEL S.E., O’FALLON W.M., KURLAND L.T., BEARD
C.M., WOODS J.E., MELTON L.J. Risk of connective-tissue
diseases and other disorders after breast implantation. N. Engl. J.
Med., 1994, 330, 1697-1702.
191

19. GERMAIN B.F. Silicone breast implants and rheumatic diseases.
Bull. Rheum. Dis., 1991, 41, 1-5.
20. GOLDBLUM R.M., PELLEY R.P., O’DONELL A.A., PYRON D.,
HEGGERS J.P. Antibodies to silicone elastomers and reactions to
ventriculoperitoneal shunts. Lancet, 1992, 340, 510-513.
21. KESSLER D.A. The basis of the FDA’s decision on breast implants.
N. Engl. J. Med., 1992, 326, 1713-1715.
22. LEONG A.S.Y., DISNEY A.P.S., GIUOVE D.W. Refractile particles
in liver of haemodialysis patients. Lancet, 1981, 1, 889-890.
23. MALAVAUD B. La recherche biomédicale : connaître le cadre juri-
dique et réglementaire. Prog. Urol., 1994, 4, 181-184.
24. McLAUGHLIN J.K., FRAUMENI J.F., NYREN O., ADAMI H.O.
Silicon breast implants and risk of cancer? J.A.M.A., 1995, 273, 116.
25. NAU J.Y. L’Académie de Médecine recommande d’informer sur les
risques de Creutzfeld Jakob. Le Monde, 1er juin 1997, p. 12.
26. OPPENHEIMER B.S., OPPENHEIMER E.T., DANISHEFSKY I.,
STOUT A.P., EIRICH F.R. Further studies of polymers as carcino-
genic agents in animals. Cancer Res., 1955, 15, 333-340.
27. PALCHEFF-WIEMER M., CONCANNON M.J., CONN V.S., PUC-
KETT C.L. The impact of the media on women with breast implants.
Plast. Reconst. Surg., 1993, 92, 778-785.
28. POTTER M., MORRISON S., WIENER F., ZHANG X.K., MILLER
F.W.Induction of plasmocytomas with silicone gel in genetically sus-
ceptible strains of mice. J. Natl. Cancer Inst., 1994, 86, 1058-1065.
29. REINBERG Y., MANIVEL J.C., GONZALEZ R.Silicone shedding
froml artificial urinary sphincter in children. J. Urol., 1993, 150,
694-696.
30. SILVER R.M., SAHN E.E., ALEEN J.A., SAHN S., GREENE W.,
MAIZE J.C., GAREN P.D. Demonstration of silicon in sites of
connective-tissue disease in patients with silicone-gel breast
implants. Arch. Dermatol., 1993, 129, 63-68.
31. TANG L., EATON J.W.Inflammatory responses to biomaterials.
Am. J. Clin.Pathol., 1995, 103, 466-471.
32. VAN NUNEN S.A., GATEMBY P.A., BASTEN A. Post-mammoplas-
ty connective tissue disease. Arthritis Rheum., 1982, 25, 694-697.
33. WICHAM M.G., RUDOLPH R., ABRAHAM J.L. Silicon identifi-
cation in prosthesis-associated fibrous capsules. Science, 1978, 199,
437-439.
____________________
SUMMARY
Patient information : progress in jurisprudence. Example of
silicone.
Medical procedures are performed in the context of a contract
between the physician and the patient. Failure to comply with
this contract may engage the physician’s responsibility.For a
long time, the physician’s responsibility was engaged because of
technical errors or, more rarely, lack of information or consent,
which had to be proved by the patient.
In the case of litigation, a recent decision by the Court of Appeal
(25 February 1997) requires physicians to demonstrate that they
have effectively and validly informed the patient.
This article studies the content of this information. It suggests a
method which, set up under the authority of scientific societies,
would allow, in our discipline, the proposal of information forms
designed to inform our patients and to preserve our responsibi -
lity.Finally, this approach is illustrated by the study of tolerabi -
lity of materials containing silicone.
Key-Words : Informed consent, silicone elastomers, adverse
effects.
____________________
192
1
/
5
100%