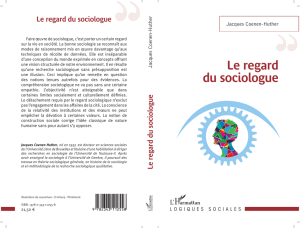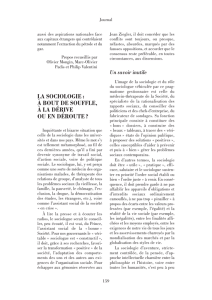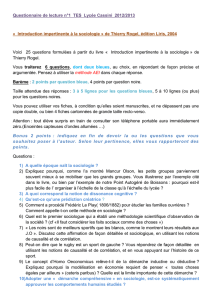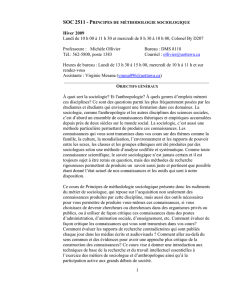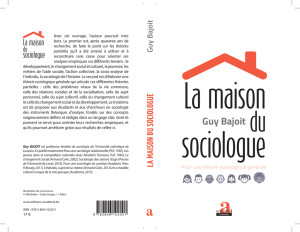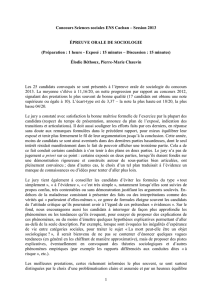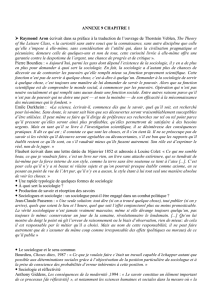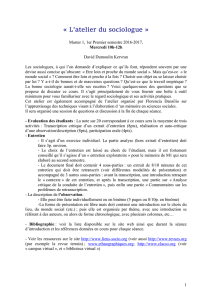sociologie - Daniel Vander Gucht

SOCIOLOGIE
DANIEL VANDER GUCHT
Année académique 2008-2009
Université libre de Bruxelles

TABLE DES MATIERES
1. Le métier de sociologue 1
Sociologie spontanée et sociologie savante 1
L’objet de la sociologie 3
Du problème social au problème sociologique 7
L’engagement du sociologue 11
Liberté et déterminisme 14
2. Genèse de la sociologie 24
Sociétés traditionnelles et sociétés modernes 24
L’histoire ou le changement social 25
La pensée utopique 27
Individualisme et rationalisme 29
Du contrat social 30
De la philosophie morale à la philosophie de l’histoire 31
De la physique sociale à la sociologie 38
3. L’étude du social 44
Sociologie et psychologie 44
La science du social 49
Du fait social à l’action sociale 52
4. La logique du social 66
La pragmatique de la communication 66
L’interaction symbolique 77
5. Le système social 85
Les paliers de la vie sociale 85
L’idéologie et ses avatars 86
La stratification sociale 89
Le contrôle social 95
6. Le travail sociologique 100
L’expérimentation en sociologie 100
La méthode sociologique 101
La boîte à outils du sociologue 104

1. LE MÉTIER DE SOCIOLOGUE
Sociologie spontanée et sociologie savante
Une première difficulté qu’on éprouve à essayer de définir la sociologie tient au fait qu’elle
n’a pas à véritablement parler d’objet qui lui soit propre. Tout regroupement humain est
susceptible d’une analyse sociologique dans la mesure où les comportements des individus
en société sont déterminés parce que d’autres individus nous ont inculqué et orientés vers
d’autres individus qui sont les destinataires, réels ou imaginaires, de nos actions. Il n’est pas
même nécessaire qu’il y ait trois, ni même deux personnes en situation d’interaction pour
qu’il y ait société ; car la société est intériorisée en chacun d’entre nous, comme l’attestent
nos rêves, par exemple. Il est en effet douteux qu’un individu développe des idées, des
modes d’expression, des comportements qui n’aient pas été en partie façonnées par la
culture de sa famille ou de sa communauté (pensons à la langue que nous parlons, à notre
façon de nous habiller, à nos goûts et habitudes alimentaires, etc.). La société est donc
inscrite (instituée disent les sociologues) en chacun de nous, et tout acte que nous posons,
toute chose que nous produisons, recèle une dimension sociale. L’objet de la sociologie ne
peut donc être circonscrit aux individus, aux groupes ou aux collectivités humaines, ni
davantage aux actions ou aux choses elles-mêmes, mais bien plutôt à la logique sociale qui
sous-tend ces actions, à la manière dont ces choses sont reliées entre elles, dans le contexte
d’une totalité que le sociologue tient pour signifiante.
On tient ici un élément très important qui permet déjà de cerner plus précisément, non pas
l’objet de la sociologie, mais sa nature contextuelle et relationnelle : la sociologie est une disci-
pline globalisante qui consiste à contextualiser les processus d’interactions sociales,c’est-à-dire
à reconstituer tout le réseau de relations, manifestes ou souterraines, matérielles ou mentales,
qui lie les choses et les personnes entre elles. Il s’agit évidemment, posé comme cela, d’un
projet démiurgique, impossible à atteindre avec nos maigres ressources, mais il indique bien
vers quoi tend la sociologie, à savoir une pensée de la compréhension de la complexité du
monde. En corollaire, on pourra avancer que la sociologie se définit par une méthode qui auto-
rise à prendre pour point de départ de sa réflexion à peu près n’importe quel élément de la
réalité sociale, aussi insignifiant, prosaïque ou futile puisse-t-il paraître, dès lors que la méthode
sociologique va restituer cet élément dans la totalité de ses relations signifiantes.
Une seconde difficulté à identifier clairement le sociologue tient au fait que, à l’instar de
Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, nous faisons tous de la sociologie
sans le savoir. Il y a bien entendu une différence entre les conversations de café du
commerce et les colloques de sociologie (enfin en principe), mais ce que je veux dire, c’est
1

que nous sommes tous amenés à pratiquer dans notre vie quotidienne une forme de ce que
Claude Javeau a appelé la « sociologie spontanée ». Le simple fait de pouvoir se débrouiller
dans la vie suppose que l’on mobilise des ressources qui sont autant de compétences
sociales : comme de ne pas confondre un agent de police avec un membre de l’armée du
salut, de ne pas utiliser sa fourchette comme peigne à cheveu au restaurant ou de ne pas
planter un couteau dans le dos du prof qui vous a busé.
Ce que montrent ces exemples triviaux, c’est que la vie quotidienne implique que chacun
ait non seulement intériorisé un certain nombre de règles de vie en société, mais qu’il nous
faut aussi disposer d’une véritable intelligence pratique du social pour savoir quand et
comment les appliquer. En effet, ces règles de bonne conduite deviennent en quelque sorte
automatiques dès lors qu’elles constituent notre sens commun, mais elles demeurent
toujours relatives, c’est-à-dire propres à une société, à une culture, à une classe ou à un
groupe social donnés, comme en attestent les bonnes manières ou les bonnes mœurs.
Il y a toutefois une différence entre Monsieur Jourdain qui fait de la sociologie sans le savoir
et un vrai sociologue. La différence tient dans le fait que le sociologue essaye de mettre au
jour, de dévoiler et d’expliciter ces mécanismes sociaux pour en tirer des lois de la vie en
société, mais aussi des enseignements utiles pour tout un chacun dans la conduite de sa vie
comme pour la vie de la cité en amenant à prendre conscience de tous les mécanismes,
partiellement inconscients et automatiques, qui dictent notre conduite, qui déterminent nos
actions, mais aussi nos idées, nos jugements, nos goûts sans que nous ne nous en rendions
compte, tant ils sont parfaitement intériorisés et profondément enfouis en nous par l’effet
de notre éducation et de notre milieu — ces mécanismes qui nous laissent croire que nous
libres de penser ce que nous pensons et d’aimer ce que nous aimons, alors que nous n’avons
pas encore commencé à nous demander pourquoi nous pensons ce que nous pensons et
pourquoi nous aimons ce que nous aimons.
C’est du reste ce que la plupart des gens ne feront jamais, par facilité, confort ou confor-
misme, car toute organisation sociale est ainsi faite que ses institutions nous préparent à
nous conformer à la norme, non à la contester — encore moins à la questionner. Parce que
nous n’avons pas choisi notre éducation alors que nous en sommes en partie le produit, la
contestation de l’ordre établi, de l’état des choses, de « ce qui va de soi » ne vient pas natu-
rellement mais naît souvent par la rencontre avec d’autres façons de penser, de sentir, de faire
qui peuvent nous déconcerter, nous désarçonner, nous faire perdre nos repères, nous faire
douter de nos évidences,nous ouvrir à d’autres expériences possibles. La rencontre avec l’al-
térité, cet autre incarné notamment par la figure de l’étranger que nous sommes tous à
certains moments de notre existence, est déterminante dans la structuration de notre
2

personnalité.En effet, en nous confrontant à des univers insoupçonnés, à des mondes sociaux
peu familiers, à des codes nouveaux, à des conceptions du monde divergentes ou différentes
de la nôtre, nous prenons progressivement conscience, dans ce processus de réflexivité
critique, tout à la fois de la relativité et du caractère inachevé (c’est-à-dire toujours en voie
de construction) de notre condition humaine, mais aussi de la richesse que représentent nos
différences et notre complexité constitutive. « Je est un autre » écrivait Rimbaud. Cette
magnifique formule nous ramène à la posture fondatrice de la sociologie, qui consiste en
cette distanciation qui, en nous rendant étrangers à nous-mêmes, comme le suggère cette
belle devise humaniste que le sociologue américain Charles Wright Mills proposait en guise
de programme pour la sociologie : « rien d’humain ne m’est étranger ».
L’objet de la sociologie
Le discours du sociologue semble toujours redoubler un discours plus trivial ; le sociologue
est toujours soupçonné de dire en termes difficiles, ronflants, pédants, ce que nous croyons
déjà savoir. C’est que l’objet de la sociologie n’est pas l’étude des astres ou des atomes, de
la chaîne d’ADN ou des fluctuations du CAC 40 — choses que nous ne voyons ni n’éprou-
vons directement, que nous ne prétendons donc pas maîtriser, et pour l’étude desquelles
nous avons un respect qui est à la mesure de notre ignorance, mais bien ce qui nous
concerne le plus immédiatement : notre vie de tous les jours, et plus précisément, sur cette
matière même dont est tissé notre ordinaire : les petits faits de la vie quotidienne (les gestes
approximatifs et mécaniques du lever, nos choix vestimentaires, notre façon de dresser le
couvert, nos manières de table, nos habitudes culinaires, nos conversations convenues avec
le chauffeur de taxi ou anodines avec la caissière du supermarché, notre façon de faire la
queue dans le métro ou de nous curer le nez dans les embouteillages, la drague, l’ennui, le
rire, etc.) ; mais aussi bien les représentations de sens commun (nos convictions, nos préjugés,
ce que nous croyons savoir du monde et des autres, notre façon de penser et de juger, nos
goûts, etc.).
Il est vrai qu’il n’est pas besoin d’être grammairien ou linguiste pour pouvoir s’exprimer et
se faire comprendre, de même qu’il n’est point besoin pour le chauffeur de taxi d’être carto-
graphe pour s’orienter dans la ville ni pour lire une carte. On reprochera donc souvent au
sociologue de jargonner inutilement pour énoncer des vérités triviales qui passent pour des
évidences aux yeux du profane, ou d’enfoncer des portes ouvertes lorsqu’il dénonce les
inégalités sociales, par exemple. De fait, le sociologue n’en sait pas plus que ses informateurs
ou ses concitoyens sur ce qu’ils vivent, mais il peut les amener à y réfléchir plus finement,
ou encore à démêler ce qui, précisément, relève de l’intuition et ce qui peut être corroboré
3
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
1
/
115
100%