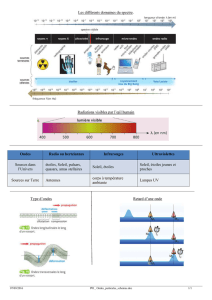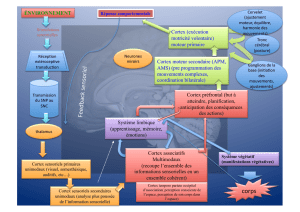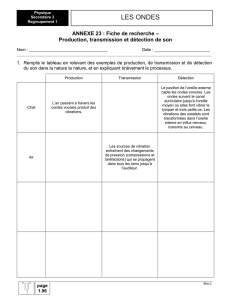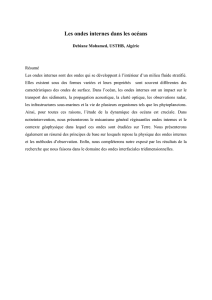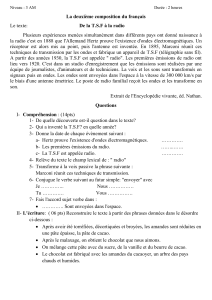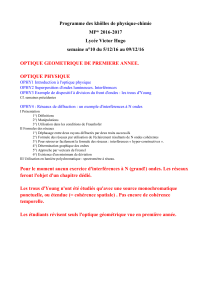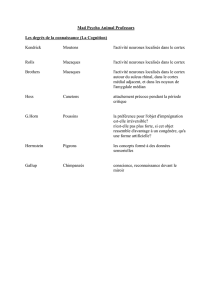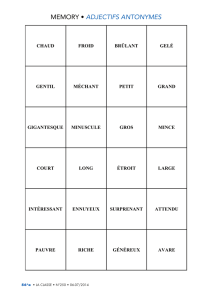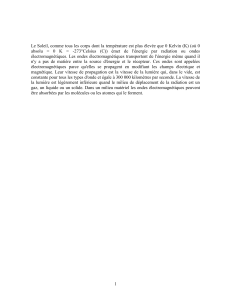MEG/EEG et mémoire

1
ANALYSE DES DYNAMIQUES SPATIO-TEMPORELLES
DES PROCESSUS DE MEMOIRE DE TRAVAIL :
APPORT DE LA MEG ET DE l’EEG
I - Introduction
L’étude des fonctions cognitives a grandement bénéficié des techniques d’imagerie
cérébrale qui permettent de décomposer les différentes étapes du traitement de l’information,
les sous-processus cognitifs, difficilement accessibles aux méthodes comportementales. Les
techniques ayant une bonne résolution spatiale, telles que la tomographie par émission de
positons (TEP) et l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), offrent la
possibilité de décrire les réseaux cérébraux impliqués dans les différentes fonctions
cognitives. La magnéto-encephalographie (MEG) et l’électro-encéphalographie (EEG), ayant
une excellente résolution temporelle (de l’ordre de la msec), sont des techniques appropriées
pour analyser les dynamiques temporelles d’activation des régions cérébrales sous-tendant les
processus cognitifs. Les signaux EEG résultent des courants cérébraux circulant dans le
volume extra-cellulaire ; courants générés principalement par les potentiels dendritiques post-
synaptiques. Les signaux MEG reflètent plutôt les courants de la branche intra-cellulaire,
c’est-à-dire les courants qui circulent de l’arborisation dendritique jusqu’au soma des
neurones. La MEG est peu sensible aux sources neuronales profondes (sources sous-
corticales) à cause de la décroissance rapide du signal magnétique entre son point d’émission
et son point d’enregistrement. Grâce à l’absence de distorsion des champs magnétiques lors
de la traversée des enveloppes cérébrales, la MEG offre une meilleure résolution spatiale que
l’EEG. La MEG et l’EEG sont des techniques complémentaires, car elles ne sont pas
sensibles aux même sources neuronales. La MEG prend en compte les sources orientées de
manière tangentielle par rapport à la surface du scalp, alors que l’EEG est davantage sensible
aux sources radiales. Ces deux techniques sont donc susceptibles d’apporter des informations
complémentaires sur les contributions corticales spécifiques aux processus cognitifs.
Au cours de cet exposé, nous nous intéresserons à l’apport des techniques d’imagerie
cérébrale, en particulier de la MEG et de l’EEG, dans l’étude des processus de mémoire de
travail. Nous verrons, à travers la présentation des résultats d’une étude, de quelle manière le
couplage des techniques MEG/EEG permet de mettre en évidence des processus cognitifs
distincts contribution à la réalisation d’une tâche de mémoire de travail visuo-spatiale.
II – Le Concept de Mémoire de Travail
Les études en psychologie cognitive et en neuropsychologie ont mis en évidence
l’aspect multi-unitaire de la mémoire (Baddeley, 1990). Elle apparaît, en effet, être dissociée
en processus discrets, distingués selon un certain nombre d’axes incluant la capacité de
stockage (limitée en temps et en quantité d’informations versus illimitée), l’accès à la
conscience (dissociation de processus conscients versus automatiques), le type de matériel
mémorisé (verbal versus visuospatial), et les systèmes cérébraux sous-jacents. La distinction

2
la plus fondamentale et la plus largement reconnue concerne la dichotomie entre Mémoire à
Court Terme (MCT) et Mémoire à Long Terme (MLT), portant sur la durée de mémorisation
des informations.
La MLT est caractérisée par une rétention de l’information sur une période de temps
indéterminée, par une capacité de stockage illimitée, par un codage en profondeur de
l’information (cf. les niveaux de traitement de l’information), et, au niveau synaptique, par
des modifications morphologiques impliquant la synthèse de nouvelles protéines. D’un point
de vue fonctionnel, deux grands types de mémoire sont distingués au sein de la mémoire à
long terme : la Mémoire Déclarative ou Explicite, faisant appel à des processus conscients et
portant sur des informations contextualisées ou non dans le temps et l'espace (respectivement
Mémoire Episodique et Mémoire Sémantique), et la Mémoire Procédurale ou Implicite,
impliquant des processus automatiques, et caractérisée par des apprentissages dissociés de
leur contexte spatio-temporel d'acquisition.
La MCT est définie par une rétention brève de l’information, de quelques secondes à
quelques minutes, une capacité de stockage limitée, un codage plus superficiel de
l’information, et, au niveau synaptique, par une facilitation de la transmission de l’influx
nerveux (synapses hebbiennes). Le concept de MCT ou Système de Mémoire Actif a été
largement reformulé en terme de Mémoire de Travail (MdT), modèle plus heuristique pour
expliquer les observations comportementales.
Le concept de mémoire de travail a été défini par Baddeley et Hitch (Baddeley et
Hitch, 1974 ; Baddeley, 1992) comme un système permettant de stocker et de maintenir en
mémoire à court terme des informations qui sont manipulées et utilisées lors de la réalisation
de tâches cognitives, comme la résolution de problème, la compréhension du langage, la
planification, …. Selon ce modèle, la rétention temporaire et la manipulation de l'information
lors de différentes tâches cognitives reposent sur le fonctionnement coordonné de trois sous-
composantes (schéma). Deux systèmes "esclaves" permettent le stockage temporaire de
l'information, soit sous forme verbale (la boucle phonologique), soit sous forme visuo-spatiale
(le registre visuo-spatial). Le système de la boucle phonologique, spécialisé dans le stockage
temporaire de l'information verbale, se compose d'un stock phonologique et d'un processus de
récapitulation articulatoire. Le registre visuo-spatial, responsable du stockage à court terme de
l'information visuo-spatiale, serait impliqué dans la génération et la visualisation des images
mentales. Il comporterait également un système de stockage de l'information visuo-spatiale et
un système de récapitulation. La boucle phonologique et le registre visuo-spatial seraient
contrôlés par un système central de gestion attentionnelle, l'administrateur central ("système
exécutif"). L'administrateur central, de capacité limitée, serait lui-même fractionné en sous-
composantes exécutives spécialisées et dissociables. Il aurait notamment pour fonction de
sélectionner les stratégies cognitives, de coordonner les informations en provenance de
différentes sources, de permettre la réalisation de deux tâches simultanément (cf. concept
d'attention divisée). L’administrateur central pourrait également affecter une partie de sa
capacité limitée de ressources attentionnelles à des opérations de stockage, afin d’accroître la
quantité d’informations pouvant être transitoirement maintenues en mémoire via les
« systèmes esclaves ». De manière générale, les fonctions exécutives portent sur la régulation
des processus opérant sur le contenu de la MdT. Ces fonctions incluent l'attention focalisée et
divisée, les processus d'inhibition liés à des informations non pertinentes, les processus de
contrôle impliqués dans la réalisation de tâches complexes, la planification de séquences de
sous-tâches dirigées vers un but (typiquement impliquées dans les tâches de type "Tour de
Londres" ou "Tour de Hanoï"), ainsi que l'accroissement des capacités mnésiques à court
terme par l'attribution de ressources de traitement supplémentaires (Baddeley, 1996).
Baddeley a proposé de distinguer au sein de l’administrateur central, d’une part, la

3
composante de planification et de contrôle (procédures de gestion) et, d’autre part, les
ressources de traitement (ressources attentionnelles).
La MdT est regroupe un ensemble de processus indispensables à la réalisation des
fonctions cognitives intégrées. Son caractère central dans la cognition a motivé un grand
nombre d'études en imagerie cérébrale.
Dans la suite de cet exposé, nous nous centrerons exclusivement sur l'analyse des
dynamiques spatio-temporelles d'activation des régions corticales impliquées dans les tâches
de MdT.
Modèle de la Mémoire de Travail de Baddeley et Hitch (1974)
III - Réseaux cérébraux impliqués dans les tâches de Mémoire de travail
A) Méthodes et paradigmes expérimentaux
Les méthodes d'études ayant permis de préciser les réseaux cérébraux sous-tendant la
réalisation des tâches de MdT incluent les enregistrements cellulaires unitaires et l'analyse des
effets des lésions chez le primate, les études neuropsycholgiques et en imagerie cérébrale
(utilisant le TEP et l'IRMf) chez l'Homme. Comme nous l'avons précisé ci-dessus, la MdT
concerne à la fois le simple maintien en mémoire d'une ou plusieurs informations pendant une
brève période temps et la manipulation de ces informations mémorisées en vue de réaliser une
tâche cognitive. Ainsi, les recherches sur la MdT incluent plusieurs dimensions, que nous
résumerons sous les termes de processus de stockage, de récapitulation et processus exécutifs.
Les études en imagerie cérébrales, fondées sur des protocoles mettant en jeu spécifiquement
chacune de ces dimensions, ont permis de révéler les régions corticales qui participent
sélectivement à ces processus. Les résultats obtenus jusqu'à présent sont essentiellement basés
sur la méthode de soustraction entre une condition impliquant un processus cognitif
spécifique et une condition contrôle, et la méthode des variations paramétriques, selon
laquelle un paramètre reflétant spécifiquement un processus varie quantitativement. Les
résultats obtenus par ces deux méthodes sont congruents. Deux types de tâches sont
fréquemment employées pour étudier les processus de MdT verbale: la tâche de
"reconnaissance d'item" et la tâche de "n-back". La tâche de "reconnaissance d'item" consiste
ADMINISTRATEUR CENTRAL
(système exécutif)
gestion des ressources
attentionnelles
contrôle et coordination
des opérations
de traitement
REGISTRE
VISUO-SPATIAL
rétention des
informations
visuo
-spatiales
+
formation et
manipulation
des images mentales
SYSTEME ESCLAVE PHONOLOGIQUE SYSTEME ESCLAVE VISUO-SPATIAL
BOUCLE
PHONOLOGIQUE
rétention des
informations verbales
+
système de
répétitionsubvocale

4
à présenter aux sujets un ensemble d'items cibles à mémoriser, par exemple un ensemble de
lettres, et, après un délai de quelques secondes, à présenter un seul item, nommé l'item sonde
(une lettre); les sujets ayant à décider si l'item sonde est le même qu'un des items cibles (tâche
nécessitant une recherche en mémoire). Dans la tâche de "n-back", des lettres sont présentées
successivement, chacune étant séparée de la suivante par un délai de quelques secondes. La
tâche consiste à décider si la dernière lettre présentée est identique à celle présentée un rang
("1-back"), deux rangs ("2-back") ou 3 rangs ("3-back") antérieurement. La tâche de
"reconnaissance d'item" met principalement en jeu la fonction de stockage, alors que la tâche
de "n-back" fait appel à la fois au stockage et aux processus exécutifs (Smith & Jonides,
1999). Les tâches d'appariement avec délai impliquent les processus d'encodage, de stockage
temporaire et de "rafraîchissement" (rehearsal) de l'information. Dans les tâches de type "n-
back", les sujets doivent également manipuler l'ordre temporel d'apparition des stimuli stockés
en mémoire.
D'une manière générale, la réalisation des tâches de MdT repose sur la coopération des
aires corticales postérieures et antérieures : aires pariétales (aires de Brodmann, BA 7 et 40),
aire prémotrice (BA 6) et aires préfrontales (BA 9/46, 10, 44, 45, 47) (Cabeza & Nyberg,
2000). Les traitements verbaux et visuo-spatiaux impliquent cependant l'activation de réseaux
neuronaux distincts (Smith et al, 1996). A partir d'une synthèse des études portant sur la MdT,
nous préciserons successivement les régions corticales impliquées dans les tâches de MdT
verbale, puis visuo-spatiale.
B) Réseaux cérébraux sous-tendant la MdT verbale
La réalisation des tâches de MdT verbale, utilisant le paradigme de "reconnaissance
d'item" implique l'activation du cortex pariétal postérieur gauche (BA 40), du cortex frontal
gauche (aire de Broca, BA 44), de l'aire motrice supplémentaire gauche (partie supérieure de
l'aire BA 6) et de l'aire prémotrice gauche (partie inférieure de l'aire BA 6) (Paulesu et al,
1993; Smith et al, 1998; Smith & Jonides, 1999; Cabeza & Nyberg, 2000). Lorsque la charge
en MdT augmente (par exemple, mémorisation de six items versus trois items), l'activation du
cortex préfrontal dorsolatéral est observée. La tâche de "n-back" produit l'activation du même
cluster de régions (BA 40, 6, 44), auquel se surajoute l'activation systématique du cortex
préfrontal dorsolatéral (BA 9/46) (Smith et al, 1998; Smith & Jonides, 1999).
L’activation des aires pariétales postérieures, latéralisées dans l’hémisphère gauche,
semble refléter spécifiquement le stockage phonologique; résultat cohérent avec les études
neuropsychologiques (Shallice, 1988).
Les régions frontales gauches, aire de Broca, aire motrice supplémentaire et aire
prémotrice, par ailleurs impliquées dans la préparation du langage, reflèteraient le processus
de répétition articulatoire subvocale, permettant d’augmenter le temps de maintien en
mémoire de l’information verbale par un rafraîchissement régulier du "buffer phonologique"
(Smith & Jonides, 1998). Le rôle fonctionnel de ces régions a été confirmé par une étude
(Awh et al, 1996), utilisant une tâche de "n-back", dans laquelle deux conditions étaient
introduites: condition avec répétition subvocale des lettres (demandée explicitement aux
sujets) et condition sans répétition (tâche de suppression articulatoire). La soustraction des
deux conditions a montré que l'aire de Broca, l'aire motrice supplémentaire et l'aire prémotrice
gauche, étaient spécifiquement activées dans la condition avec répétition subvocale. D'autres
études en TEP et IRMf confirment le rôle de l'aire de Broca et de l'aire prémotrice gauche
dans le processus de répétition subvocale (Smith et al, 1996; Schumacher et al, 1996; Jonides,
1997; Cohen, 1997; Braver et al, 1997; Smith et al, 1998). Ces régions frontales gauches sont
donc impliquées dans le maintien actif de l'information en MdT.

5
D'après les résultats obtenus dans les tâches de "n-back" et d'autres tâches de mémoire
de travail verbale, les fonctions exécutives (fonctions de manipulation, d’intégration et de
contrôle), dépendantes de l’administrateur central, semblent reposer principalement sur
l’activation du cortex préfrontal dorsolatéral (aires 9/46) (D'Esposito et al, 1995; Salmon et al,
1996; Smith et al, 1998; Collette et al, 1999). D'Esposito et coll. ont mené une étude sur la
MdT verbale destinée à dissocier les régions préfrontales spécifiquement impliquées dans le
maintien et dans la manipulation de l'information (D'Esposito et al, 1999). Deux conditions
expérimentales étaient proposées, l'une consistait à mémoriser une séquence de lettres pendant
quelques secondes ("condition maintien"); dans l'autre condition, les sujets devaient non
seulement mémoriser une séquence de lettres, mais également la réordonner selon l'ordre
alphabétique ("condition manipulation"). Les auteurs rapportent l'activation des cortex
préfrontal dorsolatéral (BA 9/46) et ventrolatéral (BA 45/47) dans les deux conditions, et une
activation significativement plus intense du cortex préfrontal dorsolatéral dans la "condition
manipulation". Il semblerait que le cortex dorsolatéral soit recruté non seulement dans les
tâches impliquant la manipulation et le "monitoring", mais également lorsque la quantité
d'informations à mémoriser dépasse les capacités du "stock phonologique" (D'Esposito et al,
1999). Ainsi, les tâches de MdT verbale impliquant uniquement le maintien de l'information
en mémoire sont sous-tendues par l'activation des régions pariétales postérieures gauches et
frontales gauches (Paulesu et al, 1993; Salmon et al, 1996; Schumacher et al, 1996; Smith et
al, 1996; Smith et al, 1998; Collette et al, 1999; Smith & Jonides, 1999), et les tâches verbales
à forte composante exécutive produisent, en sus des régions précitées, l'activation unilatérale
(hémisphère gauche) ou bilatéral du cortex préfrontal dorsolatéral, (Petrides et al, 1993a,
1993; D'Esposito et al, 1995; 1998; Salmon et al, 1996; Smith et al, 1998; Collette et al, 1999;
Carpenter et al, 2000.
C) Réseaux corticaux sous-tendant la MdT visuo-spatiale
Une ségrégation fonctionnelle des traitements au niveau du système visuel a été mise
en évidence chez le primate et chez l'homme (Mishkin et al, 1983; Van Essen & Maunsell,
1983; Wilson et al, 1993; Ungerleider et al, 1994; D’Esposito et al, 1995) . La voie ventrale
est spécialisée dans le traitement des informations visuelles non-spatiales (voie du "quoi") et
la voie dorsale dans le traitement des informations spatiales (voie du "où"). Cette ségrégation
semble être préservée jusqu'au niveau des aires corticales préfrontales impliquées dans les
processus de mémoire de travail (Wilson et al, 1993; Smith et al, 1995; Goldman-Rakic,
1996; Mc Carthy et al, 1996; Courtney et al, 1996).
Les tâches de MdT visuo-spatiales activent les aires occipitale, pariétale, prémotrice et
préfrontale dorsolatéral, avec une contribution plus importante de l’hémisphère droit, alors
que les tâches de MdT visuelles (objets/formes à mémoriser) induisent l'activation des aires
occipito-temporale, inférotemporale, et préfrontale (Smith et al, 1995). Ces résultats
impliquent qu'une constellation d'aires corticales distinctes est engagée dans les processus
d'encodage et de rétention en MdT des informations de type "spatial" et "objet".
La co-activation des cortex pariétal et frontal (en particulier du cortex préfrontal
dorsolatéral droit) a été mise en évidence chez le primate lors de la réalisation de tâches
visuo-spatiales avec délai de réponse, introduisant une composante mnésique (Fuster, 1973 ;
1982 ; 1989; Goldman-Rakic et al, 1987 ; Funahashi et al, 1989; Wilson et al, 1993 ;
Friedman et al, 1994 ; Caminiti et al, 1996 ; Johnson et al, 1996). Les cellules des cortex
pariétal postérieur et préfrontal présentent une activité soutenue lors du délai de mémorisation
d’une localisation spatiale (Ungerleider et al, 1998). L'aire intrapariétale latérale semble être
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
1
/
35
100%