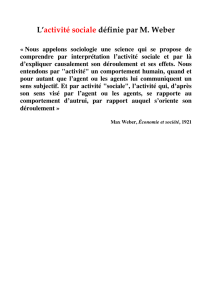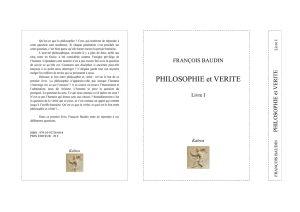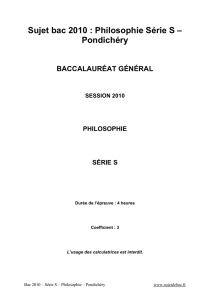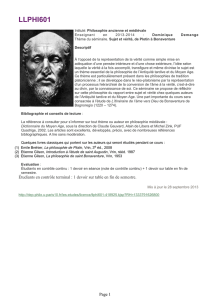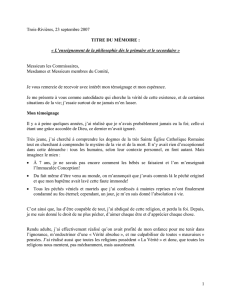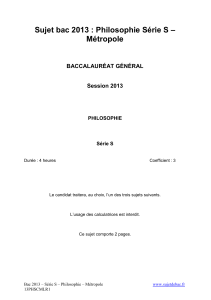Le vrai visage de la critique post-moderne

AGONE
Philosophie, Critique & Littérature
numéro 18-19, 1998
Neutralité & engagement du savoir
Illustrer le nécessaire engagement du savoir et les
illusions de la neutralité en refusant que la lutte
contre les différentes formes de travestissement de
notre connaissance et de notre histoire – c’est-à-
dire de notre mémoire – oublie la remise en cause
des usages du savoir. Parce que les acquis de
l’humanité doivent demeurer aux bénéfices du
plus grand nombre.
11. Éditorial. Investissements de compétences intellectuelles.
Thierry Discepolo
17. Le travail intellectuel au risque de l’engagement.
Daniel Bensaïd & Philippe Corcuff
On n’est jamais complètement «dégagé», malgré notre volonté de
neutralité ou nos hésitations, on n’est jamais seulement «engagé» de
manière consciente et volontaire. À chaque fois, on a plutôt à faire avec
une certaine façon de nouer du réfléchi et de l’irréfléchi, du volontaire
et de l’involontaire, de la raison et du corps, de l’intelligible et de
l’expérience sensible, de l’engagement dans le monde et de l’engagement
par le monde. Mais si, pour les sciences sociales comme pour la
philosophie, le non-engagement est impossible, cela signifie-t-il qu’il n’y
a plus de place pour l’autonomie des savoirs, dans une affirmation
fourre-tout commode où «tout est politique »?

4
29. De la neutralité du savoir à l’autonomie de sa production.
Thierry Discepolo
Il ne semble pas seulement que le terme de «neutralité» – postérité
encombrante – soit la source de quiproquos nuisibles ; et que celui
d’« axiologique » ne fasse qu’aggraver les choses en dissimulant que ce
sont aussi des valeurs qui fondent la connaissance scientifique.
L’impératif de neutralité axiologique n’est trop souvent devenu
aujourd’hui que l’occasion d’une posture aristocratique… J’aborderai la
nécessaire possibilité de fonder en raison nos décisions : c’est en tant
que producteur d’un savoir scientifique – que Max Weber jugeait neutre
et que Pierre Bourdieu définit comme autonome –que le savant est
engagé dans la transformation du monde parce que ce savoir entre dans
notre compréhension et nos actions.
47. Le vrai visage de la critique post-moderne.
Noam Chomsky
Traduit de l’anglais par Jacques Vialle
Avant-propos de Jacques Vialle
Abandonner le projet des Lumières reviendrait à laisser libre cours à
une version de l’histoire directement mise au service des institutions
régnantes. Dans les moments d’agitation sociale, beaucoup sont
capables de découvrir les vérités que leur cachent les leaders d’opinion.
Mais quand l’activisme décline, la classe des «commissaires du
peuple » reprend les commandes. Puisque les intellectuels de gauche
abandonnent aujourd’hui le terrain, les vérités qu’ils avaient autrefois
défendues n’ont plus qu’à se réfugier dans les mémoires individuelles et
l’histoire à être récupérée comme un instrument de domination. Aussi
valable et méritante que puisse être la critique de la «rationalité»… la
seule chose qui soit suggérée en est le rejet pur et simple ; une voie qui
risque de conduire directement au désastre ceux qui ont le plus besoin
de soutien en ce monde. C’est-à-dire la grande majorité des hommes, et
de façon urgente.
63. Sciences sociales & société contemporaine : l’éclipe des garanties
de la rationalité.Immanuel Wallerstein
Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton & Jacques Vialle
Nous devons admettre que les sciences sociales ne sont pas
parfaitement désintéressées, puisque les scientifiques sont inscrits dans

5
la réalité sociale et ne peuvent pas plus faire abstraction de leur esprit
que de leur corps… Nous devons admettre que nos vérités ne sont pas
des vérités universelles, que s’il existe des vérités universelles, elles sont
complexes, contradictoires et plurielles. Nous devons admettre que la
science n’est pas la recherche du simple, mais la recherche de
l’interprétation la plus plausible du complexe. Nous devons admettre
que les raisons pour lesquelles nous nous intéressons aux causes
efficientes est qu’elles nous servent d’indicateurs sur la voie de la
compréhension des causes finales. Nous devons enfin admettre que la
rationalité implique le choix d’une politique morale, et que le rôle des
intellectuels est de signaler les choix historiques qui sont collectivement
à notre disposition.
87. Le caractère évaluatif de la science sociale wébérienne.
Une provocation. Pietro Basso
Traduit de l’italien par Giovanna Russo
Dans l’« imaginaire » collectif de la communauté des chercheurs Max
Weber est le grand théoricien du caractère «non-évaluatif » des
sciences sociales. Ce serait lui l’« analyste pur » qui, hors de toute
doctrine préconçue, a fondé la sociologie «rigoureusement
scientifique ». En est-il tout à fait ainsi ? Je ne le crois absolument pas.
Le moins qu’on puisse dire est que son œuvre contient deux façons de
lire le rapport entre science et société: l’une «non-évaluative » et
l’autre tout à fait «évaluative ». Mais on peut aller plus loin encore en
soutenant que la seconde, au fond, l’emporte sur la première. Surtout
si, comme on le devrait, on met au premier plan sa manière
«concrète » de faire de la sociologie plutôt que sa théorisation de la
tâche du savant et des procédés des sciences sociales. Enfin, si l’on
mesure celle-ci à celle-là – et non le contraire.
97. «La question du maximum » : capitalisme et pensée unique.
Jack London (& Jacques Luzi)
La succession des siècles a été marquée non seulement par l’ascension
de l’homme, mais par celle de l’homme du peuple. Depuis l’esclave, ou
le serf attaché à la glèbe, jusqu’aux postes supérieurs de la société
moderne, il s’est élevé, échelon par échelon, dans l’effritement du droit
divin des rois et la chute fracassante des sceptres. Qu’il n’ait fait tout
cela que pour devenir l’esclave perpétuel de l’oligarchie industrielle,
c’est une chose contre laquelle tout son passé proteste. L’homme du

6
peuple mérite un meilleur avenir, ou alors il n’est pas à la hauteur de
son passé. Avec son siècle d’âge, cet écrit est significatif d’un type de discours
sur la «chose économique » qui tranche avec l’idéologie néolibérale – pensée
conforme à un monde unidimensionnel dans son objectif social ultime :
l’accumulation du capital.
119. Mettre la génétique à la disposition de l’humanité… Entretien.
Philippe Froguel
Questionnaire établi par Jacques Vialle
L’honneur de la recherche publique bio-médicale est de contribuer à
enrichir les connaissances des mécanismes du vivant et des anomalies à
l’origine des maladies, pour les mettre à disposition de l’humanité…
Depuis peu, la compétition scientifique s’est déplacée dans le domaine
industriel et même spéculatif : la possession exclusive de connaissances
est devenue un élément de valorisation boursière comme un autre, ce
qui conduit à une gestion purement capitalistique des résultats de la
recherche. En pratique, cela signifie que les sociétés de bio-technologie
et leurs alliés industriels n’ont pas comme objectif de présenter leurs
résultats au monde, mais de les garder secrets en espérant en tirer un
jour bénéfice.
125. Démission des philosophes.
Paul Nizan
Avant-propos de Thierry Discepolo
Les jeunes gens qui débutent dans la philosophie seront-ils longtemps
encore satisfaits de travailler dans la nuit sans pouvoir répondre à
aucune interrogation sur le sens et la portée de la recherche où ils
s’engagent ? Il est grand temps d’offrir à ces nouveaux venus une
situation franche. Beaucoup d’entre eux sont emplis de bonnes
intentions, beaucoup d’entre eux se sont engagés dans la philosophie
parce qu’ils ont été troublés par le désœuvrement de ces bonnes
intentions. Ils éprouvent, d’une façon peu claire sans doute, que la
philosophie en général est la mise en œuvre des bonnes intentions à
l’égard des hommes. Mais il faut saisir et enseigner que certaines
philosophies sont salutaires aux hommes, et que d’autres sont mortelles
pour eux, et que l’efficacité de telle sagesse particulière n’est pas le
caractère général de la philosophie.

7
139. Un engagement politique peut ouvrir le champ ethno-
graphique…Entretien.Alban Bensa
Propos recueillis par Thierry Discepolo & Isabelle Merle
L’émergence de la protestation kanak n’a produit ni rupture dans ma
pratique ethnologique, ni même un détournement de mes
préoccupations scientifiques. L’explosion politique des Kanaks m’a au
contraire permis de poser des questions d’ordre anthropologique,
sociologique ou historique que je ne m’étais pas assez posées avant…
Nous devons suivre un projet scientifique autonome qui ne se voile pas
la face. C’est une leçon historique que le progrès scientifique passe par
l’interprétation de situations politiques sans que cette interprétation
soit décontextualisée… C’est un mensonge que de laisser supposer qu’il
puisse y avoir, dans les sciences sociales, un discours scientifique
indépendant de ses conditions d’énonciations.
155. «Permanent » de la lutte contre la guerre d’Algérie ? Mémoires.
Pierre Vidal-Naquet
Avant-propos de Thierry Discepolo
Ma rage historienne me tenait toujours, plus que jamais. Avant que le
silence ne retombe, je voulais prouver définitivement que la torture
avait été une affaire d’État. Effectivement, dès le 2 mars 1955,
l’inspecteur général de l’administration, Roger Wuillaume, avait
recommandé l’usage du tuyau d’eau et de la magnéto concédés aux
seuls officiers de police judiciaire. J’amassai ainsi une énorme
documentation particulièrement riche pour l’époque de la IVe
République. D’où venaient mes dossiers ? Pour les années 1954-1958,
principalement de «traîtres », de «grands commis » en rupture avec
l’État… Mon livre La Raison d’État parut aux Éditions de Minuit en avril
1962, après Évian, et juste à temps pour mentionner l’amnistie totale
qui avait été accordée par le gouvernement aux tortionnaires et aux
tueurs de tout acabit.
173. La fin des fictions Wolfgang Hildesheimer
Traduit de l’allemand par Pierre Deshusses
Avant-propos de Thierry Discepolo & Pierre Deshusses
J’ai toujours eu des réticences à considérer l’activité d’écrivain comme
une véritable profession. En fait, je ne l’ai jamais considérée comme
telle, mais bien plutôt comme le privilège temporaire de pouvoir dire
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
 241
241
 242
242
 243
243
 244
244
 245
245
 246
246
 247
247
 248
248
 249
249
 250
250
 251
251
 252
252
 253
253
 254
254
 255
255
 256
256
 257
257
 258
258
 259
259
 260
260
 261
261
 262
262
 263
263
 264
264
 265
265
 266
266
 267
267
 268
268
 269
269
 270
270
 271
271
 272
272
 273
273
 274
274
 275
275
 276
276
 277
277
1
/
277
100%