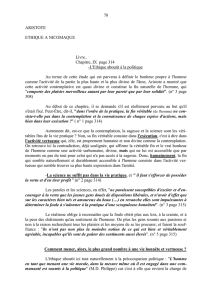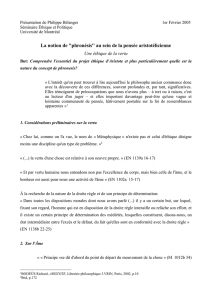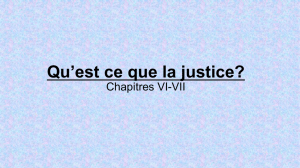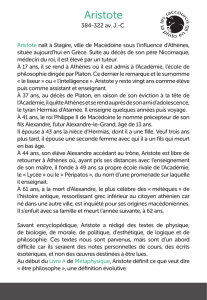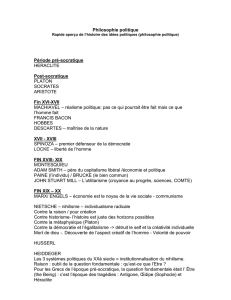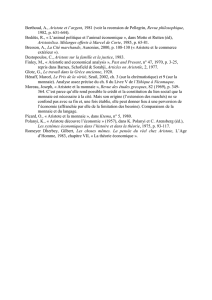ARISTOTE, Éthique à Nicomaque, Livres I, VI et X Le bonheur et l

ARISTOTE, Éthique à Nicomaque, Livres I, VI et X
Le bonheur et l’action
Stage de formation continue des professeurs de philosophie de l’académie de Versailles
Organisé du 19 au 20 novembre 2013 et du 15 au 16 janvier 2014
Matinée de travail collectif conduite par Vincent SULLEROT
Compte-rendu de Jeanne Szpirglas
Vincent Sullerot débute la séance par la présentation des livres I et VI de l'Ethique à
Nicomaque et des remarques portant sur l'ordre variable des chapitres de l'ouvrage.
L'introduction souligne le sens de l'éthique conformément à la distinction que propose
Paul Ricoeur entre l'éthique conçue dans une perspective téléologique et la morale
affirmée dans sa dimension prescriptive. L'éthique d'Aristote souscrit bien à cette
distinction, proposant une morale du « il faut » et non du « tu dois », habitée par la
reconnaissance de la contingence des choses et de la finitude des hommes. Cette
« philosophie des choses humaines » n'est pas toutefois dépourvue d'ambiguïté
puisqu'elle reconnaît la finitude tout en appelant à « s'immortaliser » autant qu'il est
possible, ambiguïté qui se retrouve dans la tension entre la vie éthique et la vie
contemplative.
Le premier texte étudié est extrait du livre I et traite du bien auquel tous les êtres
aspirent. De ce souverain bien – expression qui est un héritage des traductions latines,
en grec to ariston signifie le meilleur et met l'accent sur la comparaison – les conceptions
divergent mais il n'est pas un genre ou une forme séparée. La science du bien est donc
impossible mais aussi inutile pour bien faire car le bien ne peut être fait qu'en particulier
dans la production comme dans l'action. Selon un schème technique, il doit exister une
vertu ou une excellence qui permette à l'homme d'accomplir sa fonction propre :
l'activité de l'âme raisonnable.
La comparaison avec la production
Le texte est structuré sur une comparaison, et une spécification du domaine de la
production dont la norme est l'art, et du domaine de l'action qui est ici son objet propre.
La production a son effet en dehors de l'agent, l'action a son effet en lui-même ; elle est
intransitive. L'art concerne un devenir, or ce qui devient est affecté par la précarité et la
contingence. L'art est donc lié au possible. La rigueur semble bien nécessaire dans l'art
mais la production de l'artisan est comme modulée par le matériau auquel il faut
s'adapter. C'est à partir de cette nécessité de l'adaptation de l'artisan que la comparaison
devient analogie.
Peut-on penser une règle de l'action ?
Le livre I est émaillé de remarques de méthode et traite donc conjointement du bien et
de la façon dont discours et pratique doivent se régler sur la nature des choses, fut-elle

!
2!
incertaine. De quelle précision est susceptible la philosophie pratique ? Parce qu'elle a
rapport à ce qui se produit le plus souvent et résulte de l'expérience, elle ne peut rien
déterminer avec nécessité. Mais la contingence du monde n'exclut pas des régularités
fréquentielles soit une forme de fréquence relative donc au fond de constance. On peut
donc approcher de la vérité « d'une façon grossière et approchée ».
Méthodologiquement, la modalité se conserve des prémisses à la conclusion : de ce qui
est indéterminé, la règle aussi est indéterminé. La règle conserve donc une part
d'indétermination qui fonde l'approximation du discours mais non de l'action qui ne
supporte pas l'approximation. L'action suppose de descendre au cas particulier ultime,
infime, de faire consister la connaissance générale dans la reconnaissance de la
singularité des situations. Il y a bien un impératif de précision en ce sens, mais non d'une
exactitude mathématique. La précision s'applique notamment à l'identification du
moment propice ou kairos. Il sait guetter ce moment et ces circonstances qui « tombent
à pic ». Cette forme paradoxale de précision est également à l'oeuvre dans l'application
de la loi qui doit comme la règle de Lesbos, épouser les irrégularités pour produire un
tout ordonné. C'est en quoi consiste l'équité (cf intervention de J.M. Muglioni).
La culture
La culture est impliquée dans la formation du jugement : être cultivé c'est porter un
jugement qui tombe juste (Parties des animaux, livre I). Paradoxalement, l'éducation et
la culture sont requises pour renoncer au géométrisme et saisir la pluralité irréductible
des discours. L'homme cultivé sait ne pas tout confondre. Mais la généralité de la culture
générale ne peut résulter que de l'expérience de la vie, ce qui rend impossible aux jeunes
gens d'accéder à la sagesse pratique. S'ils ne peuvent posséder la prudence, la réussite
leur est ouverte dans les sciences abstraites qui ont affaire à des réalités séparées.
La prudence
La phronesis se rapporte à cette partie de la raison tournée vers l'action. Le désir est
l'instance motrice car la raison délibère mais ne meut pas. La prudence réalise donc une
synthèse pratique par où l'intellect désire ou le désir raisonne. La notion de volonté n'est
pas présente chez Aristote. C'est ainsi que le dernier moment de la délibération coïncide
avec le moment de l'exécution sans l'intermédiaire d'un vouloir. Les expressions « contre
son gré » et « à son gré » s'appliquent également aux animaux. C'est sans doute la
valorisation moderne de la liberté de la volonté qui a fait tomber la prudence en
désuétude. La prudence est une vertu active. « disposition accompagnée de raison
tournée vers l'action et qui porte sur les biens humains. » tournée vers le futur qui est
contingent.
Le prudent
Aristote invite à se tourner vers les exemples d'hommes prudents et notamment Périclès.
La prudence ne se comprend en effet que par l'homme prudent. La prudence n'est rien
en dehors du prudent. Ce dernier se fait en lui-même dépositaire de l'humanité qui se
constitue dans son acte et se distingue de l'habile qui sait agir conformément à ses
propres fins et tourner les situations à son avantage. Sa disposition à la vertu est
acquise, ce qui signifie que devenant interne au sujet, elle ne peut être oubliée. Elle ne
relève pas pour autant de l'application mécanique d'une règle.

!
3!
Antoine LÉANDRI
La place de l'amitié dans l'Ethique à Nicomaque, Livres VIII et IX
L'éthique à Nicomaque présente un paradoxe : l'amitié parfaite, véritable, a pour objet la
vertu mais on aime aussi l'ami pour ce qu'il est. L'amitié consiste donc à aimer quelqu'un
pour ce qu'il est et/ou à aimer quelqu'un pour sa vertu.
Nature de l'amitié
Aristote parle de l'amitié comme d'une certaine vertu mais qui ne relève pas d'une
disposition. Le courage est par exemple une disposition dans la durée. Par deux aspects
au moins, il est difficile de penser l'amitié comme une disposition : elle suppose en effet
deux individus. Il s'agit donc d'un prédicat à deux places. Or comment acquérir une
disposition à deux ? Ensuite, on est ami en acte et non en puissance. Socrate avait tort
de réduire la vertu à un savoir mais il avait raison d'associer la vertu au développement
d'un certain type d'intelligence (livre VI). Les deux sont en effet étroitement liés,
entrelacés. L'habileté ou intelligence technique se transforme en phronesis sous l'effet de
la vertu (VI, 13), mais la vertu naturelle, sous l'effet de l'intelligence, se transforme en
vertu éthique. Chacune des deux est l'effet de l'autre. L'amitié est vertu si on est ce dont
on ne peut être séparé. L'amitié parfaite présuppose la vertu or comme toutes les
catégories se disent de la substance, toutes les catégories de l'amitié se pensent par
rapport à l'amitié parfaite qui en donne le sens directeur soit celui qui commande la
compréhension des autres sens. L'amitié parfaite surgit comme un événement dans une
vie. Mais la vie en société qui est nécessaire à l'acquisition des vertus éthiques, favorise
indirectement l'amitié parfaite.
L'amitié est vertu parce qu'elle n'a lieu qu'entre des hommes vertueux. Le Livre IX (9)
demande si l'homme vertueux a besoin d'amis. Il a besoin d'amis pour s'encourager à la
vertu, dans une relation spéculaire qui parachève sa vertu, de même que le plaisir
parachève la vertu sans en être la conséquence logique.
L'objet de l'amitié
Aime-t-on l'autre pour ce qu'il est ? Si on aime une personne pour ses qualités, on
n'aime finalement jamais personne, conclut Pascal comme une conséquence de la
présupposition d'un moi substantiel (Pensées, Fragment?). A moins de considérer par
quiddité ce que l'essence a de spécifiant, la socratéité de Socrate. L'amitié véritable ne
vise pas une qualité ni l'être même de l'ami. Comment comprendre dès lors que son
objet soit la vertu et l'articuler avec la proposition précédente ? Qu'est-ce qui permet de
dire qu'aimer un homme pour son être, c'est la même chose que l'aimer pour sa vertu ?
En premier lieu, c'est que la vertu est unificatrice. Elle unit d'une part et bien souvent les
vertus entre elles, elle unit également l'intelligence et le désir. Le méchant est
insaisissable. Le vertueux est proprement quelqu'un, et l'unité de la vertu fait de lui un
être tel que Etre et Un deviennent interchangeables. En second lieu, la vertu nous donne
de la stabilité. Le bonheur ne saurait être conçu sans cette durée ; il n'y a pas à
proprement parler d'instant heureux. C'est pourquoi la question se pose quant au
bonheur de Priam et la possibilité de le déterminer au terme de son existence. Cette
détermination ressortit d'une identité narrative, du récit qu'on peut faire de sa propre
vie. Aristote montre qu'il y a un moyen d'échapper aux aléas de l'existence et à l'aporie

!
4!
de Solon : la vertu. Elle délie en effet notre bonheur des circonstances et se pérennise en
nous comme une seconde nature. Se trouve ainsi résolu le problème de Pascal : aimer
l'autre pour sa vertu, c'est l'aimer pour quelque chose d'inaliénable, d'inoubliable. La
vertu n'est pas oubliable parce qu'elle fait partie de soi. Mais ceci suppose un exercice et
une habitude qui en fassent non seulement une disposition acquise mais une disposition
irréversible. Du reste, on aime quelqu'un pour ce qu'il a fait de sa nature et non pour ce
que la nature a fait de lui.
L'amitié et individualité
Si c'est la vertu qu'on aime en chacun de ses amis, alors on rencontre en eux le même et
au lieu que l'amitié soit la rencontre de deux singularités, elle est la convergence de deux
vertus parfaitement rationnelles. De l'amitié à la philanthropie, la conclusion devrait être
bonne. Or l'amitié d'Aristote a pour objet l'individu. L'idée non de subjectivité mais
d'individualité est bien présente en Grèce et Arendt commente en ce sens la formule
d'Homère : les hommes sont appelés les mortels. Dans le monde homérique, les
hommes sont mortels parce que la naissance de l'un ne remplace pas la mort d'un autre.
La réalité individuelle est une réalité irremplaçable. Cette individualité se traduit par une
amitié envers soi-même ou amour de soi (philautia), dont la structure est identique à
celle de l'amour de l'autre. Personne ne choisirait de posséder tous les biens de la terre
au prix de perdre son identité. Si l'objet du désir n'est pas nous mais Dieu, il est inutile
de le désirer. Dieu peut être conçu comme la lumière qui nous éclaire ; nous sommes
alors des intellects patients. Les averroïstes pensent que ma singularité disparaît avec
moi et que c'est là la conception d'Aristote. Demeure ce qui n'est pas de l'ordre de
l'individualité. Mais le désir de l'homme ne peut pas se satisfaire de l'existence de Dieu
après notre mort. Nous sommes certes des êtres dont le propre est de posséder une
partie divine et nous devons en ce sens nous efforcer de devenir ce qui est autre en
nous. Mais cette divinisation ou immortalisation ne doit nous conduire à perdre notre
individualité et la vie éthique consiste précisément dans la reconnaissance de ce qui nous
échoie. L'identité personnelle n'implique pas l'identité substantielle mais la possibilité de
répondre : c'est moi qui l'ait fait ou c'est à moi de le faire. Ce n'est pas non plus une
question de singularité et c'est peut-être pourquoi la vertu désigne l'excellence qui m'est
propre et qui coïncide néanmoins avec ce que nous avons en commun. On retrouve la
différence entre l'essence de Socrate, son humanité et sa quiddité, la socratéité, qui est
une certaine façon d'accomplir la première. Il y a de la rétrospection dans la
détermination de la quiddité, d'où la question de Solon sur Priam. C'est le temps,
éventuellement lu à rebours, qui permet de passer du générique au singulier.
Sophia et phronesis sont les vertus qui correspondent à la vie contemplative et la vie
active, qu'il ne faut pas penser opposées. Il y a bien une tension entre l'ici et maintenant
de la vie éthique et une vie contemplative qui doit maintenir l'individualité.

!
5!
Jean-Louis POIRIER, Sur l’acte volontaire,
ARISTOTE, Éthique à Nicomaque, Livre III, ch. 7
Compte-rendu de Vincent ALAIN
Références
Platon, Protagoras, 345d- 358d ; Gorgias, 467c (et suiv.) et 509e (et suiv.) ; Ménon, 77b
à 78, Les lois, livre 5, 731 (et suiv.), et livre 9, 860 d. .
Aristote, Éthique à Nicomaque, livre III, chap. 7 et livre VI, chap. 12, livre VIII, chap. 3 à
5. Sur le Syllogisme pratique: Éthique à Nicomaque, livre VII, chap 5, 1146 b et suiv.;
De anima, troisième partie, chap. XI, 435a-16 ; Mouvement des animaux, chap. 7, 701a
et suiv..
I. Fil conducteur
Aristote est aussi platonicien que Platon, peut-être plus. Le titre du chapitre 7 du livre III
discute donc un thème platonicien : « nul n’est volontairement pervers, ni malgré soi
bienheureux »1 . Cette citation n’est pas de Platon. Elle renvoie cependant à l’approche
intellectualiste de la vertu par Socrate. La vertu est une science. Faire le bien exige de le
connaître. Aristote ne s’inscrit pas en faux contre cet intellectualisme. Il en précise
l’analyse spécifique en entrant dans des détails que Platon n’examine pas. Il est donc
nécessaire de repartir de Platon.
II. La vertu comme science selon Socrate
L’occurrence la plus importante se trouve dans le Gorgias en 467b. Il s’agit d’établir que
le tyran ne fait pas ce qu’il veut. Il fait ce qui lui apparaît le meilleur. Cette thèse
deviendra la « formule » bien connue « des écoles »2 , nihil appetimus, nisi sub ratione
boni. Le problème est ici celui de la fin et des moyens. La volonté porte sur la fin et non
sur les moyens. Socrate en conclut que le tyran ne fait pas ce qu’il veut, si la fin
recherchée lui est désavantageuse. Le tyran est ignorant. Il ignore où se trouve son
avantage (Ménon 77d). Le tyran commet donc une erreur de jugement. Elle s’apparente
à une erreur de calcul. L’attrait du plaisir n’explique pas, comme le croît Calliclès, la
recherche par le tyran de la puissance et du pouvoir. Le comportement du tyran
s’explique uniquement par un jugement faux. Le tyran n’a pas compris que la toute-
puissance représentait pour lui un dommage. La tyrannie ne relève donc pas de l’affect,
mais de l’intellect. Bref, l’ignorance est la cause de l’acte mauvais. Ce n’est pas une
pulsion qui nous pousse au mal, mais une analyse défaillante (Protagoras 358c). Aristote
rejette-t-il cette thèse en affirmant que le vice « dépend aussi de nous »3 ?
III. L’acte volontaire selon Aristote
Aristote reprend les analyses de Platon. Aristote est platonicien au sens où il reprend les
mêmes problèmes que Platon et il les résout en demeurant socratique. Aristote propose
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Aristote,!Éthique(à(Nicomaque,"III,!7,!1113b,!15‐16.!!
2!Kant,!K.p.V.,!V.,!A.K.,!59.!!
3!Aristote,!op.(cit.,!III,!7,!1113b,!6‐7,!trad.!Tricot,!p.!140.!!!
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%