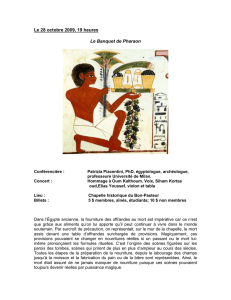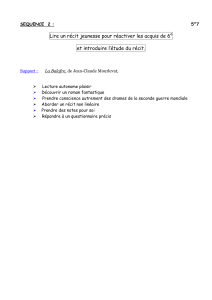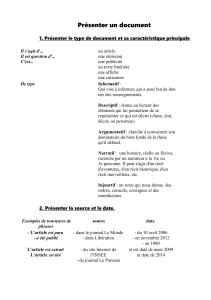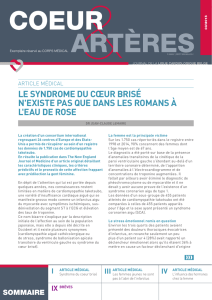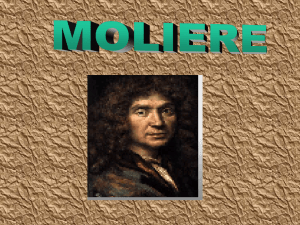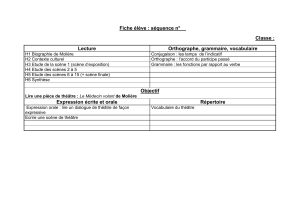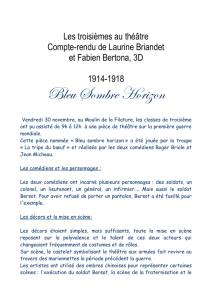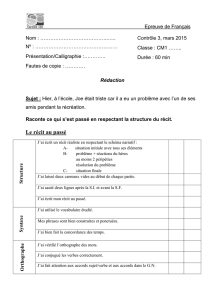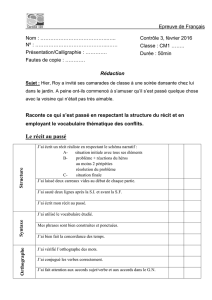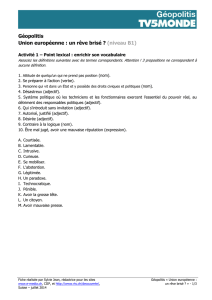Doubrovsky dramaturge

14 avril 2008 Claude Coquelle p 1 sur 8
!!06 12 37 95 43!!–![email protected]
Doubrovsky dramaturge
Lorsque j’ai pour la première fois écrit à Serge Doubrovsky pour lui demander l’autorisation de
porter à la scène Le livre brisé, il m’a aussitôt répondu positivement, par un petit mot très
aimable, dans lequel il précisait « il y a déjà eu plusieurs projets d’adaptation à la scène ou à
l’écran, mais aucune n’a jusqu’à présent abouti ». Il va sans dire que cette information était un
peu intimidante : allions-nous réussir là où d’autres, sans doute mieux armés que nous en
ressources de toutes sortes, avaient dû abandonner ? Dans les mois qui ont suivi, alors que
nous baignions entièrement dans cette aventure extrêmement intense, sur le plan intellectuel,
mais aussi émotionnel, existentiel, moral, etc., il nous est même arrivé d’être sensibles aux
résonances éventuellement irrationnelles de cette information : ce « livre monstre1 » serait-il
porteur d’une sombre malédiction, vouant à l’échec, voire aux pires tourments ceux qui osaient
tenter de se l’approprier, comme la momie Inca des Sept boules de cristal ?2
Plus sérieusement, cette information est restée dans mon esprit comme une énigme : comment
est-il possible que le potentiel dramatique extraordinaire du livre brisé, et plus généralement
de l’œuvre autofictionnelle de Serge Doubrovsky n’aient pas été plus souvent exploités ?
Je rapprocherai cette question d’une autre, que Denis Guenoun avait choisie comme titre d’un
ouvrage à mes yeux essentiel : le théâtre est-il nécessaire ?3 Cet essai est consacré à ce qu’il
est convenu d’appeler la « crise » du théâtre contemporain. Selon Guenoun, elle provient de ce
que le régime sous lequel le théâtre a existé, dans nos sociétés, pendant quelques siècles, est
devenu aujourd’hui impraticable. Ce régime était celui de la représentation : l’acteur joue un
personnage dont il est bien distinct, et auquel il ne peut s’identifier que grâce à cet écart bien
affirmé ; le public se fond en un spectateur, sujet abstrait coupé de toute détermination sociale
et négation de toute hétérogénéité interne ; le spectateur s’identifie au personnage, qui lui
permet de vivre par procuration ce que le public ne peut vivre lui-même. Après avoir évoqué le
théâtre antique, qui reposait sur des bases tout à fait différentes (ce qui nous permet de
mesurer le caractère historiquement daté, donc provisoire, de notre vision habituelle), Guenoun
montre que, aujourd’hui, le théâtre ne peut plus reposer sur un tel régime. Et cela
principalement en raison de la diffusion et du perfectionnement du cinéma : celui-ci dispose,
pour remplir le programme de la représentation, de moyens expressifs qui lui donnent une
puissance et une efficacité sans commune mesure avec les meilleures représentations théâtrale.
A vouloir continuer à lutter sur ce terrain, le théâtre est perdant d’avance : il sera conduit
immanquablement à la faillite ou, malheureusement bien plus souvent, à l’ennui.
Pourquoi alors le théâtre subsiste-t-il ? Pourquoi les spectateurs continuent-ils à se rendre
dans ces lieux pour y passer des heures pas toujours très passionnantes ? Uniquement dans
une visée de distinction sociale, comme le suggérerait Bourdieu, ou pour y vivre une des ces
expériences grégaires devenues aujourd’hui trop rares (le même mouvement qui mène les
foules aux match de football ou sur le bord des défilés) ?
1 Rappelons que c’est ainsi qu’il était désigné, au moment de sa parution, par un bandeau ajouté au volume.
2 L’aventure a finalement abouti, pour trois représentations données en avril 2006 au théâtre Le garage, à Roubaix, que
je remercie une fois encore pour son accueil. Les comédiens étaient Laurence Brassart, Claude Coquelle, Thibaud
Defever, Isabelle Haas, Sarah Pheulpin, François Rose.
3 Denis Guenoun, Le théâtre est-il nécessaire!?, Circé «!penser le théâtre!», 1997

p 2 / 8
Claude Coquelle!–!14/04/08 Doubrovsky dramaturge.doc
Pour Guénoun, ces réponses passent à côté de l’essentiel : la transformation profonde du sens
de l’expérience théâtrale avec l’émergence d’un nouveau régime dramatique, qu’il résume
ainsi : « Le théâtre est, désormais à nu, le jeu de la présentation de l’existence dans sa justesse
et sa vérité » (p 163)
Mon hypothèse est que l’on trouve, dans les œuvres autofictionnelles de Doubrovsky, et tout
particulièrement dans Le livre brisé, tous les ingrédients nécessaires pour élaborer un théâtre
répondant à cette définition, et donc un théâtre répondant aux exigences de notre époque. Je
relèverai cinq caractéristiques de ces textes, des plus généralement présentes dans l’écriture
Doubrovskienne aux plus particulières au Livre brisé.
1. La musique des mots
Il y a d’abord, bien sûr, la langue de Doubrovsky, sa manière particulière d’agencer les sons et
les rythmes, et qu’il décrit ainsi, en la qualifiant d’écriture consonantique : « Je laisse les mots
s’accrocher les uns aux autres selon leur son, selon leur sens. Il y a des associations de mots
comme il y a, en analyse, des associations d’idées. C’est une écriture automatique. Je joue
quand même avec le signifiant et cela provoque un type d’écriture très particulier, qui est le
jeu : jeux de mots mais surtout le jeu des mots ». Je ne rentrerai pas dans la description
technique de ce style, qui a été développée avec beaucoup de précision dans plusieurs autres
communications de ce colloque. Je voudrais par contre insister sur sa portée expressive.
Doubrovsky lui-même, et quelques commentateurs, la réfèrent à son expérience de la
psychanalyse : ce serait la seule forme capable de rendre compte de la spécificité de la vie
psychique inconsciente. Cela suppose une adhésion à la psychanalyse que je ne partage pas, et
vis-à-vis de laquelle Doubrovsky lui-même semble avoir pris aujourd’hui ses distances.
Bien plus probante me paraît la référence à la musique, qu’il aborde immédiatement après dans
l’entretien déjà cité, pour justifier son usage parfois très spécifique de la ponctuation : « Un
texte, c’est un mouvement musical. La ponctuation classique ne permet pas d’élaborer la
musique du langage qui correspond aux soubresauts, à la rapidité ou au ressassement de la
vie mentale, subjective. Je ne fais pas cela pour être moderne, ce n’est pas une recherche
formelle, c’est un besoin ; c’est mon solfège4. »
De fait, si l’on cherche d’autres exemples d’écriture comparable, c’est bien du côté de la
musique qu’on les trouvera, plus spécifiquement du côté du lyrique, alliance de musique et de
mots, de l’opéra de Wagner (en particulier dans L’anneau du Nibelung) à la chanson (on
pourrait citer de nombreux passages de Bobby Lapointe ou de Nougaro, par exemple).
Aujourd’hui, le rapprochement qui s’impose avec le plus d’évidence, malgré l’ampleur du fossé
social qui sépare les deux univers, est le slam. Quand, pour ne citer qu’un exemple, Grand
Corps Malade déclame : « c’est pas du Shakespeare, mais j’sais qu’y a pire », comment ne pas
faire le rapprochement avec les « alors, qui ? avant Kay, quoi ? » ou « je me scrute l’occiput, je
fore mon for intérieur » et autres « libations ad libitum5 » ?
Tout cela peut paraître bien futile rapporté aux références psychanalytiques, philosophiques ou
littéraires, mais pour une pratique théâtrale soucieuse de relever les défis décrits par Guénoun,
4 Entretien paru dans le n°10 des Moments littéraires
5 Toutes les citations sans référence proviennent du Livre brisé et figuraient dans l’adaptation que nous avons portée à la
scène.

p 3 / 8
Claude Coquelle!–!14/04/08 Doubrovsky dramaturge.doc
c’est une base essentielle, car elle permet de porter à la scène, de donner à voir et à entendre
cette dimension sensible de l’existence « désormais à nu » qu’est l’articulation du verbe et du
corps.
Car quel dommage de réserver des phrases telles que celles-là à la lecture silencieuse ! Opéra,
chanson, slam sont avant tout des arts de la scène, et le texte Doubrovskien semble destiné à
les rejoindre au plus vite sur le plateau. Un tel langage porte littéralement les corps des
comédiens, cette écriture « en rafales de mitraillette » les entraîne dans un rythme plus proche
de la danse que des laborieuses conversations du théâtre classique.
Dans notre travail d’adaptation, nous nous sommes efforcés de valoriser au maximum cette
potentialité, en privilégiant, dans la sélection du texte, les passages les plus « percussifs ». Mais
aussi en faisant le choix, qui s’est d’emblée imposé à nous, d’un accompagnement musical
continu par un musicien improvisant sur scène aux côtés des acteurs (après avoir un moment
cherché du côté des percussions, nous avons finalement opté pour la guitare : dans la première
partie, la basse prenait pratiquement la place des percussions tout en disposant de ressources
mélodiques parfois précieuses ; dans la seconde partie, la guitare électrique prenait le relais
comme, dans le texte du narrateur, la plainte succède à la déclamation).
2. Le jeu des styles
La deuxième caractéristique immédiatement apparente du texte Doubrovskien est son
hétérogénéité. Elle apparaît au simple feuilletage d’un livre : d’un chapitre à l’autre, parfois à
l’intérieur d’un même chapitre, l’apparence typographique change sensiblement, comme si l’on
avait fait un collage de textes de natures différentes, voire de langues aux écritures
différentes : parfois manquent les majuscules en début d’alinéa, début qui se trouve parfois
reporté en milieu de ligne ; parfois manquent totalement les ponctuations ; ou bien l’espace
normal est remplacé par un blanc plus important ; ou bien encore on voit apparaître de
nombreux passages en italique, ou des mots en capitales. Et, bien entendu, cette variété des
apparences correspond à une variété des postures expressives : on passe de la description ou
du récit le plus construit au flux de pensée le plus désordonné, de la narration à la première
personne au dialogue rapporté (et généralement commenté à chaque réplique), de la plainte la
plus triste à la blague la plus légère, etc.
On est bien loin de ce qui est l’un des carcans dont cherche à se libérer le théâtre
contemporain : la codification classique des genres. Tragédie, comédie, tragicomédie… nous
avons tous appris les définitions à l’école. Éventuellement, on ajoute des sous-genres, ou des
genres plus récents (le burlesque, l’absurde…) ou plus anciens (l’épopée, le conte…).
Nombreux sont les praticiens et les amateurs de théâtre qui se sentent aujourd’hui à l’étroit
dans ces catégories : s’il s’agit de montrer le jeu de l’existence, la première exigence semble
être de la montrer dans toute ses ambiguïtés. L’existence n’est ni tragique, ni comique, ni
tragicomique, ni burlesque, ni absurde, ni épique : on peut dire qu’elle n’est rien de tout cela,
mais on peut la regarder comme un peu tout cela à la fois.
D’où le plaisir que nous avons pu prendre (et tenter de partager) à mélanger dans une seule
représentation autant de genres que possible, en nous appuyant sur toute la gamme disponible
dans le texte du Livre brisé : on commence, avec la demande en mariage, par de véritables
scènes de boulevard (que nous avions un moment envisagé de compléter par une séance vidéo
de style sitcom) ; on glisse, avec le mariage lui-même, dans le pur burlesque (que nous avons
renforcé en incluant une séance vidéo jouant sur le contraste entre le texte, évoquant les rues

p 4 / 8
Claude Coquelle!–!14/04/08 Doubrovsky dramaturge.doc
de New-York, et les lieux où se trouvait le théâtre et où nous avons tourné : les rues de
Roubaix) ; puis s’enchaînent quelques scènes de « conversation au salon » « à la Tchékhov »
avant de virer au drame psychologique, avec l’expérience de l’IVG ; pour souligner la joie de Ilse
lorsque Serge consent à conserver un enfant, nous avons introduit une séquence de comédie
musicale, en utilisant « j’aime une Tyrolienne » des Comedian Harmonist, reprise par
l’ensemble de la troupe ; aussitôt après, nous sommes en pleine tragédie, avec la mort
d’Alexandre et les scènes de « beuveries » et de violence ; finalement, toute la seconde partie
baigne dans une ambiance « théâtre d’avant garde post-moderne ».
Jouer ainsi avec les codes est d’abord, bien sûr, une source de satisfaction esthétique. Nous
avons également pu l’utiliser pour mieux marquer le mouvement général de la pièce, de son
début à sa fin, qu’on pourrait décrire comme un glissement progressif vers la catastrophe :
commencer dans le rire et finir dans les coups et les larmes permet de faire vivre physiquement
aux spectateurs ce qu’a été l’expérience des personnages.
Plus sérieusement, la variation des styles est un moyen de déclencher cette distanciation que
Brecht appelait de ses vœux pour le théâtre en général : il s’agit de rappeler à tout moment que
ce que nous avons sous les yeux, ce n’est pas la réalité mais une représentation codée de la
réalité. Et que, si on avait voulu, on aurait pu tout raconter comme une comédie ou tout comme
une tragédie ou une histoire absurde… et donc que toutes les autres conventions de
représentation, au spectacle comme dans les vie ordinaire, sont elles aussi arbitraires et
peuvent être analysées et discutées.
C’était tout particulièrement important dans le cas du Livre Brisé, dans la mesure où il s’agit
d’une œuvre autobiographique, donc où le narrateur se présente comme relatant des faits réels
de sa propre vie. Or, en l’occurrence, il s’agit pour une bonne partie de faits qui peuvent
heurter, et dans lesquels le narrateur-auteur donne de ses propres attitudes et comportements
une image singulièrement peu flatteuse. Autant le genre autobiographique impose d’identifier
l’auteur et le narrateur, autant il reste essentiel de bien distinguer ceux-ci du personnage, qui
est bien une création de l’auteur, qui s’appuie évidemment sur des caractéristique réelles de
son modèle, mais qui les sélectionne, les agence et les formule comme il l’a jugé bon, et
certainement pas « comme c’était ». C’est tout particulièrement clair dans ce sous-ensemble du
genre autobiographique qu’est l’autofiction, où l’auteur recrée totalement certaines scènes, en
particulier des dialogues qui n’ont pas pu se dérouler ainsi dans la réalité, mais que le
spectateur risque de prendre pour argent comptant parce qu’il les a sous les yeux : il est
essentiel de rappeler à tout moment qu’on est dans l’ordre du « on fait comme si », comme
dans ces jeux d’enfants qui commencent par un « on dirait qu’on serait… ».
3. Le regard et la honte
Le genre autobiographique est né en se présentant lui-même comme un genre difficile (à
écrire) : on se souvient que Rousseau, qui pensait n’avoir pas de prédécesseur, affirmait aussi
ne pas pouvoir avoir non plus de successeur tant il lui semblait que peu de gens auraient le
courage de respecter l’exigence de dévoilement et de sincérité qu’il s’était imposée. On sait,
par de nombreux travaux critiques, qu’il est loin d’avoir été si loin qu’il le prétendait dans ce
projet de vérité « sans fard, sans slip, sans cache sexe », ce qui a ouvert parmi ses successeurs
(qui se sont finalement révélés extrêmement nombreux) une sorte de compétition à celui qui
irait le plus loin dans le fait de « repousser les limites du dicible ».

p 5 / 8
Claude Coquelle!–!14/04/08 Doubrovsky dramaturge.doc
Bizarrement, ce qui était présenté par Rousseau comme un projet à la fois héroïque, par le
courage qu’il demandait, et hautement moral dans sa visée est aujourd’hui souvent décrié dans
des termes diamétralement opposés : on reproche aux « littératures de l’ego » d’être à la fois
bien trop faciles et moralement suspectes. Retrouvant une inspiration moraliste qu’on aurait pu
croire dépassée depuis longtemps, on établit volontiers des parallèles avec la masturbation,
symbole de faiblesse de caractère et d’hédonisme irresponsable et asocial. Et bientôt le mot est
lâché : narcissisme, ce nouveau pêché capital qui réduirait à zéro la valeur de toute cette
littérature. Doubrovsky lui-même semble souvent parfois vouloir confesser ce péché (« moi
m’aime » ou « tu es au milieu de ton livre, et je n’en vois pas le centre – je trouve qu’il est assez
centré sur moi ») mais il en joue avec tant d’humour et de virtuosité que le moraliste ne peut
que se sentir désarmé, et lui accorder l’admiration qu’il sollicite.
Et tant mieux car, quoiqu’on en dise, se donner à voir n’est pas chose si facile que cela. Les
anciennes censures peuvent s’être un peu retirées, nous n’en sommes pas moins toujours aussi
sensible à la puissance du regard des autres sur nous. Narcissisme, voire exhibitionnisme ?
Pourquoi pas. Quel mal y aurait-il, après tout, à prendre du plaisir à provoquer l’admiration des
autres, voire à les bousculer en leur mettant sous les yeux des réalités un peu perturbantes ?
Mais il faut aussi compter avec l’autre volet de l’expérience : celui qui ouvre sur l’expérience de
la honte, lorsque nous confrontons la vérité de notre existence au regard désapprobateur
d’autrui. Il me paraît incontestable que Doubrovsky est un des auteurs qui, avec quelques
contemporains nettement plus jeunes, a poussé le plus loin la prise de risque en la matière.
Une prise de risque qui est en quelque sorte virtuelle quand il s’agit de littérature (puisque
l’auteur ne sera pas là quand le lecteur le découvrira tel qu’il ose se montrer), mais qui devient
très concrète dans le spectacle vivant. C’est ce que jamais le cinéma ne pourra prendre au
théâtre : cette présence réelle, corporelle, du comédien, à quelques mètres, devant les yeux du
spectateur, au point que celui-ci peut imaginer le toucher, et difficilement échapper au risque
d’être touché à son tour. On sait la vogue de la nudité qui a touché le théâtre et tout le
spectacle vivant (danse, cirque, performance) précisément à l’époque où se mettait en place la
crise dont nous parlions : c’est que c’est peut-être le meilleur symbole du passage de la
représentation (difficile aujourd’hui d’être encore bouleversé par la photographie d’un corps
nu) à la présentation de l’existence elle-même (difficile de ne pas être bouleversé quand ce
corps nu est là, devant moi).
Parmi les œuvres de Doubrovsky, le Livre brisé occupe à coup sûr une place à part, tant ce que
l’auteur-narrateur donne à savoir de lui-même est dérangeant. Si nous croyons ce qu’il nous en
dit, voilà que nous avons sous les yeux un homme qui vit avec une femme simplement parce
qu’il est incapable de supporter la solitude, qui souhaite l’épouser pour des raisons fiscales, qui
lui impose d’avorter de l’enfant qu’elle désirait mettre au monde, qui se désintéresse d’elle
lorsqu’elle fait un fausse-couche dramatique, qui la frappe à plusieurs reprises et qui la
fragilise en lui donnant à lire ce qu’il écrit d’elle au point que, peut-être, cela la conduit à la
mort. Même si, encore une fois, nous prenons bien garde de ne pas oublier que c’est lui qui le
dit, que c’est lui-même qui a choisi de se présenter ainsi (dans la continuité d’un parti pris
d’autodérision qui marquait déjà ses œuvres précédentes, mais redoublé peut-être cette fois
d’une pulsion d’autopunition ou de purgation), il est impossible de ne pas être troublé à la
lecture. Mettre en scène un tel dévoilement, ce qui revient en quelque sorte à redoubler l’acte, a
été pour nous une expérience extrêmement troublante. Et de nombreux retours nous ont
amenés à penser que les spectateurs y ont été eux aussi très sensibles.
C’est pour souligner la place centrale de cette épreuve humaine essentielle de l’affrontement de
la honte devant le regard d’autrui que l’affiche du spectacle montrait… un regard (celui de l’une
des comédiennes interprétant le personnage d’Ilse). Et c’est pour la même raison que nous
avons placé en exergue des « programmes » distribués aux spectateurs dans la salle, le
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%