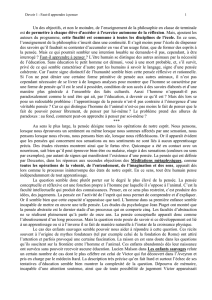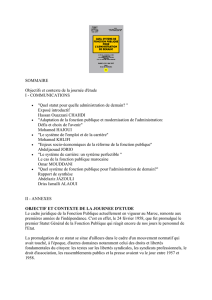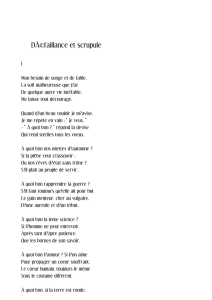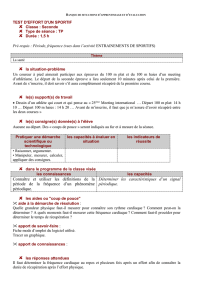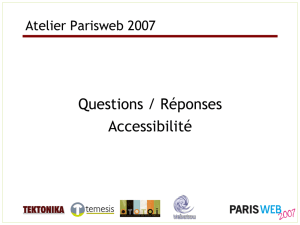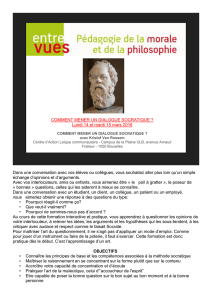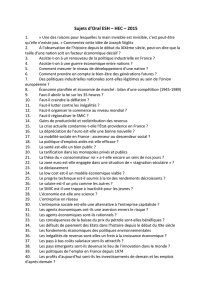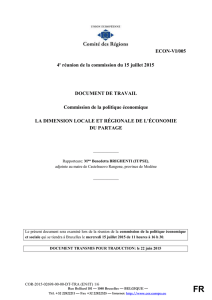Faut-il apprendre à penser - Dauphilo

Devoir sur table 1 : Faut-il apprendre à penser
1
Un des objectifs, et non le moindre, de l’enseignement de la philosophie en classe de terminale est de
permettre à chaque élève d’accéder à l’exercice autonome de la réflexion. Mais, ajoutent les
auteurs du programme, cette finalité est commune à toutes les disciplines de l’école. En ce sens,
l’enseignement de la philosophie s’inscrit dans une continuité. Il s’agit moins pour l’école de
dispenser des savoirs qu’il faudrait se contenter d’accumuler en vue d’un usage futur, que de former
des esprits à la pensée. Mais ce qui pourrait sembler une intention louable ne demande-t-il pas,
cependant, à être interrogé. Faut-il apprendre à penser ? L’être humain se distingue des autres animaux
par la nécessité de l’éducation. Sans éducation, le petit homme est démuni, voué à une mort probable,
et, s’il survit, privé de ce qui semble caractériser d’autre part les humains à savoir le langage, signe
d’une pensée cohérente. Car l’autre signe distinctif de l’humanité semble bien cette pensée réflexive et
rationnelle. Si l’on ne peut dénier une certaine forme primitive de pensée aux autres animaux, il n’est
pas cependant nécessaire de se livrer à de longues analyses pour montrer que l’homme se caractérise
par une forme de pensée qu’il est le seul à posséder, condition de son accès à des savoirs élaborés et
d’une manière plus générale à l’ensemble des faits culturels. Aussi l’homme n’apparaît-il pas
paradoxalement comme le seul être qui ait, par l’éducation, à devenir ce qu’il est ? Mais dès lors se
pose un redoutable problème : l’apprentissage de la pensée n’est-il pas contraire à l’émergence d’une
véritable pensée. Car, ce qui distingue l’homme de l’animal n’est-ce pas moins le fait de penser que le
fait de pouvoir penser librement, de penser par lui-même ? Le problème prend des allures de
paradoxes : au fond, comment peut-on apprendre à penser par soi même ?
Au sens le plus large, la pensée désigne toutes les opérations de notre esprit. Nous pensons, lorsque
nous éprouvons un sentiment ou même lorsque nous sommes affectés par une sensation, nous pensons
lorsque nous rêvons, nous pensons bien sûr, lorsque nous réfléchissons. Or il apparaît évident que les
pensées qui concernent nos sensations ou nos sentiments ne sont liés à aucun apprentissage précis. Des
études récentes montrent ainsi que le fœtus rêve. Quiconque a été en contact avec un nourrisson, sait
bien qu’il peut éprouver bien-être ou malaise, réagir à des sensations (couleurs ou sons par exemples),
par autant de signes qui manifestent l’existence d’une pensée. La pensée qui est définie par Descartes,
dans les réponses aux secondes objections des Méditations métaphysiques, comme toutes les
opérations de la volonté, de l’entendement, de l’imagination et des sens, apparaît dès lors comme
le processus ininterrompu des états de notre esprit. En ce sens, tout être humain pense
indépendamment de tout apprentissage. Les romanciers du début du vingtième siècle ne s’y sont pas
trompés en tentant de mettre en scène ce flux incessant de nos pensées dans des monologues
intérieurs. C’est ainsi que, Faulkner, dans « Le bruit et la fureur », décrit un simple d’esprit qui,
même s’il est, par la force des choses, presque totalement incapable d’apprendre ne cesse pourtant de
penser.
La question semble donc plutôt porter sur le degré le plus élevé de la pensée. La pensée conceptuelle
et réflexive est une fonction propre à l’homme par laquelle il s’oppose à l’animal. C’est la faculté
intellectuelle qui produit des connaissances. Penser, en ce sens plus restreint, c’est produire des idées,
des jugements. La pensée est l’activité de l’esprit qui nous permet de comprendre et d’expliquer. Or il
semble bien que cette capacité n’apparaisse que tard. L’homme dans sa première enfance semble
incapable de mettre en œuvre une telle pensée. Les études du psychologue Jean Piaget ont montré que
la pensée abstraite est le dernier stade d’un processus qui en comporte cinq. Jusqu’à deux ans, l’enfant
acquiert l’idée de la permanence des objets. À ce stade dit de la pensée sensori-motrice succède celui
de la pensée préopératoire (premier accès au langage), puis celui de la pensée intuitive (ou l’enfant
saisit le monde de manière purement pragmatique) enfin à partir de sept ans celui des opérations
concrètes (classement dénombrement, etc.). Les facultés d’abstraction ne se réalisent pleinement qu’à
partir de onze ans. La pensée conceptuelle apparaît donc comme l’aboutissement d’un long processus.
Mais la question reste posée de savoir si ce développement est lié à un apprentissage ou si à l’inverse
il se fait de manière naturelle à l’instar de la croissance physique.

Devoir sur table 1 : Faut-il apprendre à penser
2
Le cas des enfants sauvages semble pouvoir nous aider à répondre à cette question. Ces récits souvent
à l’origine de mythes fondateurs (tel par exemple celui de la fondation de Rome) ont attiré l’attention
et parfois provoqué une certaine fascination. La raison en est sans doute dans les questions qu’ils
suscitent sur la frontière entre l’homme et l’animal. Ces enfants abandonnés dès leur naissance ont
survécu sans pouvoir recevoir aucune éducation. Lucien Malson dans « Les enfants sauvages » un
certain nombre de cas dont le plus célèbre est celui de Victor qui fut découvert dans l’Aveyron et pris
en charge par le médecin Itard. La description très précise qu’en fait Itard et surtout l’échec de ses
tentatives d’éducation semble bien montrer la complexité de la question. Dépourvu de mémoire,
incapable d’une attention soutenue, ainsi que de toute possibilité de jugement Victor apparaissait
incapable de mettre en œuvre une pensée élémentaire (ainsi il ne pouvait penser à monter sur une
chaise pour atteindre un aliment hors de sa portée). La comparaison avec des enfants du même âge
élevés dans des conditions normales semble bien indiquer la nécessité d’un apprentissage. Il n’est pas
anodin que les efforts de Itard se soient portés (en vain) sur l’apprentissage du langage. La parole
signifiante n’est-elle pas le signe le plus évident de la pensée ?
* * *
Ainsi, les données de la psychologie semblent bien indiquer la nécessité d’un apprentissage de la
pensée. Sans éducation l’homme peut certes développer une forme de pensée minimale reflet de ses
sentiments ou de ses sensations, mais est incapable de mettre en œuvre ce qui fait l’essence de la
pensée humaine, l’activité intellectuelle abstraite et conceptuelle. Cependant le problème semble se
reposer de façon aiguë. Penser, tel que nous comprenons maintenant cette notion, ne peut se résumer à
reproduire ce que l’on a appris. Si l’homme se distingue de l’animal, c’est bien au sens ou sa pensée
est capable de s’arracher aux déterminations extérieures. Penser, au sens le plus noble de ce terme
n’est-ce pas penser par soi même ? On voit bien la difficulté liée à l’apprentissage de la pensée. Le lien
entre la nécessaire éducation et la pensée soulève un paradoxe redoutable. Apprendre à penser ne
conduit-il pas finalement à empêcher de penser ? Car comment enseigner la pensée sans par là,
enseigner des pensées ? La frontière entre éducation et conditionnement n’est-elle pas plus ténue
qu’elle ne le semble ?
On ne peut contester que nous pensions en fonction de l’éducation que nous avons reçue. Cette
éducation est elle-même déterminée par une culture un environnement social et même politique. Dans
les faits, il semble que nous n’apprenions pas seulement à penser, mais à penser de telle ou telle
manière. Les thèses culturalistes qui surdéterminent l’appartenance culturelle et peuvent conduire à
certaines formes de relativisme montrent à quel point la pensée d’un individu est enfermée dans des
catégories qui lui sont transmises. L’histoire et même l’histoire de la philosophie ne nous montre-t-elle
pas les plus grands penseurs prisonniers des errances de leur époque. Ainsi, par exemple, de la
légitimation de l’esclavage par de nombreux philosophes de l’antiquité. D’une certaine manière
l’éducation semble parfois un obstacle à une pensée digne de ce nom.
Mais il y a plus grave. L’apprentissage de la pensée peut se faire un instrument de domination. À
l’échelle d’un peuple, la propagande montre tous les dangers qui, potentiellement, sont présents dans
toute éducation à la pensée. Le nazisme avait fort bien compris quel parti l’on pouvait tirer de ce
nécessaire apprentissage. À travers les jeunesses hitlériennes, il s’agissait bien de former des
générations à une pensée conformes aux orientations idéologiques du pouvoir. De même, sur une
échelle plus réduite, il n’est pas anodin que de nombreuses sectes développent des programmes
d’enseignement sur les matières les plus diverses.
On pourrait objecter qu’il s’agit là de situations limites, d’une perversion de ce que serait un véritable
apprentissage. Mais ces exemples ne montrent-ils pas le danger inhérent à toute forme d’éducation à la

Devoir sur table 1 : Faut-il apprendre à penser
3
pensée ? Et ne montrent-ils pas surtout la nécessité, pour qui veut réellement penser, de s’arracher à
son éducation de tourner le dos à toute forme d’enseignement prétendant lui apprendre à penser ? On
pourrait lire en ce sens le projet cartésien tel qu’il se donne dans les premières lignes des Méditations
métaphysiques : « quelques temps que je me suis aperçu que, dès mes premières années, j’avais
reçu quantité de fausses opinions pour véritables, et que ce que j’ai fondé sur des principes si
mal assurés ne pouvait être que fort douteux et incertain ; de façon qu’il me fallait entreprendre
sérieusement une fois dans ma vie de me défaire de toutes les opinions que j’avais reçues en ma
créance et commencer tout de nouveau dès les fondements, si je voulais établir quelque chose de
ferme dès les fondements ». C’est bien ici la volonté d’une pensée réellement exigeante qui conduit
au rejet ce que l’on a appris. L’éducation apparaît non comme une condition de la pensée, mais comme
un obstacle qu’il faut surmonter.
***
Mais nous nous trouvons maintenant devant une alternative qui semble menacer de nous enfermer
dans une aporie. D’une part la pensée abstraite ne peut émerger sans une éducation, de l’autre cette
éducation semble nier toute possibilité pour l’homme d’une véritable pensée ? L’homme apparaît
comme enserré de toute part par l’animalité : d’un coté, sans éducation il est condamné à la sauvagerie
d’un loup, de l’autre trop éduqué, à la bêtise d’un perroquet. Mais plutôt qu’une impasse n’avons-nous
pas ici une indication précieuse sur ce que doit être un véritable apprentissage de la pensée. Celui-ci ne
suppose-t-il pas une constante vigilance éthique de l’éducateur, vigilance de tout instant qui se fonde
sur la distinction entre éducation et dressage. L’éducation et surtout l’éducation à la pensée ne doit-elle
pas toujours avoir comme idée directrice la liberté de pensée ?
Mais affirmant cela ne faisons-nous pas que déplacer le problème ou même, que renforcer la difficulté.
Comment en effet apprendre à quelqu’un à penser librement ? . Penser librement ce n’est pas penser
n’importe comment. D’une certaine manière, la méthode socratique apporte des éléments de réponse à
cette question. On pourrait analyser la maïeutique comme une tentative de libération de la pensée. Les
dialogues platoniciens mettent face à face deux interlocuteurs. L’un l’élève détient un faux savoir,
d’une certaine manière une pensée toute faite, qu’il subit plutôt qu’il ne la pense réellement. Face à lui
Socrate semble ne proposer aucun savoir. Il ne détient que des exigences de rigueur et de recherche de
vérité. Le travail socratique consiste à conduire son élève à détruire de lui-même ses propres préjugés,
ses idées illusoires. N’est-ce pas là une véritable éducation à une pensée libre ?
Pour autant la méthode socratique, peut rapidement montrer ses limites. Peut-on réellement apprendre
à penser sans dispenser aucun savoir et surtout sans une part importante de contrainte. C’est son
propre disciple qui semble désavouer Socrate. Platon dans la célèbre Allégorie de la caverne nous
montre que le difficile passage de l’ignorance au savoir ne peut se faire sans contrainte. Le philosophe
qui délivre les prisonniers doit affronter leur réticence doit les contraindre à surmonter la souffrance et
la peur engendrée par le passage difficile de l’obscurité à la lumière. Cette contrainte, en dernière
analyse, est liée à une dissymétrie entre l’éducateur et l’éduqué. Celui qui tente de conduire l’autre à la
pensée est déjà porteur d’un certain savoir. Sans doute n’y a-t-il pas d’éducation, même à une pensée
libre sans transmission d’un savoir. En ce sens, il n’y a pas d’éducation (au sens le plus fort du terme)
entre égaux. Les analyses de Hannah Arendt dans « La crise de l’éducation » peuvent nous être ici
d’une grande utilité. Éduquer c’est avant tout transmettre un monde. Apprendre à penser pourrait-on
dire suppose de la même manière une transmission. Mais ce que nous montre H.Arendt c’est que la
relation éducative doit prendre fin pour céder la place à une relation entre égaux : la relation politique.
On n’éduque que les enfants. Aussi s’il faut bien apprendre à penser cet apprentissage doit viser sa
propre fin. C’est en cela qu’il peut être un véritable apprentissage à une pensée libre. Celui qui à la
charge de faire passer la pensée de la virtualité à sa réalisation doit avoir comme exigence éthique de
se voir devenir un jour inutile. Et c’est bien en cela qu’un véritable apprentissage de la pensée se
distingue de la propagande ou d’un endoctrinement. Cet apprentissage est déterminé par l’essence
même de l’éducation et est enfermé dans les limites de cette éducation. Il faut certes apprendre à
penser, mais seulement à ceux qui par essence doivent être éduqués et pour qu’un jour ils n’aient plus
à l’être.

Devoir sur table 1 : Faut-il apprendre à penser
4
***
Aussi si l’homme possède la faculté de pensée, celle-ci n’est qu’une potentialité, une simple virtualité
qui demande un apprentissage. La pensée n’est pas le seul caractère lié à la condition humaine.
L’homme est aussi, et peut-être avant tout, un animal éducable. Mais cette éducation peut se définir
comme ce qui vise à sa propre fin. Une éducation réussie est celle qui est, à terme, devenue inutile.
Aussi apprendre à penser c’est apprendre à ne plus avoir besoin de quelqu’un pour nous guider. C’est
en ce sens Que Kant dans « Qu’est-ce que les lumières », peut tancer ceux qui au delà de la nécessité
de l’éducation reste encore dépendant d’autrui pour l’élaboration de leur pensée : Paresse et lâcheté
sont les causes qu’un si grand nombre d’hommes, après que la nature les eut affranchis depuis
longtemps d’une conduite étrangère (…), restent cependant volontiers toute leur vie dans un état
de tutelle, et qui font qu’il est si facile à d’autres de se poser comme leurs tuteurs. Cette absence
d’autonomie de la pensée ne pourrait-elle pas être entendue tout autant que, comme la conséquence de
la paresse et de la lâcheté, comme la marque d’une éducation qui a manqué son but ?
1
/
4
100%