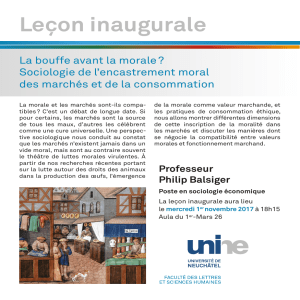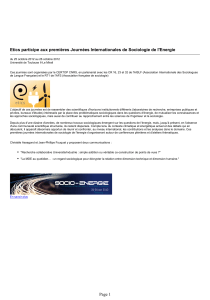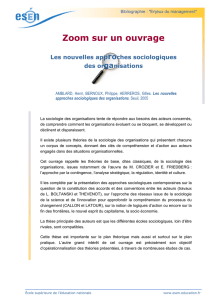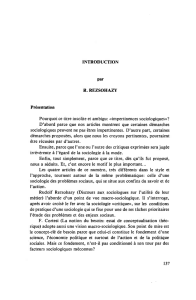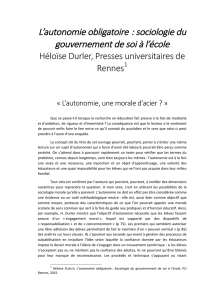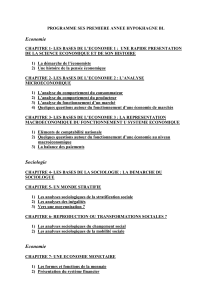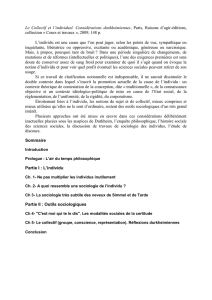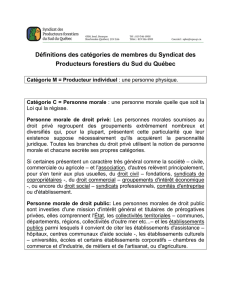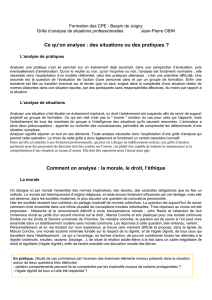MORALE ET NORMATIVITE EN SOCIOLOGIE Eléments sur les

A
SPECTS SOCIOLOGIQUES
,
VOL
.
18
NO
1,
MARS
2011
1
MORALE ET NORMATIVITE EN SOCIOLOGIE
Eléments sur les métamorphoses d’un objet
Régis CORTÉSÉRO
Appréhendée dans la perspective de l’installation des sociétés occidentales dans la
modernité par les sociologues « classiques », l’interrogation sociologique sur la morale a
fait l’objet d’une attention renouvelée au cours des deux dernières décennies, dans un
contexte de discrédit et de perte de confiance dans les schémas analytiques accolés au
triomphe de la Raison moderne. Cet article propose la chronique de cette mutation, en
resituant les changements de paradigme dans une histoire à la fois intellectuelle et sociale.
Mais il présente également une ambition critique et prospective, et tente de tirer les
enseignements des limites des approches contemporaines pour baliser le chantier d’une
possible sociologique de l’expérience morale.
Appréhendée dans la perspective de l’installation des sociétés occidentales dans la
modernité par les sociologues « classiques », l’interrogation sociologique sur la morale a
fait l’objet d’une attention renouvelée au cours des deux dernières décennies, dans un
contexte de discrédit et de perte de confiance dans les schémas analytiques accolés au
triomphe de la Raison moderne. Comment décrire ces mutations ? Quelles critiques et
quelles voies de dépassement ces renouvellements de perspective appellent-ils ?
Longtemps, les faits de valeur ont paru commander « du dehors », par un projet
moderne se réclamant de la Raison. Certaines sociologies ont cherché dans un social
réifié la source de valeurs qui conduiraient la société vers l’accomplissement de sa
rationalité propre à mesure que le processus de socialisation pénétrerait plus au cœur
de l’individu. D’autres ont renversé cette perspective, en dénonçant l’arbitraire de

A
SPECTS SOCIOLOGIQUES
,
VOL
.
18
NO
1,
MARS
2011
2
valeurs masquant et légitimant des intérêts sociaux partiaux, et entravant l’avancée des
sociétés vers l’horizon d’une rationalité morale authentique.
Aujourd’hui, la Raison a perdu sa centralité dans la pensée sociale, la société est
devenue pluraliste et les acteurs ordinaires font l’expérience de l’incertitude des valeurs.
Les perspectives classiques entrent en crise : le Juste et le Vrai cessent d’être définis d’en
haut, et la résolution des problèmes éthiques est de plus en plus conçue comme une
activité intrinsèque à la vie sociale elle-même. Nous proposons l’hypothèse que le
développement actuel d’une sociologie de l’éthique et des sentiments de justice prend
note de cette mutation et repose sur une vision des valeurs comme immanentes, comme
le produit de l’action et des rapports sociaux. Une première tendance tente de suivre les
formes ordinaires de construction d’une morale universelle : comment un principe
d’universalité est-il énoncé et mis en œuvre par les acteurs ? Une seconde tendance
développe une sociologie pragmatique de l’expérience morale contemporaine, où les
valeurs sont conçues comme des réponses, individuelles ou collectives, aux problèmes
de la vie pratique et à la nécessité d’accéder à une vie digne.
Ces deux tendances reconduisent assez largement dans le champ de l’analyse
sociologique l’opposition entre communautarians et liberals dans le domaine
philosophique. Le deuxième temps de notre argumentation consistera à réfuter cette
opposition car elle mutile l’objet : les principes universalisables et les orientations
culturelles sont co-présents dans l’expérience morale concrète. On explorera certaines
solutions de compromis en pointant leur limite principale : celle de surévaluer la
réciprocité de perspective entre le Juste et le Bien. Une sociologie de l’expérience morale
devrait au contraire partir des contradictions entre ces deux pôles pour décrire et
analyser le travail des acteurs et des institutions, contraints de construire des
agencements moraux circonstanciels, fragiles et provisoires.
1. L
A MORALE AU CŒUR DE LA SOCIOLOGIE
La question de la morale est au cœur de la sociologie classique. Les pères fondateurs
placent la Raison au centre d’une analyse de la société indissociable d’un projet de

A
SPECTS SOCIOLOGIQUES
,
VOL
.
18
NO
1,
MARS
2011
3
réforme visant à prévenir les périls de l’entrée dans la modernité. Et lorsque le projet
moderne s’essouffle, le cadre conceptuel de la sociologie classique entre en crise.
1.1. La morale, la modernité et la Raison.
Les sociologues classiques partagent une interrogation inquiète face à la crise morale
engendrée par l’entrée dans la modernité et lui cherchent des issues (Honneth, 2006).
Leurs travaux convergent vers le constat d’une modernité rationaliste défaisant les
formes de relation, d’échange, de pensée qui avaient assurées la cohésion des sociétés
d’ancien régime. Mais ils refusent les réponses conservatrices ou réactionnaires. Plutôt
que de rejeter la modernité, de prôner un retour aux fondements perdus de la
communauté et de la religion, les classiques ont tenté d’identifier dans la modernité elle-
même les prémisses d’un nouvel ordre. Le projet moderne affirmait que la Raison
Universelle s’imposerait comme le fondement d’un accord renouvelé entre l’homme et
l’ordre du monde révélé par la science (Touraine, 1992). Et les classiques ont voulu
placer cette Rationalité au fondement de la cohésion morale de la société.
Aux yeux des classiques, la modernité ne détruit pas simplement l’ordre ancien. Elle
fournit également un nouveau garant de l’ordre social, externe à celui-ci, opérant à partir
du principe général d’une Raison Universelle appelée à ordonner la vie sociale depuis
une position en surplomb. La modernité produit une morale nécessaire fondée sur la
Raison. L’éthique religieuse est ainsi lancée, selon Weber, dans un vaste processus de
rationalisation qui s’enracine dans le judaïsme et culmine avec l’ascétisme protestant
intramondain, où la quête du salut appelle tout à la fois l’organisation rationnelle de la
société et l’essor du capitalisme naissant (Ladrière, 2001c). Pour Simmel, une « culture
objective » associant la liberté personnelle, le « règne de l’intellect », la formation d’une
mentalité calculatrice, rationnelle et « blasée », règle désormais des interactions
urbaines devenues plus abstraites et impersonnelles (Simmel, 1990 [1903]). Les formes
de régulation morale se défont des liens personnalisés, ignorent la prise en compte des
personnes, et la morale associe de plus en plus « justice formelle et sévérité
impitoyable » (ibid. : 63). « L’aide au pauvre », notamment, n’est plus une fonction du
groupe primaire, adopte « le point de vue objectif » et vise à défendre l’intérêt général de
la société plutôt que la personne pauvre en tant que telle (Simmel, 1998 [1908]). Pour

A
SPECTS SOCIOLOGIQUES
,
VOL
.
18
NO
1,
MARS
2011
4
Elias, la montée des interdépendances et la proscription légale des violences
interpersonnelles sont même au principe d’un « processus de civilisation ». Elles
imposent aux individus un contrôle raisonnable de leurs pulsions qui finit par forger
leur « surmoi ». Ils deviennent ainsi d’authentiques sujets moraux, rompus à la
tempérance et à l’examen rationnel des situations, et capables d’appréhender autrui
comme un sujet défini par ses intentions (Elias, 1973, 1975).
Contrairement à une idée répandue, ce regard sur la morale n’est pas relativiste
1
. Le
sociologue doit savoir distinguer le « normal » du « pathologique » (Durkheim, 1990
[1937]). Et la tradition sociologique s’inscrit largement dans le prolongement critique de
la conception Kantienne d’une morale universaliste et impérative (Ladrière, 2001b)
2
.
Alors que chez Kant, la Raison fonde la loi morale, ce fondement se déplace du côté de
l’autorité « sacrée » de la société et de la conscience collective chez Durkheim
(Durkheim, 1975 [1893]). Mais cette autorité n’a rien d’arbitraire car les formes sociales
appellent des formes morales nécessaires : « Il n’y a pas de forme d’activité sociale qui
puisse se passer d’une discipline morale qui lui soit propre » (Durkheim, 1922 : 35). Ces
formes nécessaires de la morale, on le sait, sont décrites par les sciences sociales qui les
rapportent aux réalités objectives des interdépendances et des solidarités sociales. Cette
ambition fondationnaliste de la sociologie se manifeste encore lorsque Lucien Lévy-
Bruhl (1903) propose de délaisser la question des fondements philosophiques de la
morale au profit d’une « science des mœurs » capable de fonder, à terme, un « art moral
rationnel » : les Durkheimiens accueilleront avec une approbation distanciée cette
œuvre coupable, à leurs yeux, de délaisser le projet de fonder scientifiquement, avec les
outils de la sociologie, une morale universelle (Merllié, 2004).
Ce rationalisme de la sociologie classique fonde également les perspectives critiques
développées par plusieurs traditions théoriques. Si la modernité rationaliste porte en
elle les germes de sa propre morale, alors les « pathologies » du social et les crises se
présentent comme autant de mises en œuvre défaillantes ou perverties de la Raison
dans la vie sociale (Honneth, 2006a). Pour Weber, la “rationalisation des images du
monde” à l’œuvre dans l’histoire de l’occident conduit à l’extension de logiques d’action
relevant de la rationalité axiologique. Mais à terme cette Raison Pratique finit par
s’abolir d’elle-même, lorsque la rationalité expulse l’éthique hors du champ des

A
SPECTS SOCIOLOGIQUES
,
VOL
.
18
NO
1,
MARS
2011
5
pratiques sociales, et qu’une “cage de fer” vient corseter le monde moderne (Ladrière,
2001c). La tradition hégélo-marxiste développe une critique du capitalisme associant
celui-ci à une perversion de la poussée rationalisatrice de la modernité. Pour Marx, le
capitalisme « aliène » le travail alors que celui-ci constitue le levier essentiel de
l’accomplissement humain. A sa suite, la théorie critique et l’école de Frankfort décrit les
« pathologies sociales » comme le résultat de situations sociales où les progrès de la
raison sont entravés ou interrompus par l’organisation capitaliste – les progrès de la
rationalité étant conçus comme la condition d’une vie bonne ou réussie (Honneth,
2006b). De façon assez proche, la théorie critique de la culture proposée par Pierre
Bourdieu décrit comment la raison universelle est confisquée par des catégories sociales
dominantes qui la détournent à leur profit, l’auteur proposant que les intellectuels
portent la contestation au nom d’un « corporatisme de l’universel » visant
« l’universalisation des conditions d’accès à l’universel » (Bourdieu, 1992).
Les classiques, par delà leur diversité, se rejoignent ainsi autour de l’image d’une
société moderne se dotant, progressivement, d’une morale universelle et rationnelle –
les crises et les pathologies observables signalant des perturbations de cette évolution.
1.2. Une « nouvelle crise morale »
Les raisonnements de la sociologie classiques placent les sources de la morale à
distance de la socialité, dans une sphère autonomisée identifiable à celle de la Raison. Ce
« modèle » classique a aujourd’hui largement perdu sa force en raison d’expériences
historiques et intellectuelles qui ont rendue peu crédible, ou suspecte, l’image d’un foyer
unique créant, à distance du social, des valeurs universelles. Les sociologues
contemporains sont en effet confrontés, à partir de la deuxième moitié du XXième, à une
seconde « crise morale », comparable, par les invalidations conceptuelles qu’elle inspire,
à celle qu’avaient affrontée les classiques. Pour la présente discussion, on peut isoler
trois dimensions de cette crise.
La première est la remise en cause de l’idée de progrès, et du modèle de rationalité
qui la soutenait (Touraine, 1992). Les atrocités des deux guerres mondiales et la montée
des périls écologiques ont instillé un doute profond quant à la capacité de la Science et
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
1
/
34
100%