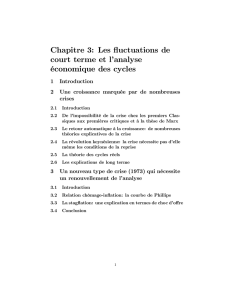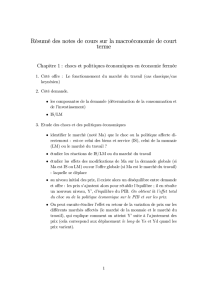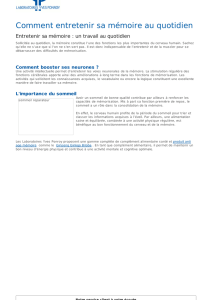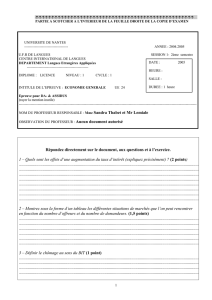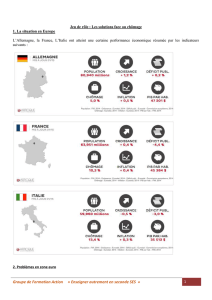La dynamique de court-terme : inflation et chômage

Ladynamiquede court-terme:
in‡ationetchômage
²Danslapremièrepartiedu cours:dynamiquedemoyen-longterme(l’investissement
accroîtlestockde capital ; ledé…citpublicaccroîtladettepublique)
²Jusqu’àprésentdanslasecondepartiedu cours:modèles statiques(étude
del’e¤etdeschocs surcertainsagrégatsmacroéconomiques)
²Nousallonsmaintenantanalyserladynamiquede court terme,en nous
concentrantsurlesanticipationsdesagentsetlaformation des salaire
commesourcesdedynamique.Celavanouspermettredenousintéresserà
l’in‡ation,aurôledesanticipationsetau débatsurlapossibilitéd’arbitrage
entrein‡ationetchômage.
Pourécrireun modèledynamiqueavec anticipations,ilfautpréciserl’ordre
danslequel lesagentsprivésetpublicsprennentleursdécisions.Nousallons
supposerl’enchaînementsuivant:
²Ala…n d’uneannée donnée (notée t-1)onconnaîtleniveau del’ensemble
des stocksdisponibles(stockde capital, niveau desconnaissances,dette
etpatrimoine).Lesagentsformentalorsdesanticipationsd’in‡ation pour
l’année suivante(notons-les¼e
t)etnégocientdesaugmentationsdesalaires
nominalespourl’année suivante.
²Unefoisqueles salaires sontdécidés, l’économiefonctionne ensuite comme
celaaétédécritdansleschapitresprécédents:du côtédelademande,
leschémaISLM(éventuellementenéconomieouverte)permetderéaliser
l’équilibresimultanésurlemarchédesbiensetsurceluidelamonnaie;du
côtédel’o¤re, lesalairenominalétant…xéau niveau négocié en débutde
période, lesentreprisesdéterminentunedemandedetravail etun niveau
d’o¤re.Leniveaugénéraldesprix estdéterminéparlaconfrontation de
l’o¤re etlademandedebiensetservices.Danslemêmetemps,deschocs
(favorablesou défavorables)ontlieuetlespolitiquesmonétairesetbudgé-
taires sontmisesenœuvre. Onobtientalorsleniveau del’ensembledes
grandeurséconomiquesetil sepeutquel’in‡ationobservée (¼t)soit…nale-
mentdi¤érentede cellequiavaitétéanticipée (¼e
t).
²... Etle cyclereprend avec formation desanticipationspourlapériode
suivante,négociation des salaires,......
1

1Formation des salairesetdesanticipations
1.1Laformation des salaires
Onintégrelesanticipationsdansun cadreprochede celuiétudiéprécédemment
lorsdel’élaboration del’o¤reglobale. Onavu:
²Ducôtédelademandedetravail : @F(K;L)
@L=W
P.Sousleshypothèses
deproductivitémarginaledu travail constante etunitaire.
demarchésimparfaitementconcurrentiels surlesquelslesentrepriseschar-
gentun prix supérieur,d’un tauxdemarge¹;aucoûtmarginal
larelation devientalors:Pt=Wt(1+¹)
²Ducôtédel’o¤redetravail, larelation positive entreo¤redetravail LS
etlesalaireréel(W=P)peutseréinterprétercommeunerelation négative
entretauxde chômageutetsalaireréel. C’estici qu’interviennentles
anticipations: lorsqueles salairesnominauxsont…xés, les salariésnesavent
pasencorequelseraleniveau futurdesprix. Les salairesnominauxsont
généralement…xéspour1 an,doncsi leniveaugénéraldesprix augmente
surcettepériode, lesalairenominaln’estpasréajusté.Lestravailleurs
doiventdonc estimerquelleseral’évolution futuredesprix surl’année à
venir. Finalement:
Wt=Pe
t=G(ut;z)
oùutestletauxde chômage entetzestunevariable compositereprésen-
tant touslesautresfacteursa¤ectantl’o¤redetravail (latailledelapop-
ulationenâgedetravailler,sacomposition, l’environnementsocialetcul-
turel...). Ona@G=@ut<0et@G=@z>0:
En combinantces2relations,onobtient…nalement:
Pt=Pe
t(1+¹)G(ut;z)
²En supposantlaformefonctionnellesuivante:G(ut;z)=1¡®ut+z,on
obtient:
Pt=Pe
t(1+¹) (1¡®ut+z))¼t=¼e
t+(¹+z)¡®ut(1)
2

où¼testletauxd’in‡ationet¼e
testletauxd’in‡ationanticipé.Parailleurs,
commedu côtédelademandedetravail : Pt=Wt(1+¹)avec ¹constant,ona
aussi :
¼wt=¼e
t+(¹+z)¡®ut
où¼wtestletauxde croissance des salairesnominaux.
Remarque:Cen’estvraiquesousl’hypothèsedeproductivitémarginaledu
travailconstante.
Onobserveainsi que:
²pourdesniveauxdonnésdeut,zet¹, l’in‡ation(commeletauxde crois-
sance des salairesnominaux)croîtavec l’in‡ationanticipée :sionanticipe
unein‡ation plusforte celarevientpourun niveau deprix delapériode
précédentePt¡1donné,àPe
tplusélevé)Wtplusélevé)Ptplusélevé,
ce qui, pourun niveau donnédu niveaugénéraldesprix delapériode
précédente, impliqueunein‡ation¼tplusforte.
²pourun niveau donnédel’in‡ationanticipée etdeut,pluslesfacteurs
regroupésdanszsontélevés,ou pluslamarge¹quelesentrepriseschargent
surle coûtmarginalestimportante,plusl’in‡ationestforte:unemarge
plusélevée accroîtlesprix courantspourun prix Pt¡1donné,doncaccroît
l’in‡ation.Ilenestdemêmepourz:si lapopulationenâgedetravailler
augmente,celaréduitz,et tireverslebasles salairesnominaux)réduit
Pt.
²pour¼e
t,z,et¹donnés,plusletauxde chômage estélevé,plusl’in‡ation
courante estfaible caren périodedefortchômage, lesrevendications salar-
iales sontmoinsvirulentesce quiréduitleniveaucourantdesprix etdonc
(pourPt¡1donné)l’in‡ationcourante:"ut)# Wt)# Pt.
1.2Laformation desanticipations
1.2.1Lesanticipationsadaptatives
EllesontétéproposéesparCaganen1956 dans sonmodèled’hyperin‡ation.Les
anticipationsadaptatives supposentquelesagentsrévisentleursanticipationsen
fonction del’erreurd’anticipationcommiseàlapériodeprécédente. On peut
donc écrirel’équation d’anticipationsouslaforme:
¼e
t¡¼e
t¡1=¯(¼t¡1¡¼e
t¡1)
3

où¯estle coe¢cientadaptatif.Suivantlavaleurde ce ¯, leshéma adaptatif
couvreun largespectre:
²¯=0:hypothèsed’anticipations statiques¼e
t=¼e
t¡1.Lesanticipationsne
sontjamaisrévisées
²¯=1:hypothèsed’anticipationsnaïves.Lesanticipationsnetiennent
comptequedeladernièreobservation del’in‡ation
²lorsque0<¯<1, lamémoiredu processusestpluslongue:¼e
t=
¯P1
i=0(1¡¯)i¼t¡i¡1
1.2.2Lesanticipationsrationnelles
L’hypothèsed’anticipationsrationnellesimpliquequelesagentsutilisent toutela
connaissance qu’ilsontdu fonctionnementdel’économieainsi quetoutel’information
disponibleaumomentdelaréalisation desanticipationspouranticiperlefutur.
Ilsne commettentdoncaucune erreursystématiqued’anticipation.Pratique-
ment,poserl’hypothèsed’anticipationsrationnellesrevientàsupposerqueles
agentsconnaissentce modèledel’économie etl’utilisentpourfairedesprévisions
ensupposantqu’enmoyenneleschocs serontnuls.
Lemodèledesagentsestsupposé conformeàl’ensembledeshypothèsesdu
modèle.Ainsi, l’hypothèsed’anticipationrationnelle établitune cohérence entre
lesanticipationsetlefonctionnementsupposédel’économie.
Remarque1:Cettehypothèsereprésenteuncaslimitedanslamesureoùles
agents sontsupposerintégrerdansleursanticipationstoutel’informationdontils
disposent,sansphased’apprentissage.
Remarque2:Ellen’implique cependantpasquelesagentsconnaissentpar-
faitementlefonctionnementvéritabledel’économiemais seulementquelesagents
disposentdelamêmeinformationstylisée quelemodélisateur)lesanticipations
s’adaptentàlalogiquedumodèle,que celui-cisoitd’inspirationmonétaristeou
keynésienne.
2LacourbedePhillips
A.W. Phillipsa observé en1958 unerelation négative entrein‡ationetchômage
entre1861 et1957 auRoyaume-Uni. SamuelsonetSolowontensuiteréitéré
l’exercice surdonnéesaméricainesentre1900 et1960 etretrouvent (sauf pour
4

lapériode correspondantàlaGrandeDépression)cetterelation négativequ’ils
baptisèrent“courbedePhillips”: il sembleraitquelesgouvernementspuissent
choisirentredi¤érentescombinaisonsdetauxde chômage etdetauxd’in‡ation.
Apartirdesannées70 cependant,onobserveunefortein‡ation jointeàun taux
de chômage élevé: ques’est-il passéavec lacourbedePhillips?
²quelsfondementsthéoriquesderrièrelarelationempirique?
²pourquoietcommentlacourbedePhillipsa-t-elle évoluédanslesannées
70 ?
²quellesimplicationspourlapolitiquemonétaire?
2.1LacourbedePhillipsinitiale
Lorsdelapremièreformulation(danslesannées60)delacourbedePhillips,par
Phillipslui-même,maisaussiparSamuelsonetparSolow, l’in‡ationmoyenne
étaitquasimentnulle.Unehypothèse correcte consistaitdoncàsupposerque
l’in‡ationàvenirseraitelle-aussinulle:¼e
t=0.L’équation(1)devientalors:
¼t=(¹+z)¡®ut
ce quidonne exactementlarelation négativeobservée parceséconomistes.Dans
ce cas,un niveau deutfaible conduitàWplusélevédoncàunehaussedesprix,
c’estàdireàunein‡ation plusforte.Celaprovientdelaboucleprix-salaires(aussi
appelée spiraleprix-salaires)déjaenoeuvreplushaut:#ut)" Wt)" Pt)" Wt
etc...
Pourl’Europe etdefaçon plusnette encorepourlesEtats-Unis, larelation
décroissante entrein‡ationetchômageaétévéri…ée danslesannées50 et60.
En revanche,elledisparaîtdanslesannées70 (aucunerelationentrein‡ationet
chômagen’estdistinguable);onremarquenotammentqu’àdemêmesniveaux
de chômage correspondentdesniveauxd’in‡ation beaucoup plusélevés.
Pourquoi lacourbedePhillipsa-t-elledisparu? Carsuiteàunemodi…cation
du processusd’in‡ation, lesagentsontmodi…éleurprocessusdeformation des
anticipations:
1/ Modi…cation du processusd’in‡ation:àpartirdela…n desannées soixante
(1960 auxEtat-Uniset1968 enFrance), letauxd’in‡ation
²reste constammentpositif
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%