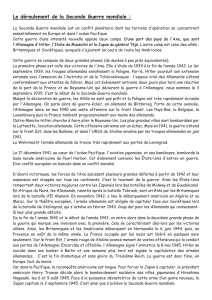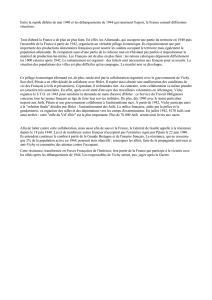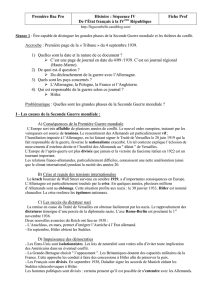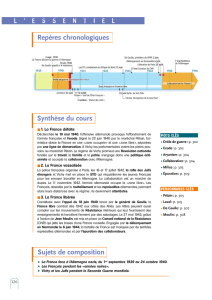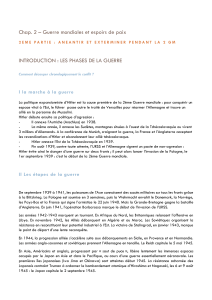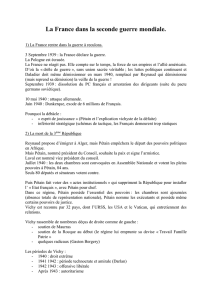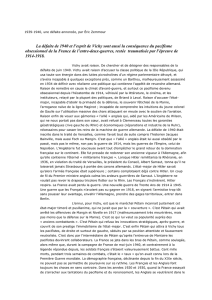Aux origines de la Seconde Guerre mondiale Les tensions

1 – LA FRANCE DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE
(8 HEURES)
N.B. : ce cours introductif rappelle un certain nombre d’éléments de culture historique,
supposés connus, sur les grandes lignes de la Seconde Guerre mondiale, mais sera principalement
centré sur la France. Il fait partie de l’actuel programme des classes de Première S, ES, L.
Aux origines de la Seconde Guerre mondiale
Si les responsabilités du déclenchement de la Première Guerre mondiale demeurent assez
partagées entre les différentes puissances européennes, le rôle de l’Allemagne nazie et du Japon est
incontestable pour expliquer dans les années 1930 la marche au second conflit mondial. Ses
origines sont liées aux coups de force des régimes autoritaires*, voire totalitaires*, européens et
japonais dans un atmosphère de tensions et de frustrations internationales, où le pacifisme
longtemps dominant des opinions publiques et des gouvernements des pays démocratiques
européens se nourrit des souvenirs douloureux du premier conflit mondial. En voici les principales
étapes.
Les tensions internationales
La fin des espoirs de paix
La crise économique qui débute en 1929 aux États-Unis remet en question la détente
internationale perceptible durant les années 1920 : chaque pays se replie sur lui-même et entend
résoudre ses problèmes économiques et sociaux aux dépens des autres (protectionnisme, guerre
économique).
La production d’armement et l’expansion extérieure, voire la guerre (après 1936), sont
parfois envisagées comme des solutions pour ouvrir les marchés étrangers et rassembler les
populations autour d’un but précis en encourageant un nationalisme agressif et fortement
xénophobe* (hostile aux étrangers).
Cette instabilité met à mal les équilibres précaires issus des traités qui ont clos la Première
Guerre mondiale, dont celui de Versailles* imposé en 1919 à l’Allemagne vaincue, accusée, non
sans excès, d’être responsable de la Première Guerre mondiale. Ainsi, la République de Weimar*
née en 1918 et fragilisée par une crise économique, sociale et politique cède-t-elle la place au
régime nazi* après la prise du pouvoir par Adolf Hitler* (30 janvier 1933).
Dans toute l’Europe centrale et orientale remodelée par les traités de 1919, les fragiles
régimes démocratiques sont rapidement remplacés par des dictatures nationalistes, souvent
militaires (Hongrie, Pologne, Yougoslavie, États baltes, Bulgarie, Grèce, Roumanie…) [carte de
l’Europe en 1938].

La France, l’Europe et le monde depuis 1939 (J.-P. Barrière)
2
L’agressivité des régimes fascistes ou autoritaires
Dès 1931, le Japon attaque la Manchourie (nord-est de la Chine) : la SDN* (Société des
Nations) ne réagit pas. Il attaque ensuite la République de Chine en 1937, ce qui marque le début
réel de la Seconde Guerre mondiale.
En 1934, l’Allemagne quitte la SDN* et dénonce le Traité de Versailles* : Hitler veut
agrandir l’« espace vital » (Lebensraum*) du pays pour créer une « Grande Allemagne »,
notamment vers l’Est majoritairement peuplé de Slaves (Pologne) et vers l’Autriche (Anschluss*)
[carte de l’Europe en 1938].
L’Italie du dictateur Mussolini*, au pouvoir depuis 1922, prétend dominer la Méditerranée et
se lance à la conquête de colonies en Afrique (elle annexe par la force l’Ethiopie en 1935) : elle
s’éloigne de la France et du Royaume-Uni pour se rapprocher de l’Allemagne (1936 : « axe Rome-
Berlin »*).
Les coups de force des dictatures (1936-1939)
La remise en cause du Traité de Versailles par l’Allemagne
Hitler réorganise l’armée pour en faire un instrument docile et puissant, développe l’industrie
d’armement et l’aviation (Luftwaffe*). En mars 1936, l’armée allemande occupe la Rhénanie* en
principe démilitarisée depuis le traité de Versailles* : bien que supérieurs militairement, la France,
en pleine période électorale, et le Royaume-Uni, ne souhaitant pas s’engager dans un nouveau
conflit, ne bougent pas ; le coup de bluff nazi a réussi.
La guerre d’Espagne (1936-1939)
Après le succès de la gauche (Front populaire*) aux élections législatives de 1936 en
Espagne, les militaires (général Franco*) associé aux conservateurs se soulèvent contre le
gouvernement légal républicain. Les grandes puissances décident de ne pas intervenir (non
intervention*). En réalité, Italie et Allemagne appuient militairement Franco et testent les armes et
les tactiques de la guerre à venir (bombardement aérien de Guernica* en 1937). La France laisse
transiter des armes destinées aux Républicains.
L’aide de l’URSS de Staline* (très mesurée) et des combattants volontaires étrangers (les
« Brigades internationales »*) au gouvernement républicain, par ailleurs divisé, ne suffisent pas :
après de violents combats, la guerre civile se solde par l’installation de la dictature conservatrice
franquiste en 1939 et l’exil d’une partie des combattants et dirigeants républicains espagnols,
notamment en France.
L’annexion de l’Autriche (mars 1938)
Ayant poussé par ses menaces le chancelier autrichien à la démission au profit du parti pro-
nazi, Hitler réalise l’Anschluss* en mars 1938 et se fait acclamer à Vienne. Le Royaume-Uni,
favorable à une révision partielle du traité de Versailles* en faveur de l’Allemagne, réagit peu et la
France ne peut que s’incliner : le rapport de forces leur est devenu défavorable.

La France, l’Europe et le monde depuis 1939 (J.-P. Barrière)
3
L’abandon de la Tchécoslovaquie par le Royaume-Uni et la France (septembre
1938)
Hitler prétend annexer en septembre 1938 le territoire tchécoslovaque des Sudètes, peuplé en
majorité de personnes de langue allemande travaillées par les nazis [carte de l’Europe en 1938].
Les Tchèques mobilisent leurs soldats, soutenus par leur allié français. Pour éviter de déclencher la
guerre, le Premier ministre anglais Chamberlain suggère à Mussolini* de proposer une conférence
internationale sur la Tchécoslovaquie. Elle réunit à Munich les 29 et 30 septembre 1938 Hitler,
Mussolini, Chamberlain et le président du Conseil français Edouard Daladier* (mais ni les
Tchèques, ni l’URSS de Staline*) : pour éviter une guerre qu’ils savent mal préparée et en partie
refusée par leurs opinions publiques, Anglais et Français cèdent à nouveau à Hitler, qui peut
annexer le territoire des Sudètes. La Tchécoslovaquie perd ses défenses et ne va pas tarder à être
démembrée sans combat par l’Allemagne, la Pologne et la Hongrie. L’opinion est majoritairement
soulagée, mais une partie d’entre elle critique l’abandon de Munich qui ôte tout crédit aux alliances
françaises et anglaises.
Une dernière série d’annexions conduit à la guerre
La Tchécoslovaquie disparaît rapidement de la carte [carte de l’Europe en 1938] après
l’indépendance de la Slovaquie (mars 1939) qui passe sous influence allemande et la transformation
par la menace de ce qui reste de l’État tchèque en protectorat de Bohême-Moravie rattaché à
l’Allemagne. Mussolini en profite pour envahir l’Albanie (avril 1939) et s’allier militairement à
Hitler (le « Pacte d’acier »).
Conscients que la politique d’apaisement* (appeasement) a échoué, les dirigeants français
et anglais décident de garantir les frontières de la Pologne, prochaine victime des ambitions
hitlériennes [carte de l’Europe en 1938]. Hitler revendique la ville-libre de Dantzig pour réunir la
Prusse orientale au reste de l’Allemagne, dont elle est séparée par le « corridor de Dantzig », et
empêcher tout accès de la Pologne à la mer . À la surprise générale compte tenu des oppositions
idéologiques jugées irréductibles entre les deux systèmes politiques, l’Allemagne parvient à signer
avec l’URSS de Staline un pacte de non-agression (23 août 1939) : Hitler n’aura pas à se battre sur
deux fronts, Staline gagne du temps et un protocole secret annexé au pacte prévoit le partage de la
Pologne et des États baltes (Lituanie, Lettonie, Estonie) entre les deux puissances [carte de
l’Europe en 1938].
Lorque l’Allemagne attaque la Pologne le 1er septembre 1939 après une provocation nazie,
France et Royaume-Uni lui déclarent la guerre le 3 septembre : la Seconde Guerre mondiale débute
officiellement en Europe.

La France, l’Europe et le monde depuis 1939 (J.-P. Barrière)
4
Les grandes phases de la guerre dans le monde (1939-1945)
Les succès de l’Axe (1939-1941)
Les forces en présence
France et Royaume-Uni disposent à moyen terme de la supériorité économique (industrie,
flotte de guerre, approvisionnements, empires coloniaux) et démographique (réserves de soldats).
L’Allemagne a une supériorité militaire à court terme sur ses adversaires, qui ont engagé plus
tard leur réarmement : pas pour l’effectif ou le matériel (sauf pour certains types d’avions, comme
les bombardiers en piqué Stuka), mais dans la manière d’utiliser ses forces.
Français et Anglais veulent gagner du temps et adoptent des stratégies défensives (ligne
Maginot*) pour limiter les pertes humaines. Hitler, qui a peu de réserves et entend éviter de faire
subir aux Allemands les effets directs d’un conflit, veut une guerre courte et choisit la tactique de la
« guerre-éclair » (Blitzkrieg*), qui consiste à utiliser massivement des chars et des troupes
motorisées et cuirassées (Panzerdivisionen) pour percer rapidement le front et désorganiser
l’ennemi.
Vers la défaite française (1939-1940)
L’élimination de la Pologne (septembre 1939)
Les forces sont disproportionnées entre les 63 divisions allemandes, techniquement
supérieures, et les 40 divisions polonaises, prises en tenaille : malgré une vive résistance, les
Allemands occupent Varsovie et la Pologne capitule le 6 octobre. Entre temps, le 17 septembre,
conformément au pacte germano-soviétique, l’URSS attaque la Pologne et récupère certains
territoires perdus en 1921 [carte de l’Europe en 1942]. L’Allemagne occupe le reste et conserve un
« gouvernement général de Pologne » (Cracovie et Varsovie) dirigé par un nazi qui instaure un
régime de terreur : les élites polonaises sont systématiquement éliminées par Allemands et Russes.
La « drôle de guerre » à l’Ouest (septembre 1939-mai 1940)
La période s’étendant de la déclaration de guerre à l’attaque allemande à l’Ouest, connue sous
le nom de « drôle de guerre »*, se révèle pleine d’ambiguïtés : l’adversaire n’apparaît pas aussi
nettement qu’en 1914. Le pacte germano-soviétique* trouble l’opinion, dont une partie voit
ressurgir le spectre du bolchevisme* ennemi des démocraties, et le parti communiste*, dissous
depuis le 26 septembre, désorganisé par la répression, mais dont maints militants sont pris à rebours
dans leurs convictions antinazies par la nouvelle ligne politique du PC qui ne fait plus de différence
entre Daladier et Hitler. Les prises de position des hommes politiques “munichois”, la force du
courant pacifiste, l’ampleur des crises politiques des années trente brouillent la perception du
danger immédiat. Ces divisions ne cessent pas après l’entrée en guerre, y compris au sein du
gouvernement ; l’inaction forcée imposée aux troupes par l’absence d’initiatives hitlériennes
directes contre la France jusqu’au printemps 1940 (pour des raisons météorologiques) et les
proclamations rassurantes de Daladier anesthésient encore davantage les Français. Les
Britanniques, eux, sont à présent résolus à la lutte.

La France, l’Europe et le monde depuis 1939 (J.-P. Barrière)
5
Les dirigeants alliés, traumatisés par les hécatombes de l’été 1914, attendent que leur effort
de réarmement, la mise sur pied de l’armée de terre anglaise et leur supériorité à long terme portent
leurs fruits. Hitler, débarrassé de tout ennemi de revers à l’Est, a le temps de ramener ses troupes
vers l’Ouest pour préparer ses offensives. Faute de l’attaquer de front, les franco-britanniques,
financièrement solidaires, cherchent à affaiblir le IIIe Reich* par des stratégies périphériques [carte
de l’Europe en 1938] : soutien enthousiaste à la Finlande qui tient tête à l’URSS (décembre 1939-
mars 1940), volonté de couper la “route du fer” suédois vers l’Allemagne en débarquant un corps
expéditionnaire dans le port norvégien de Narvik (avril-mai 1940). Mais la défaite finlandaise et la
rapide occupation par l’Allemagne du Danemark, puis de la Norvège (avril 1940), et des États
baltes par l’URSS (juin 1940), ruinent ces espoirs. Les critiques s’amplifient contre Daladier : la
Chambre des Députés* s’abstient massivement lors du vote d’un ordre du jour de confiance* le
20 mars 1940. Paul Reynaud*, jugé plus énergique, le remplace le lendemain, mais son
gouvernement, toujours partagé entre partisans d’une paix de compromis et bellicistes, ne dispose
que d’une étroite majorité au Parlement. Rien ne change, sinon l’engagement réciproque avec le
Royaume-Uni de ne pas conclure d’armistice séparé avec l’Allemagne. Contrairement à la
Wehrmacht*, les forces franco-anglaises manquent d’unité de commandement ; même dans l’armée
française, des divergences existent, notamment entre son commandant en chef, le général
Gamelin*, partisan de la défensive, et le général Georges, dirigeant les armées du Nord-Est. De fait,
le potentiel de résolution, perceptible chez les Français à l’automne 1939, a été gaspillé.
L’effondrement français (10 mai – 22 juin 1940)
Le 10 mai, Hitler lance une offensive générale sur les Pays-Bas et la Belgique neutres,
mettant l’accent sur les nœuds de communication. Comme prévu, croyant y voir une répétition
élargie du plan Schlieffen* de 1914, les Alliés viennent au secours des Belges et des Néerlandais.
Mais, simultanément, conformément au plan Manstein*, Hitler concentre 9 divisions blindées dans
les Ardennes (réputées “infranchissables” par le maréchal Pétain*), à la charnière du dispositif
français, entre les troupes montées vers le Nord-Ouest et la ligne Maginot. Mal protégée, la Meuse
est franchie le 13 près de Sedan et, le 15, les blindés de Guderian*, appuyés par des
bombardements aériens, réalisent une percée qui s’élargit rapidement. Obliquant vers l’Ouest dans
un mouvement tournant, les divisions allemandes, dont la vitesse de déplacement et la
concentration créent la panique dans les rangs français, atteignent la Manche le 20 mai. Deux jours
auparavant, Reynaud* avait renforcé ses pouvoirs, mais confié à Pétain* la vice-présidence du
Conseil. Dès le 10 mai, Winston Churchill* avait remplacé Chamberlain* dans ses fonctions de
Premier ministre britannique.
Les contre-offensives lancées du 21 au 25 mai par le nouveau généralissime Weygand*
échouent, faute de coordination et de tactique adaptée : le 28, les Belges capitulent. Profitant d’une
erreur de Hitler qui freine ses troupes, les armées franco-anglaises du Nord, encerclées, peuvent se
replier sur Dunkerque pour évacuer ce qui peut l’être : jusqu’au 3 juin, dans des conditions
épouvantables, 350 000 hommes (dont plus de 100 000 Français) gagnent l’Angleterre.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
1
/
34
100%