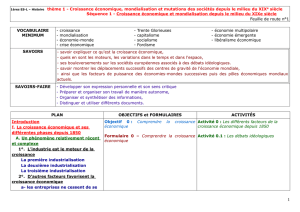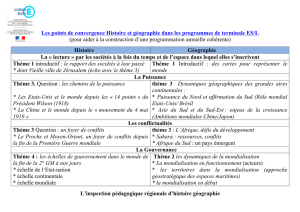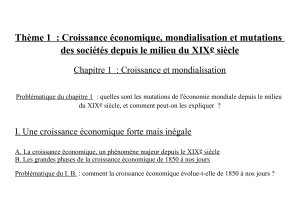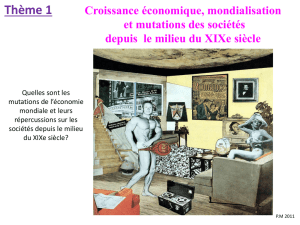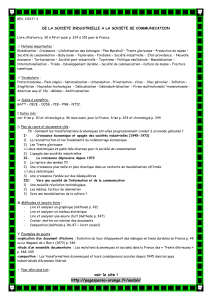29
HISTOIRE GÉOGRAPHIE 1re • AIDE À LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES
A. Histoire

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE PROBLÉMATIQUE
• Des économies-monde à la fin du xixe siècle à la troisième mondialisation
Ce thème introductif du programme d’histoire complète l’étude géographique de la
mondialisation faite en géographie sur l’Union européenne et la France mais dans une
perspective axée sur l’évolution historique du phénomène à l’échelle planétaire.
Le terme de « mondialisation » est la traduction du mot « globalization » employé dans
un article de la revue américaine The Spectator en 1962, désignant principalement la
mondialisation financière de la fin du xxe siècle. Le terme, en français, ne s’est démocratisé
qu’en 1981 en entrant dans Le Petit Larousse. Jusque-là, on pensait l’élargissement des
échanges de biens et de services comme synonyme d’occidentalisation : ainsi, on disait
« l’Ancien Monde » et « le Nouveau Monde » pour parler de la mondialisation du
xixe siècle.
Le moteur de cette mondialisation est la croissance économique (augmentation durable
du PIB) qui connaît des rythmes variés durant la période. Sans s’attarder sur les cycles,
on peut en montrer les principaux acteurs (entreprises, marchés, États providence…) et
ses effets différenciés dans l’espace. Les phases de crise (1873-1896, années trente et
années soixante-dix) occasionnent des ajustements structurels et une redistribution de la
puissance économique. Selon sa nature enfin (croissance extensive ou intensive), la
croissance a accéléré la mondialisation en contribuant à l’augmentation de la productivité,
en démocratisant la consommation et en accélérant les échanges.
L’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Gatt, créé en 1947) puis
l’Organisation mondiale du commerce (OMC, créée en 1995) qui prônent la généralisation
du libre-échange ont été les acteurs décisifs de l’ouverture des marchés. En abaissant les
droits de douane de plus de la moitié depuis la seconde guerre mondiale, dopant ainsi les
échanges dans la phase de haute croissance des années quarante-cinq - soixante-quinze,
les deux institutions ont renforcé la marche vers une économie mondialisée. Mais cette
dernière étape est d’une autre nature que la précédente : au début du xxe siècle on peut
penser que le marché, le capital et la nation étaient encore en adéquation car même au-delà
des mers, les grandes entreprises avaient en grande partie un capital familial ou du moins,
les actionnaires formaient-ils un cercle de connaissances restreint. Les premières firmes
multinationales (Michelin, Hoechst…) gardent alors un fort ancrage national. Un seuil
est franchi lors des « Trente Glorieuses » (expression créée par Jean Fourastié, auteur des
Trente Glorieuses ou la Révolution invisible en 1979) lorsque les monnaies, les titres des
sociétés, les créances sont échangées d’une bourse d’un bout à l’autre du monde. Une
étape supplémentaire est atteinte dans les années quatre-vingt quand les investissements
directs à l’étranger et les fusions-acquisitions se multiplient : le capital des entreprises
devient international et quasiment incontrôlable par les États. C’est le passage d’une
économie-monde à la mondialisation avec des acteurs nouveaux, les BRICs (Brésil,
Russie, Inde, Chine) qui participent à la construction d’une mondialisation multipolaire.
BIBLIOGRAPHIE
• CARROUÉ ( L.), COLLET ( D.), RUIZ ( C.),
Les Mutations de l’économie mondiale du début
du xxe siècle aux années 1970, Bréal, 2005.
• CARROUÉ (L.), «La Mondialisation en débat»,
La Documentation photographique,
n° 8037, La Documentation française, 2004.
• «Globalisation, mondialisation»,
Historiens & Géographes,
n° 395, juillet-août 2006.
• «Atlas des mondialisations», Le Monde,
hors-série, octobre 2010.
SITOGRAPHIE
• Alternatives internationales:
http://www.alternatives-internationales.fr/
• Encyclopédie de l’état du monde:
www.etatdumonde.com
«La fin du monde unique.»
Titre de L’État du monde 2011
sous la direction
de Bertrand Badie
et Dominique Vidal
✎ RESSOURCES
FIL CONDUCTEUR DU THÈME
Le passage d’une « économie-monde » à la mondialisation est un processus historique et géographique
multiséculaire d’extension progressive du capitalisme à l’ensemble de la planète. À présent, il s’agit d’un
élargissement spatial sans précédent dans un environnement de plus en plus concurrentiel avec des exigences
de responsabilités nouvelles, éthiques, sociales et environnementales.
CROISSANCE ET MONDIALISATION
CROISSANCE ÉCONOMIQUE, MONDIALISATION
ET MUTATIONS DES SOCIÉTÉS DEpUIS
LE MILIEU DU xIxe SIèCLE
1

31
HISTOIRE GÉOGRAPHIE 1re • AIDE À LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES
HISTOIRE
• Un concept braudélien
Le concept historique d’« économie-monde » désigne un espace de civilisation n’ayant
pas d’unité politique, mais organisé comme un État, sur les plans culturel, économique et
militaire, autour de lui et à son prot. Dans sa thèse, en 1949, l’historien Fernand Braudel
avait utilisé le concept d’« économie-monde » qu’il avait ensuite développé en 1979 dans le
tome III de la grande synthèse qui couronnait ses travaux (Civilisation matérielle, économie
et capitalisme, xve-xviiie siècle). Il mettait en avant le « décollage » de l’Occident et la
naissance du capitalisme dans une perspective de mondialisation de l’économie.
Fernand Braudel entendait par « économie-monde », non pas la terre dans sa totalité, mais
une région plus ou moins étendue selon l’époque et le lieu. Un espace économique cohérent,
non limité par des frontières étatiques et animé par une dynamique spatiale obéissant à une
organisation concentrique : un cœur économique et politique où se concentre la richesse,
où convergent les revenus et où se développent les arts, les sciences et les libertés ; des
zones intermédiaires et des périphéries aux productions moins avancées avec un système
économique souvent esclavagiste. On pouvait en trouver des bases dès l’Antiquité mais la
structure économique moderne aurait émergé lors de la domination des cités italiennes au
xive siècle, centres d’un monde qui s’étendait à travers la Méditerranée. L’avènement de la
domination des Provinces-Unies au xviie siècle aurait marqué un tournant avec la Compagnie
des Indes. Les Empires portugais et espagnol en Amérique latine, le commerce triangulaire
entre l’Amérique et l’Afrique au xviiie siècle élargissent les espaces du mercantilisme. Le
Royaume-Uni qui a initié au xixe siècle une logique de libre-échange avec spécialisation
des espaces productifs à son prot devient « l’atelier du monde » avant d’être supplanté par
les États-Unis au xxe siècle. Les deux puissances construisent le socle de la mondialisation
actuelle (règles nancières, rôle des monnaies, standards de comptabilité…).
• Les systèmes-monde d’après Immanuel Wallerstein
Selon Immanuel Wallerstein, Fernand Braudel a étendu son concept d’économie-monde
à l’Empire romain, l’Empire ottoman, l’Inde moghole ou la Chine des Ming de manière
abusive. Selon lui, il eut fallu distinguer les empires-monde uniés de manière politique,
culturelle et religieuse, qui tolèrent cependant des entités socioculturelles minoritaires, des
économies-monde politiquement fragmentées, qui elles tolèrent une grande diversité de
langues, de mœurs, de religions mais avec une tendance à l’uniformisation culturelle via le
développement des relations marchandes. De ce fait, il développe la notion de « système-
monde » : vaste unité spatiale possédant des relations complexes (à la fois économiques,
politiques et culturelles) entre une multiplicité d’entités différentes (tribus, peuples,
royaumes, États…). Et il souligne l’originalité de l’économie-monde européenne, liée à
sa nature capitaliste : c’est la tendance illimitée à l’accumulation du capital qui explique
sa tendance à toujours repousser ses limites spatiales, à contourner toutes les barrières
physiques ou politiques jusqu’à envahir la planète entière. Les économistes utilisent le mot
« mondialisation » pour décrire une situation qui prévaut depuis 1980 à savoir, une économie
caractérisée par un fort mouvement d’investissement direct à l’étranger, la libéralisation
du commerce avec néanmoins la mise en place de régulations transnationales (FMI, fonds
monétaire international et BCE, banque commune d’épreuves). Cette mondialisation favorise
la convergence des prix des biens sur les marchés internationaux et la réduction (relative)
des écarts de salaires entre pays. Il s’agit donc aujourd’hui d’une synergie entre l’expansion
des échanges et la libéralisation du marché.
Pièges à éviter
> Penser qu’en histoire on puisse se
dispenser de travailler à différentes
échelles comme en géographie.
> Oublier de présenter une évolution
à la fois croisée et divergente de la
croissance économique et du
développement.
> Ne pas utiliser de manière
systématique les connaissances de
géographie de 2de pour baser
une réflexion d’ensemble sur la
mondialisation.
Aborder la géo-histoire à travers
le thème «Croissance économique,
mondialisation et mutation
des sociétés depuis le milieu
du xixe siècle»
En 2de, les élèves ont déjà travaillé sur
les nouveaux horizons géographiques
et culturels des Européens à l’époque
moderne et sur l’essor scientifique et
technique: la troisième mondialisation
est un «nouvel horizon», les NTIC
sont un «nouvel essor». Malgré
la fracture numérique, ils peuvent
appréhender que cet essor peut à
présent venir de pays émergents,
des PED, et non plus seulement
des Occidentaux. En géographie, ils
ont abordé le développement dans
toutes ses acceptions et les enjeux
énergétiques et alimentaires. Cet
acquis peut nettement nourrir la
réflexion à un niveau plus spécifique
en 1re tant en histoire et géographie
qu’en éducation civique, juridique et
sociale.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%