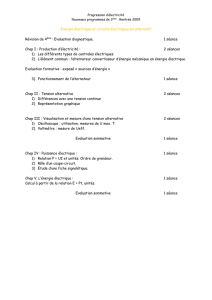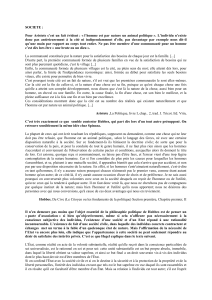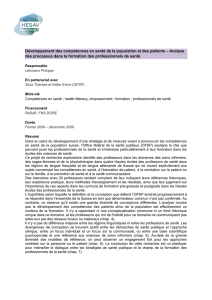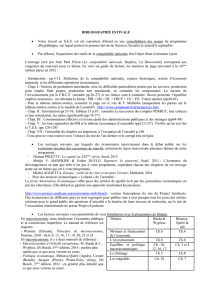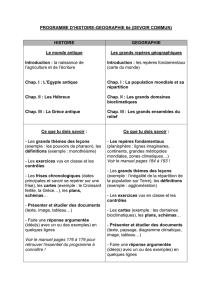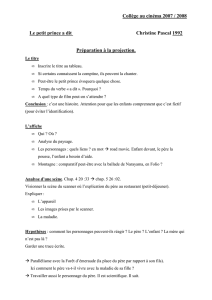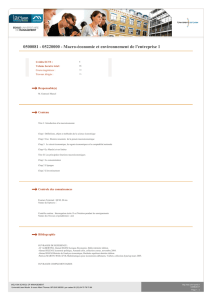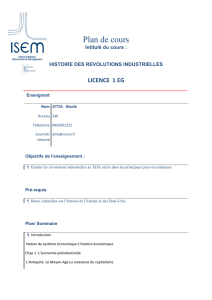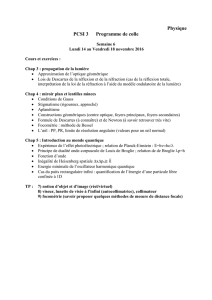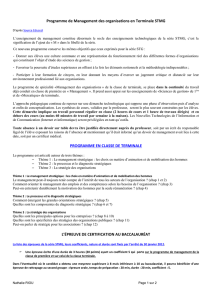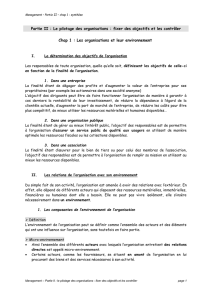Plans détaillés - Département de science politique

Pol 1701-30, Hiver 2009
I – Introduction à l’étude de la pensée politique moderne
1. Présentation générale
1.1 Le plan de cours : orientations, objectifs, calendrier, exigences, bibliographie ;
1.2 La complexité de notre rapport actuel à la pensée politique moderne ;
1.3 Remarques sur l’insertion du cours dans un programme de science politique.
2. Définition préliminaire de la pensée politique moderne
2.1 La pluralité des désignations et des formes : philosophie, théorie, pensée ; traités, histoire, œuvres littéraires, etc.
2.2 Qu’est-ce qu’une pensée « politique » ?
- le politique est ce qui a trait : à la polis ? au pouvoir ? à l’autorité ? à l’espace public où se joue la vie d’une
société ? à la nature du lien et des rapports sociaux ? à l’État ?
- la pensée est-elle politique par son objet, par son intention, par ses effets ?
2.3 Qu’est-ce que la pensée politique « moderne » ?
- la modernité comme principe, comme dynamique, comme période historique ;
- les concepts clefs : État et Souveraineté ; liberté et égalité ; contrat social et histoire ;
- regard général sur le corpus, de Hobbes à Nietzsche.
3. Rappel du cours sur la pensée politique classique (voir résumés sur la page du cours)
3.1 Données générales sur le moment grec
- l’importance du cadre initial de la Cité pour la pensée politique ;
- l’éloignement de la tradition, qui ouvre l’espace du débat politique et de la pensée (sophistique, philosophie) ;
- la division sociale ; la pluralité des régimes ; l’horizon patriotique et guerrier ;
3.2 Platon : les thèses sur le Bien et la Justice, sur le rôle des philosophes, sur la critique des régimes existants ;
3.3 Aristote : la Cité, condition à l’excellence et au bonheur ; la pluralité des conceptions du meilleur régime ;
l’idéal du régime mixte.
3.4 L’exemple romain : éloge de la vie pratique ; éloge du régime mixte ; les morales de l’antiquité tardive ; le droit ;
3.5 Le christianisme : nouvel équilibre des valeurs morales et politiques ; les deux Cités (spirituelle et politique) ;
3.6 Machiavel : entre le renouveau du civisme antique et un nouveau réalisme centré sur la nécessité du Pouvoir.
4. Quelques grands thèmes liés à la réflexion générale sur la nature du monde moderne
4.1 Nouveau statut de la Raison : la science ; le progrès ;
4.2 L’État
- constitution des grandes monarchies européennes : liens avec la politique interne et internationale ;
- élaboration théorique : théorie de la souveraineté, l’idée du droit naturel, l’idéal de neutralité, l’idéal du progrès ;
4.3 Le recul du religieux et de l’idée de nature comme ordre normatif ;
4.4 La sortie d’un monde communautaire : l’importance de la liberté individuelle ;
4.5 La sortie d’un monde hiérarchique : l’importance de l’égalité et de l’idéal démocratique ;
4.6 L’importance de l’histoire et du concept de volonté ;
4.7 La transformation du mode de production, des rapports de classe et du statut du travail ;
4.8 Le rôle de la pensée dans l’histoire : force créatrice ou reflet de son temps ?
5. Brèves remarques sur l’histoire des idées
5.1 Le souci de dégager une science et un enseignement politiques toujours valables ;
5.2 La mise en rapport avec le contexte historique (pour l’élaboration, la réception et l’influence des œuvres)
5.3 L’interrogation de la cohérence et des tensions internes des œuvres ;
5.4 L’intérêt et les limites respectives de chaque approche.
6. Présentation sommaire de Hobbes et des textes à lire pour la semaine prochaine
6.1 Le contexte politique : les guerres civiles et religieuses anglaises ;
6.2 Le Léviathan : une grande synthèse qui vise à unifier la science physique et la science politique ;
6.3 L’intention de Hobbes : fonder la légitimité de l’État sur le fait humain jugé le plus universel : la peur de la mort ;
6.4 Textes à lire :
- l’introduction / Hobbes y décrit les grands principes de sa méthode ;
- Première partie : de l’homme.
- une conception réaliste et pessimiste de la nature humaine, chap. 7, 10, 11, 13
- les 1ères conséquences politiques qu’en tire Hobbes : la théorie des Lois naturelles, chap. 14 et 15
- Deuxième partie : de la République
- l’origine de l’État, chap. 17

Pol 1701-30
II – Hobbes (1588-1679) : la rationalité de l’État
1. Vue générale sur le contexte
1.1 Le contexte politique du 17e siècle
- la consolidation des monarchies en Europe de l’ouest, contre l’Église, le fractionnement féodal et l’Empire ;
- les guerres de religion (entre catholiques et protestants) et leurs effets politiques / l’idée d’autonomie de l’État ;
- la spécificité anglaise : la lutte entre le parlement et la monarchie ; les luttes entre églises ; les luttes entre classes ;
1.2 Le contexte intellectuel : conflits entre héritages classique et chrétien, entre éthiques bourgeoise et aristocratique ;
- la sortie de la pensée médiévale par une posture sceptique (Montaigne), qui mène à un pragmatisme conservateur ;
- la sortie de la pensée médiévale par une volonté de refonder le savoir sur de nouvelles bases : la science moderne ;
le rationalisme de Descartes ; le rationalisme de Hobbes le droit naturel moderne et les doctrines du contrat social.
2. Biographie et présentation générale du Léviathan
2.1 La vie et l’œuvre de Hobbes
2.2 Le Léviathan, œuvre systématique (voir intro. et plan) ;
- 1ère partie : l’homme, matière et artisan du Léviathan (l’État) / conception pessimiste et réaliste.
- 2e partie : par quelles conventions on crée l’État ; ses droits et son juste pouvoir ; ce qui le conserve et le détruit ;
2.3 L’intention théorique : fonder la science politique sur l’observation et la déduction rigoureuse (intro. p. 3 et 4) ;
2.4 L’intention pratique :
- rompre avec l’héritage d’Aristote sur la question de la nature humaine, de la société et du politique ;
- faire admettre la primauté absolue de la sécurité et de la paix comme objectifs politiques (intro., ;
- fonder en raison la souveraineté pour mettre fin à la guerre de tous contre tous ;
- la difficile question du rapport au christianisme.
3. La nature humaine / Pour l’essentiel, 1ère partie. Voir plus loin pour la liberté
3.1 Connaître la nature humaine est la base de la réflexion politique (intro., p. 3 et 4)
3.2 La raison (ch. 5) / Identique chez tous, s’acquière par le travail (p. 6) / Rejet des thèses classiques (+ ch. 15, p. 21)
3.3 Le rapport entre la raison et les passions (chap. 7) : l’homme, être de désir (p. 7 et 9) ; la raison est un instrument ;
3.4 Le pouvoir (Chap. 10 et 11) et les causes de conflit
- définition : il consiste « en les moyens actuels d’obtenir quelque bien futur apparent » p. 8 / tout s’y ramène ;
- définition de l’honorable en lien direct avec le pouvoir (p. 9)
- l’universel et sans fin désir de pouvoir (p. 9-10) : il satisfait les désirs et éloigne la mort / Besoin de protection
- les causes des conflits sur la justice : confondre la coutume et la raison (p. 10-11)
3.5 La condition naturelle des hommes (l’état de nature) – Ch. 13
- l’égalité fondamentale des hommes entre eux / donc le commandement n’est pas un fait naturel / Contre Aristote ;
- effet de l’égalité, la lutte de tous contre tous : par rivalité universelle ; par défiance ; par le combat des vanités ;
- sans un pouvoir commun qui maintient tous les hommes dans la peur ils sont dans un état de guerre (p. 13) ;
- l’État de guerre empêche toute activité et tout déploiement des facultés humaines ;
- les passions et leurs effets ne sont pas injustes dans l’état de nature p. 13-14 / la justice est une convention p. 14
- les illustrations empiriques de l’état de guerre (état de nature) – p. 13, 14.
- les passions peuvent nous amener à vouloir sortir de l’état de nature et la raison peut indiquer le moyen (p. 14)
3.6 Premier bilan – conception individualiste, égalitaire et pessimiste de la nature humaine.
4. La conception hobbesienne des lois naturelles et de la justice / (chap. 14 et 15)
4.1 Pour Hobbes, la justice est une convention, mais une convention rationnelle ; rappel sur le conventionalisme ;
4.2 La définition du droit de nature comme liberté complète (en théorie) / absence d’obstacle moral à la volonté ;
4.3 Les deux premières lois naturelles / viser la paix ; que chacun se départisse de sa liberté absolue ;
- se départir d’un droit crée l’obligation de respecter son engagement / l’enfreindre est une injustice (p. 16) ;
- les limites de la transmission du droit / les conditions pour qu’une convention soit valable ;
- la peur est la véritable garantie des conventions (17, 18)
4.4 La 3e loi de nature : respecter les conventions. Elle fonde la justice, si l’État existe pour la faire respecter (18)
- l’examen de motifs évoqués pour ne pas suivre la justice (intérêt, religion, etc.) : pour H., ils sont irrationnels
4.5 La récusation de toute hiérarchie naturelle par un argument pragmatique / 9e loi de nature, p. 21
4.6 Bilan sur les lois naturelles
Pour le 28 janvier
Hobbes / à lire, 2e partie, ch. 18 (les pouvoirs de l’État, p. 27-33) et ch. 21 (la doctrine négative de la liberté, p. 37-43) ;
Locke / à lire : Ch. 1, 2 et 3 (1er exposé de sa doctrine du contrat social) ; ch. 5 (le libéralisme économique).
- le contexte : suite des guerres civiles anglaises. Justifier une monarchie constitutionnelle modérée ;
- l’intention dominante de Locke : la critique du traditionalisme et de l’absolutisme / fonder la liberté individuelle sur
le droit naturel / liaison explicite du libéralisme économique et du libéralisme politique.

Pol 1701-30
III- Hobbes (fin) – Locke (1632-1704) : La critique libérale de l’absolutisme
5. La souveraineté Textes de référence : la 2e partie du Léviathan, et notamment les chap. 17-18
5.1 L’accord entre les hommes est conventionnel (chap. 17, p. 24-26)
- la critique de l’hypothèse d’une multitude vivant sans contrainte (p. 25) ;
- la critique détaillée de l’idée de sociabilité naturelle ;
5.2 L’origine contractuelle du souverain (chap. 17, p. 26-27)
- l’idée du contrat social dans la pensée politique ;
- le contrat selon Hobbes : entre individus et non avec le souverain / le motif politique de cette distinction ;
- la République comme somme des volontés ; le souverain concret comme représentant de la volonté des sujets ;
5.3 Précisions sur la nature et la portée du pouvoir souverain (Chap. 18)
- précisions 1 à 5 : le caractère absolu de la souveraineté et le pouvoir incontestable du souverain ;
- précisions 6 à 12 : les pouvoirs légitimes de l’État ;
- critique de la division de la souveraineté / les maux subis par l’État sont toujours un moindre mal (p.32) ;
- 4 éclairages pour penser l’absolutisme de Hobbes ;
5.4 La question du meilleur Régime : enjeu relativement secondaire ; avantages de la monarchie.
6. La liberté des sujets et les limites du pouvoir souverain / (Ch. 21)
6.1 La conception négative de la liberté – Rappels – Ses divers aspects
6.2 Critique de la liberté politique au sens où l’entendaient les Grecs et les Romains (p. 39-40) ;
6.3 Les limites de principe, ou de droit, du pouvoir souverain
- le pouvoir souverain n’a d’autorité que par la loi : tout ce qui n’est pas interdit demeure permis ;
- le pouvoir souverain est limité par l’intention qui a présidé au pacte initial (p. 39 ; p. 40-41);
6.4 Les limites de fait du pouvoir souverain
- le pouvoir ne peut tout régler : c’est impossible (p. 39)
- les lois sont fragiles et l’État aussi, car les hommes sont passionnées et peu raisonnables. (p. 38, p. 43)
7. Bilan général sur Hobbes
7.1 La rupture avec les anciens : égalité, statut artificiel de la société, les buts du pouvoir simplifiés et absolutisés ;
7.2 La méthode : raisonnement logique et déductif à partir d’un « réalisme » anthropologique ;
7.3 L’influence de Hobbes :
- Reprises de plusieurs dimensions de sa pensée pour lutter contre la tradition hiérarchique et religieuse ;
- Critique des principes et des conséquences absolutistes de sa réflexion.
Locke
1. Contexte et biographie
1.1 Le contexte politique : quelle monarchie pour l’Angleterre ? avec quel lien à la religion ?
1.2 Le contexte intellectuel : les débats sur la connaissance ; monarchie ou république ; zèle religieux et tolérance ;
1.3 Vie et œuvre de Locke / Présentation générale du Traité du gouvernement civil.
2. L’intention de Locke : dégager en tout le raisonnable et l’utile
2.1 Son intention théorique : définir une conception empiriste et pratique de la science ;
2.2 Son intention pratique :
- une religion acceptable pour la raison / La double référence, religieuse et naturelle, de sa pensée politique ;
- la critique du pouvoir absolu, jugée contraire au pacte civil et à l’intérêt éclairé de l’humanité ;
- la critique de l’autorité traditionnelle, de la tradition et de l’éthique aristocratique ;
- la visée en tout du raisonnable, à laquelle s’ajoute un certain absolutisme moral.
3. La définition initiale du pouvoir politique
- le fondement du pouvoir politique sur la tradition étant récusé, il faut en dégager un autre (ch. 1) ;
- Définition du pouvoir politique / Lien avec le concept de propriété (qui sera défini plus tard)
4. Premier aperçu sur l’état de nature, l’état de guerre et la nature humaine
4.1 L’état de nature selon Locke : liberté naturelle parfaire dans les bornes de la loi de la nature (ch. 2)
- l’importance de l’égalité et du droit de disposer de ses propriétés comme on l’entend ;
- a liberté distinguée de la licence / importance du droit naturel de juger ceux qui contreviennent aux lois de nature ;
4.2 Définition de l’état de guerre, qu’il faut distinguer de l’état de nature à proprement dit l’état de nature distingué de
- provoqué par l’agression de l’injuste, qui va contre les lois de nature ;
- la recherche d’un pouvoir absolu revient à vouloir ramener l’état de guerre / critique des monarchies absolues ;
A lire pour le 4 février : (terminer chap. 5), et ch. 7, 9, 11 et 19 (par. 211 à 226)

Pol 1701-30
IV- Locke (fin) : La critique libérale de l’absolutisme
5. La justice
5.1 La fondation naturelle de la justice (Chap. 2)
- la loi naturelle est la raison, et on doit s’appliquer même dans l’état de nature (par. 6);
- par rapport à Hobbes, un ancrage plus fondamental de la distinction du bien et du mal, des justes et des coupables ;
- le statut naturel du droit de juger (chap., 2, par. 6 ; chap. 3, par. 19 ; chap. 7, par. 87)
- la question complexe de l’objectivité de la loi ; l’évolution du concept de nature vers l’idée de Raison ;
- la validité universelle des lois naturelles : une limite à l’individualisme de Locke ?
5.2 L’importance du transfert du pouvoir individuel de juger pour définir la société politique (par. 87)
5.3 Le statut et la finalité des lois positives
- elles sont l’étendard, la manifestation claire des lois naturelles (chap. 9, par. 124) ;
- « le but des lois est de protéger et de soutenir l’innocent » (chap. 3, par. 20)
6. La souveraineté et l’État
6.1 La distinction des types de pouvoir et la définition restrictive du pouvoir politique (Chap. 1, par. 2 ; chap. 15) ;
6.2 La sortie de l’état de nature par le pacte civil
- la nécessité d’un pacte pour faire appliquer les lois de la nature (chap. 3, par. 21 ; chap. 8, par. 95 ; chap. 9) ;
- nature du pacte civil : un transfert de souveraineté créant des obligations mutuelles (chap. 8, par. 97) ;
- le but ultime : la conservation mutuelle des propriétés (chap. 9, par. 123) ;
- différences entre le lien social et la société politique (ou civile) ? (chap. 7, par. 89 ; chap. 19, par. 211) ;
6.3 La souveraineté
- la source (origine) du pouvoir souverain : la volonté individuelle (chap. 8, par. 95 ; chap. 7, par. 88) ;
- le fondement (sa base effective) du pouvoir souverain : le peuple (la majorité) ;
- son expression : le pouvoir législatif (chap. 11 ; chap. 19, par. 212) ;
- la finalité et les limites de la souveraineté (chap. 8, 9, 11, 15, 19) ;
6.4 La critique du pouvoir absolu
- la critique des modèles religieux et patriarcaux de la monarchie (et de la société) ;
- un pouvoir absolu est nécessaire arbitraire / critique de Hobbes (par. 93, 137, 171) ;
5.5 Le droit de prendre les armes pour dissoudre un gouvernement abusif (chap. 19).
5.6 L’ambivalence de la notion de peuple chez Locke et dans le libéralisme.
7. Locke, théoricien du libéralisme économique (chap. 5)
7.1 La théorie de la valeur travail (notamment par. 32, 40-44) ;
7.2 La justification de la propriété privée
- la justification initiale d’une propriété limitée (1ère partie du chapitre) ;
- la justification finale d’une propriété élargie, grâce à la création de l’argent (2e partie du chapitre) ;
7.3 L’esquisse d’une analyse historique de la civilisation et l’ambivalence à l’égard de la « simplicité originelle » ;
7.4 La référence aux peuples américains dans la justification du travail et de la transformation de la nature
7.5 Un premier exposé systématique de l’esprit du capitalisme ?
7. Locke, théoricien de la tolérance
8. Bilan général
8.1 Les différences avec Hobbes / elles ne doivent pas masquer les similitudes ;
8.2 La dimension critique de la pensée de Locke
- critique de la tradition au nom d’un point de vue individualiste / limites de l’individualisme de Locke ;
- critique du pouvoir absolu sous sa forme traditionnelle ou sous la forme proposée par Hobbes ;
- critique des limites traditionnelles, morales et religieuses, opposées à l’enrichissement illimité
8.3 La dimension fondatrice de la pensée de Locke
- l’idée d’une histoire de l’humanité recentrée sur l’économie, vue comme lieu essentiel de la liberté individuelle ;
- l’amorce d’une théorie moderne de la séparation des pouvoirs (qui sera précisée par Montesquieu) ;
- l’enracinement de la souveraineté et des limites qui lui sont posées dans une conception des droits de l’homme.
Pour la semaine prochaine
- remarques introductives sur Rousseau et sur le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité ;
- Textes à lire :
i la 1ère partie de la dédicace à la République de Genève (p. 145 à 149) ;
ii la Préface (au complet, p. 157 à 163) ;
iii l’introduction (p. 167 à 170) ;
iv la 1ère partie à partir de la p. 182 (« Je n’ai considéré… ») jusqu’à 221. Ne pas lire les notes en petits caractères.

Pol 1701-30
V – Rousseau : Critique de la modernité et fondements du droit politique (début)
1. Contexte et biographie
1.1 Vues générales sur le 18e siècle (voir les Éléments pour une cartographie intellectuelle dans le recueil)
1.2 Précisions sur le contexte intellectuel
- un nouvel optimisme : la croyance au progrès de la Raison, de la science et de la civilisation ;
- les Lumières radicales en France. Les conceptions plus complexes de Montesquieu et de Rousseau ;
1.3 Présentation sommaire de la pensée de Montesquieu ;
- son libéralisme : préserver la liberté par la division du pouvoir / l’éloge de l’Angleterre / l’influence aux É-U ;
- son pluralisme : penser la cohérence de chaque société et juger en conséquence ;
- Montesquieu, précurseur de la sociologie ;
1.4 Présentation sommaire de la pensée de Voltaire ;
1.5 Rousseau : un homme du peuple, de Genève, dans un monde aristocratique
- la quête d’authenticité et la mise en scène du moi : l’importance des textes autobiographiques ;
2. L’intention de Rousseau
2.1 Ce qui rend difficile la perception de l’intention de Rousseau :
- pluralité des genres ; pluralité des conceptions du bien ; la transformation des concepts de la pensée moderne ;
- la pluralité des dialogues critiques (Platon, Machiavel, Hobbes, Locke, le droit naturel moderne, Montesquieu) ;
- la tension entre la définition générale du droit politique et le souci d’assurer les conditions d’une moralité concrète ;
2.2 L’intention morale sous-jacente :
- la critique de la fausseté, de la vanité, de l’inégalité : de tout ce qui divise l’homme d’avec lui-même ;
- deux figures de l’unité retrouvée : l’idéal d’une communauté égalitaire et vertueuse, le plaisir d’être soi ;
2.3 Le double projet théorique :
- refonder la pensée politique moderne sur une conception adéquate de la nature ;
- l’analyse des conditions et des obstacles à la moralité et au bonheur ;
2.4 Les trois moments de l’œuvre :
- la critique initiale de l’Europe civilisée dans le Discours sur les sciences et les arts (Premier Discours) ;
- l’enquête anthropologique du Discours sur l’origine de l’inégalité (Second Discours) ;
- les solutions possibles : le Contrat social (solution politique) ; l’Émile et les Rêveries (solution morale) ;
3. La critique initiale de l’Europe civilisée (Le discours sur les arts et les sciences)
3.1 L’importance de la critique initiale de la civilisation pour la suite de l’œuvre ;
3.2 Quelle est la véritable cible de la critique de Rousseau ?
3.3 La double division de l’homme : par l’amour-propre et par l’intérêt particulier ;
3.4 Les multiples références positives opposées à la civilisation du 18e siècle européen.
4. Présentation du Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes
4.1 La distinction entre origine et fondements ;
4.2 La dédicace (p. 145-149): éloge des petites sociétés, seules capables d’un bonheur vertueux ;
4.3 La Préface (157-163) :
- objectif et statut de l’enquête de Rousseau ; remarques additionnelles sur la méthode ;
- deux thèses : la division entre 1ère et 2e nature ; 2 principes antérieurs à la raison : amour de soi et pitié ;
4.4 L’introduction (167-170) : les deux inégalités ; précision sur la méthode ; le pessimisme et son statut exact ;
4.5 Première partie (p. 182-221) : définir le propre de l’homme
- vigueur de l’homme naturel ; la perfectibilité et les « premières opérations de l’âme »;
- l’idée du contentement de soi et de la bonté naturelle (critique de Hobbes) ;
- la transformation des passions : par la Raison, l’amour-propre, la comparaison, etc. ;
- le peu de signification de l’inégalité naturelle;
4.6 Seconde partie (222-257) : perfectibilité et progrès de l’inégalité
- l’opposition de l’état de nature et de la société civile ; le rôle de la propriété dans le passage de l’un à l’autre ;
- les premières transformations, très lentes, jusqu’aux sociétés naissantes;
- des sociétés naissantes à la société civile ;
- confrontation des diverses thèses sur l’origine des sociétés civiles ;
- remarques sur la nature du contrat social, le statut de l’autorité et les formes de gouvernement;
- l’accroissement de l’inégalité, à la fois politique et sociale ; ses effets ;
- dernier portrait synthétiques de l’homme civilisé et de l’homme encore proche de l’état de nature.
À lire pour la semaine prochaine : 2e partie du Discours sur l’origine de l’inégalité, p. 222-257
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%