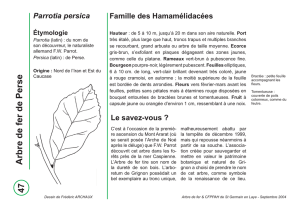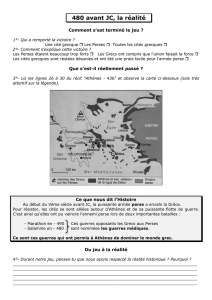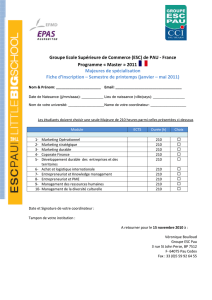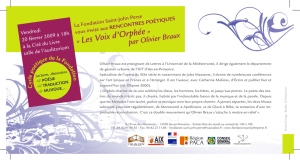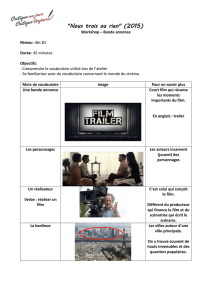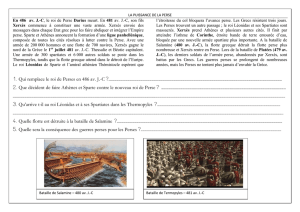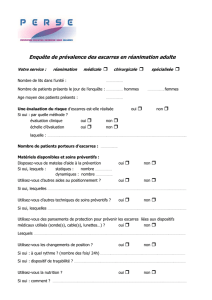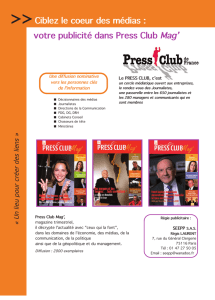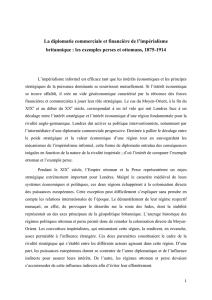Novartis Community Partnership Day - association perse

Press book – PERSE – Conférence de presse du 20 mars 2013 Page 1 of 49
Press book Perse
Conférence de presse
20 mars 2013
« Comment mieux prévenir et prendre en charge les
escarres ? »

Press book – PERSE – Conférence de presse du 20 mars 2013 Page 4 of 49
1. Communiqué de presse
Agir pour les 300 000 patients souffrant d’escarre !
Dix ans après la publication de ses premières recommandations, l’association
PERSE présente les résultats d’une nouvelle conférence de consensus pour
améliorer le traitement des escarres, mettant en évidence la nécessité de la
prévention et d’une prise en charge globale de cette véritable pathologie
chronique et les bénéfices de l’éducation thérapeutique.
L’escarre concerne environ 300 000 personnes en France, patients de tous âges, de
l’enfant au senior ou personnes paralysées, séjournant au domicile, en chirurgie aiguë
ou en unité de soins intensifs.
Plus qu’une simple plaie, l’escarre peut entraîner une souffrance physique et
morale, une limitation de l’autonomie et un retentissement souvent sous-estimé sur la
qualité de vie du patient.
L’escarre est une véritable pathologie chronique qui se prévient, se soigne et
s’accompagne comme toute autre maladie sévère Elle nécessite une prise en charge
globale du patient et un investissement pluridisciplinaire sans oublier le patient lui-
même et son entourage.
Paris, le 20 mars 2013 – Depuis plus de 20 ans, l’association PERSE (Prévention,
Education, Recherche, Soins, Escarres) se mobilise pour partager les connaissances,
améliorer les pratiques de soins et réduire l’incidence et la prévalence des escarres en
France. Elle est ainsi devenue un centre d’expertise et un groupe de référence, au fait
des dernières recherches et innovations sur l’escarre, pathologie multifactorielle nécessitant
une intervention pluridisciplinaire et une prise en charge globale du patient et de sa plaie.
Actualiser les recommandations de 2001 : une nécessité
Promoteur de la première conférence de consensus en 2001 sur la prévention et le
traitement des escarres de l'adulte et du sujet âgé, en partenariat avec La société Française
et Francophone des Plaies et Cicatrisation (SFFPC) l'association PERSE se devait de
réunir à nouveau des experts pour approfondir et réactualiser ces conclusions. En 2012, elle
a donc mobilisé ses membres ainsi que les sociétés partenaires, la Société Française
de Médecine Physique Et de Réadaptation (SOFMER), la Société Française de Gériatrie et
Gérontologie (SFGG), la Société Française et Francophone des Plaies et Cicatrisation
(SFFPC), afin d’élaborer de
nouvelles recommandations.
Dix ans après la publication des
premières recommandations
nationales, cette mise au point
permet d’offrir à l’ensemble des
professionnels de santé une
vision actualisée sur les
pratiques, les moyens et les
produits à leur disposition pour
la prévention et le traitement
des escarres.
« L’escarre est un risque majeur lié aux soins qui peut être
prévenu et évité dans de nombreux cas. La prévention de
l’escarre est un thème central des soins. Le taux de prévalence
des escarres constitue un indicateur de qualité des soins pour
lequel il est essentiel de se mobiliser. Prévenir l’escarre exige
avant tout de l’organisation : constitution d’un groupe référent,
travail en équipe coordonné et efficace, adhésion des soignants à
un protocole de soins… Les efforts déployés avec vigilance et
persévérance peuvent permettre d’espérer réduire sa
prévalence », déclare le Dr Denis Colin, Président de l’Association
PERSE.

Press book – PERSE – Conférence de presse du 20 mars 2013 Page 5 of 49
« Pour une pathologie multifactorielle telle
que l’escarre, nous avons préféré l’EPM ou
Evidence Practice Medecine, médecine fondée
sur la pratique, à l’EBM ou Evidence Based
Medecine. Le consensus formalisé d’experts
modulant l’analyse bibliographique et les avis
d’experts est en effet recommandé par l’HAS
dans un cas comme celui-ci », précise le Dr
Brigitte Barrois.
Près de 9 % des patients hospitalisés en France présentent au moins une escarre1.
Malgré les nombreux progrès observés dans les pratiques, l’escarre reste une pathologie
liée aux soins toujours trop fréquente. Le taux de prévalence de près de 9 % des personnes
hospitalisées reste inchangé depuis 10 ans. Mesuré en 2004 au cours d’une enquête
nationale menée auprès de 37 307 patients hospitalisés dans plus de 1 000 hôpitaux
français, il est similaire à celui d’une précédente enquête datant de 1994. Ces résultats sont
à l’origine de l’extrapolation proposant une prévalence de 300 000 personnes atteintes en
France.
L’escarre touche une grande diversité de patients2 : personnes de tous âges, de l’enfant
au senior, séjournant au domicile, en chirurgie aiguë ou unité de soins intensifs, blessé
médullaire … tous sont concernés avec des risques et des fréquences variables. La
population âgée est particulièrement touchée du fait de la fréquence des pathologies
chroniques multiples qui coexistent dans cette tranche d’âge avec des répercussions sur la
mobilité et l’état nutritionnel. Chez les patients qui subissent une intervention chirurgicale,
l’incidence des escarres varie de 8 à 55 %. Plus de la moitié sont acquises en période
peropératoire.
L’escarre n’est pas une simple plaie
L'escarre se définit comme une lésion
cutanée ischémique liée à une compression
des tissus mous entre un plan dur et les
saillies osseuses2. L’escarre peut entraîner
une souffrance physique et morale, une
limitation de l’autonomie et un
retentissement souvent sous-estimé sur la
qualité de vie du patient3. Au-delà d’une
simple plaie, l’escarre est une maladie qui
se prévient, se soigne et s’accompagne
comme toute autre maladie sévère3.
Une méthodologie rigoureuse : de l’analyse de la littérature à la conférence de
consensus
L’association PERSE a constitué en 2010
un groupe de pilotage pour analyser les
principales questions nécessitant une
mise à jour. L’analyse exhaustive de la
littérature internationale publiée au cours
des dix dernières années a été réalisée en
partenariat avec la SOFMER et la SFFPC,
et conduite sous forme de conférence
formalisée d’experts2, 4,5,6,7,8,9.
Ce travail a été effectué à travers trois étapes :
- Deux documentalistes professionnels ont effectué une revue systématique de la
littérature (bases de données PASCAL Biomed, Pubmed et Cochrane Library) et un
classement des articles retenus pour analyse à partir de la grille de l’ANAES en
quatre niveaux de qualité méthodologique10 ;
- Un recueil des pratiques professionnelles a été réalisé auprès d’un échantillon
représentatif des participants aux congrès nationaux des quatre associations et
sociétés PERSE, SOFMER, SFGG, SFFPC sous la forme de questionnaires ;
- Et l’avis d’un comité d’expert a été sollicité sur un premier travail rédactionnel.
Chaque question traitée a donné lieu en 2012 à une publication détaillée dans les Annales
de Médecine Physique et de Réadaptation.
« Traiter une escarre en s’occupant uniquement
de la plaie est une stratégie vouée à
l’échec. L’escarre doit être reconnue comme une
véritable pathologie chronique multifactorielle pour
laquelle l’intervention des soignants ne peut pas se
limiter aux soins locaux. Elle nécessite une prise en
charge globale du patient et un investissement
pluridisciplinaire de la part de toutes les personnes
concernées : médecin, infirmier, aide-soignant,
kinésithérapeute, diététicien, ergothérapeute… sans
oublier le patient lui-même et son entourage »,
explique le Dr Brigitte Barrois, Vice-Président de
l’association PERSE.

Press book – PERSE – Conférence de presse du 20 mars 2013 Page 6 of 49
Meilleure évaluation des risques, traitement adapté et éducation thérapeutique
développée
Ces nouvelles recommandations confirment
pour l’essentiel les pratiques des
professionnels en termes de prévention et
de soins d’escarre2, 4,5,6,7,8,9.
Elles contribuent également à élever
l’escarre au rang de pathologie reconnue
nécessitant une prise en charge globale
et renforcent l’obligation de développer des
efforts continus de prévention et de prise en
charge selon les axes suivants :
Nécessité de mettre en place une évaluation des risques dès que possible en
utilisant des échelles pondérées par le jugement clinique de l’équipe soignante.
Confirmation des deux facteurs prédictifs de l’escarre - immobilisation et
dénutrition - et suggestion de prendre en compte l’incontinence urinaire et fécale
dans l’analyse globale des risques d’escarres.
Apport de preuves utiles au choix des supports d’aide à la prévention et au
traitement des escarres dans certaines circonstances définies.
Bénéfice des soins infirmiers (soins d’hygiène et de confort) en prévention
incluant l’inspection des zones à risque, l’utilisation de produits non irritants pour la
toilette, l’hydratation de la peau avec des émollients, la protection des peaux
fragilisées par l’incontinence par application d’un protecteur cutané ou l’application de
pansements en regard des proéminences osseuses pour réduire les forces de
cisaillement.
Apport de preuves supplémentaires utiles au choix des pansements pour la
prévention, la détersion, la cicatrisation ainsi qu’en cas d’infection.
Intérêt de l’éducation thérapeutique du patient dans la prise en charge et la
prévention de l’escarre chez les personnes à risque chronique tels que les blessés
médullaires et les sujets âgés.
Une actualisation régulière de ces recommandations semble indispensable afin d’y intégrer
les résultats des projets en cours ou recherches futures telles les nouvelles technologies de
dépistage des lésions profondes ou de pansements intégrant des principes actifs…
« Pour l’association PERSE, la diffusion de ces recommandations est l’occasion d’affirmer
aux patients comme aux professionnels intervenants au domicile qu’ils ne seront plus seuls
face à l’escarre ! Ces nouvelles recommandations témoignent des efforts déployés et de
l’importance des réseaux de professionnels impliqués dans sa prévention et sa prise en
charge en France comme à travers le monde », se réjouit le Dr Denis Colin.
Les recommandations définitives seront rédigées par le groupe promoteur de pilotage.
Elles seront publiées en anglais et en français et seront également disponibles pour le grand
public sur les sites internet de ces associations et société savantes2, 4,5,6,7,8,9.
« L’escarre est avec les chutes, un des risques
liés aux soins pour lequel il est possible de
développer une prévention efficace. Il est
indispensable de ne jamais relâcher ses efforts et de
rester attentif pour évaluer les facteurs de risque, se
méfier de l’immobilité et de la dénutrition
particulièrement fréquente chez le sujet âgé et mettre
en place des mesures préventives efficaces pour
éviter sa constitution. Seule une vigilance de chaque
instant peut permettre d’espérer infléchir sa courbe
d’incidence », insiste le Dr Brigitte Barrois.

Press book – PERSE – Conférence de presse du 20 mars 2013 Page 7 of 49
A propos de l’association PERSE (Prévention, Education, Recherche, Soins,
Escarres) :
Depuis 1991 PERSE (Prévention, Education Recherche et Soins Escarres) est l’association
des professionnels de santé qui prennent en charge des patients à risque et/ou porteurs
d’escarres. En près de 20 ans PERSE est devenu le pôle de référence en France des
activités de formation, d’information et de recherche clinique et de recherche fondamentale
dans le domaine de la prévention et du traitement des escarres. Des médecins, des
chirurgiens, des infirmiers, des aides-soignants, des kinésithérapeutes, des diététiciens, des
pharmaciens, des personnels administratifs des structures de soins se sont regroupés pour
partager leur expertise et créer ainsi un réseau d’échange sur toute la France métropolitaine
et d’outre mer. PERSE est également présent au niveau international pour faire connaître les
travaux réalisés sur le territoire national et pour participer et développer des activités de
recherche, d’éducation et de formation au sein de l’EPUAP (European Pressure Ulcer
Advisory Panel) et de NPUAP (Société Américaine de Prévention et de Traitement des
Escarres).
Pour en savoir plus : http://www.escarre-perse.com/escarres/
Contact presse :
Publicis Care / Advocacy
Merryl Marcout - Tel : 01.58.47.79.06 ; merryl.marcout@publicis-advocacy.com
Graziella Tekle - Tel : 01.58.47.78.43 ; graziella.tekle@publicis-advocacy.com
Céline Perrin - Tel : 01.58.47.79.87 ; celine.perrin@publicis-advocacy.com
Références :
1. Barrois B, Labalette C, Rousseau P et al. A national prevalence study of pressure ulcers in French hospital
inpatients. J Wound Care. 2008;17(9):373-6, 378-9.
2. Q1 - Michel JM, Willebois S, Ribinik P et al. As of 2012, what are the key predictive factors for pressure ulcers
? Developing french guidelines for clinical practice. Annals of Physical and Rehabilitation Medecine 2012;55:454-
465.
3. ANAES. Prévention et traitement des escarres de l’adulte et du sujet âgé. Conférence de consensus.
Novembre 2001, HEGP, Paris.
4. Colin D, Rochet JM, Ribinik P et al. What is the best support surface in prevention and treatment, as of 2012,
for a patient at risk and/or suffering from pressure ulcere sore ? Developing french guidelines for clinical practice.
Annals of Physical and Rehabilitation Medecine 2012;55:466-481.
5. Nicolas B, Moiziard AS, Barrois B et al. Which medical device and/or which local treatment for prevention in
patients with risk factors of pressure sores in 2012. Towards development of french guidelines for clinical practice.
Annals of Physical and Rehabilitation Medecine 2012;55:482-488.
6. Trial C, Pineau J, Barrois B et al. Which medical technology and/or local treatment is most conductive, as of
2012, to pressure sore debridement ? Developing french guidelines for clinical practice. Annals of Physical and
Rehabilitation Medecine 2012;55:508-516.
7. Nicolas B, Moiziard AS, Barrois B et al. Which medical devices and/or local drug should be curatively used, as
of 2012, for PU patients ? How can granulation and epidermidalization be promoted ? Developing french
guidelines for clinical practice. Annals of Physical and Rehabilitation Medecine 2012;55:489-497.
8. Arzt H, Fromantin I, Ribinik P et al. Which medical device and/or which local treatmet are to be used, as of
2012, in patients with infected pressure sore ? Developing french guidelines for clinical practice. Annals of
Physical and Rehabilitation Medecine 2012;55:498-507.
9. Gelis A, Pariel S, Colin D et al. What is the role of TPE in management of patients at risk with pressure ulcer as
of 2012 ? Towards development of french guidelines for clinical practice. Annals of Physical and Rehabilitation
Medecine 2012;55:517-529.
10. ANAES Service Recommandations Professionnelles. Guide d’analyse de la littérature et gradation des
recommandations. Janvier 2000.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
1
/
47
100%