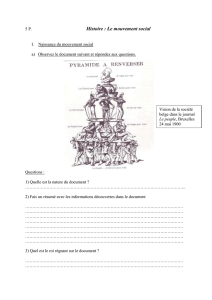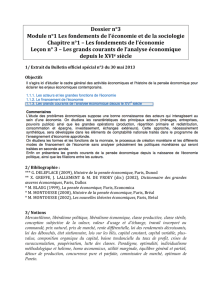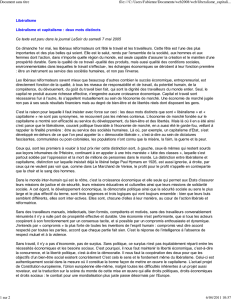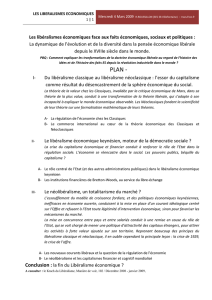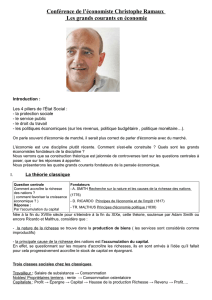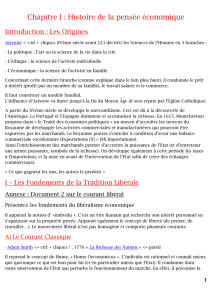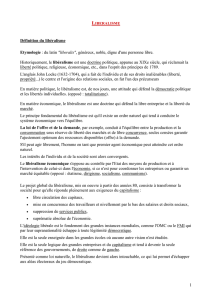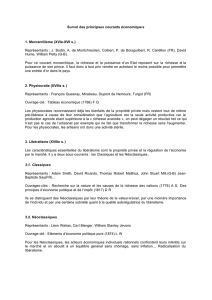Courants et systèmes économiques

Principaux courants de la pensée économique
L’antiquité et le Moyen-âge.
La civilisation grecque fournit grâce à Platon et Aristote (Ve et Ive siècles av. J.-C.) des amorces de
théorie économique. Cependant, le but de ces écrits est d’apporter des lignes de conduite morales ou
politiques. L’économie n’est pas un sujet d’étude en soi.
Platon s’inquiétait de l’importance croissante des préoccupations matérielles, alors qu’Aristote
mettait en garde contre le développement des échanges monétaires.
La Rome antique est encore plus pauvre que la Grèce en raisonnements économiques. Avant tout,
Rome a le mépris du travail, attitude suffisante pour empêcher la naissance et le développement de
l’économie.
Cicéron (106-43 av. J.-C.), homme d’Etat et philosophe, disait : « Rien de noble ne pourra jamais
sortir d’une boutique ou d’un atelier ». Rome préconise une vie simple, et combat toute forme
exagérée de richesse. Dans la pensée latine, il est immoral de vouloir s’enrichir. Les Romains
s’intéressaient beaucoup plus à la science du droit.
Au Moyen-âge, l’économie n’est pas une préoccupation dominante ; la société est entièrement tournée
vers la foi. Cependant, le christianisme a réhabilité le travail : « tu gagneras ton pain à la sueur de ton
front », mais celui-ci restera une sanction nécessaire, voulue par Dieu et ce jusqu’à la réforme.
La religion chrétienne enseigne à l’individu qu’ « il est plus facile à un chameau de passer par le trou
d’une aiguille, qu’à un riche d’entrer au Royaume Eternel »(Marc, 10.25). Dans ces circonstances,
chacun se méfie de la richesse et les conditions de la naissance de la science économique ne sont pas
remplies.
La religion a souvent été un obstacle important au développement économique. Voici quelques autres
exemples :
•Par son influence sur la famille (l’Eglise catholique s’oppose toujours à l’utilisation de
moyens de contraception), la religion peut provoquer des phénomènes de surpopulation et
empêcher le démarrage économique (misère, famine, épargne impossible)
•L’attitude de rejet par rapport à la richesse fait que l’élite ne s’intéresse pas à l’économie
•Les interdits et les tabous. Exemple : le Moyen-âge interdit le commerce à but lucratif et le
prêt à intérêts aux Chrétiens, car on ne peut échanger de l’argent contre du temps ; en effet,
le temps appartient à Dieu. On permet cependant aux Juifs d’exercer ces activités. Le résultat
fut simple : ce furent les juifs au Moyen-âge qui constituèrent l’élément moteur de l’économie.
Ils tinrent ce rôle encore longtemps.
Avec une telle emprise de la foi, l’essor de l’économie ne pouvait être rendu possible que par une
révolution brutale de la doctrine. Et c’est Calvin (1509-1564) qui va complètement bouleverser
l’échelle des valeurs du Moyen-âge.
Calvin prêche à une société genevoise de banquiers des nouvelles valeurs ; le profit et l’intérêt ne sont
plus des péchés. Ces idées vont se répandre dans toute l’Europe et les industriels et les commerçants
deviennent, dans la société, des gens honorables.
Cependant, Calvin ne prêche pas le relâchement des mœurs, au contraire. Il est défenseur farouche de
la réglementation, de l’interventionnisme. Il interdit les bijoux, les souliers pointus, inutiles à son avis,
les boucles d’oreilles, etc. Il s’élève contre les dépenses des riches et prône la simplicité. Il a compris
que l’épargne, qui résulte d’une vie simple, est le moteur de l’économie.

Questions
1. Pourquoi les civilisations grecques et romaines ne fournissent-elles que très peu de
raisonnements économiques ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Pourquoi ne trouve-t-on que des ébauches de théorie économique au Moyen-âge ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Expliquez pourquoi les juifs sont devenus les maîtres du commerce occidental au Moyen-
âge ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Pourquoi Calvin s’oppose aux dépenses de luxe ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
L’époque classique
On assiste, vers 1750, à la naissance de l’ère industrielle. L’artisanat perd de son importance et la
fabrique, en tant que nouvelle forme de production, s’impose. Pour des raisons démographiques,
économiques et sociales, le capitalisme prend un essor considérable. La croissance économique est
sans précédent, les biens disponibles sont considérablement multipliés. En revanche, les conditions de
travail dans les fabriques sont inhumaines et l’homme est amené à l’état de machine.
Définition du capitalisme : système économique reconnaissant la propriété individuelle des moyens de
production. Le capitalisme préconise la recherche du plus grand profit possible et le développement de
l’esprit de concurrence.
En Angleterre puis en France, se crée un courant de pensée que la tradition a appelé classique. Adam
Smith (1723-1790), philosophe écossais, est le fondateur de l’École classique. Toutes ses
démonstrations reposent sur le principe de la liberté qui lui apparaît comme étant la condition première
du progrès. D’après la théorie classique, l’État ne doit s’occuper que de ce qui lui revient : l’armée,
l’administration courante et la diplomatie. La richesse des nations dépend avant tout de la richesse des
individus. Il faut donc laisser faire l’individu en toute liberté et la nation s’enrichira beaucoup mieux
que si l’État voulait s’en mêler.
Pour beaucoup, David Ricardo (1772-1823), né à Londres, est le plus grand des auteurs classiques.
Chaque nation doit produire les biens pour lesquels elle est le a mieux adaptée, ceux pour lesquels le
coût de production est le plus faible par rapport à la valeur internationale.

L’Angleterre, par exemple où la terre est médiocre, dépense trop de travail pour la culture, elle a donc
intérêt, dit Ricardo, à importer du blé et à se consacrer à l’industrie. Ceci permettra l’essor
extraordinaire de l’économie anglaise au XIXe siècle.
Questions :
5. Pourquoi est-ce que le capitalisme se développe si rapidement ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Quels sont les fondements de cette théorie ?!
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Si David Ricardo vivait actuellement en Suisse, quelle serait probablement son attitude face au
problème de l’agriculture ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
La pensée de Karl Marx
S’il a été générateur d’un bien-être matériel nouveau et de l’amélioration progressive du niveau de vie,
le capitalisme libéral du XIXe siècle n’en a pas moins engendré les pires conditions de vie que
l’Europe avait connues depuis bien longtemps.
En 1850, la condition des ouvriers est misérable : horaires très lourds (11 à 14 heures par jour, 6
jours de travail par semaine), salaires très bas, logements malsains, associations et grèves interdites.
A Lille, ville fortement ouvrière, 72 % des enfants meurent avant l’âge de 5 ans dans les quartiers
pauvres. Certaines années, 64% des jeunes ouvriers meurent avant 15 ans.
Marx constate que les prolétaires sont complètement écrasés par les bourgeois. Il explique que la
croissance de l’économie se fait au profit des capitalises, tout en ignorant les travailleurs. D’après lui,
le capitaliste ne recherche que le profit, et ceci par une exploitation maximale de la force de travail.
Marx voit dans cette opposition une lutte à mort qui entraînera la destruction des deux groupes
antagonistes, et la création d’un monde et d’un système nouveau : le communisme.
Marx décrit le communisme comme une société d’hommes libres de laquelle les États auront été
supprimés. Dans cette ère d’abondance la rareté aura disparu, les biens n’auront plus de valeur et la
monnaie disparaîtra à son tour. Le travail aura cessé d’être une contrainte, il fera place à des activités
librement choisies, sources de joies profondes pour chacun, débouchant sur une production spontanée.
Cependant, Marx explique qu’entre la destruction du capitalisme et l’avènement du communisme, il
peut y avoir une longue période de transition. Cette phase intermédiaire est la dictature du prolétariat :
Elle devrait éliminer physiquement la bourgeoisie.
On peut considérer que la Révolution d’octobre en URSS en 1917 correspond à l’explosion du système
capitaliste russe. Les communistes d’aujourd’hui – ou du moins ceux qui croient encore en ces thèses
– se considèrent comme des socialistes et non comme des communistes, puisque, d’après la théorie

marxiste, il se trouvent toujours dans la phase intermédiaire qui les amènera à l’ère de du
communisme.
Marx s’est très peu intéressé à la gestion de l’économie de la société nouvelle qu’il annonçait. Il a
concentré son effort sur l’analyse de l’exploitation de la force ouvrière par la bourgeoisie. Il ne dit
pratiquement rien de la politique de croissance qui doit être mis en œuvre après la révolution
prolétaire. Le marxisme laisse ainsi les nouveaux maîtres sans indications sur la politique à suivre. Ce
n’est pas pour rien que dans les ex-pays de l’Est les réformes succédaient aux réformes. Le marxisme
débouche sur l’empirisme et finalement sur la dictature totalitaire d’une nouvelle classe dominante : la
nomenklatura.
Définitions :
Prolétaires : travailleurs qui n’ont pas la propriété des moyens de production mais leur seule force de
travail qu’ils sont obligés de vendre pour vivre. Pour Marx, le prolétariat est la classe qui supporte
toutes les charges de la société sans jouir des avantages. On peut l’associer au monde ouvrier.
Capitalistes : propriétaires des moyens de production qui en retirent les profits grâce à leur utilisation
par d’autres travailleurs.
Communisme : régime économique caractérisé par l’absence de propriété privée des moyens de
production. Selon Marx, phase suprême de la révolution socialiste.
Nomenklatura : En ex-URSS, classe privilégiée constituée de membres du parti communiste occupant
les postes-clés de la politique et de l’économie
1. Pour quelles raisons Karl Marx élabore-t-il sa théorie ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Quels sont les fondements de sa proposition ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Les néo-classiques
A la fin du XIXème siècle, certains économistes voulurent démontrer, d’une part le mal fondé des idées
marxistes, et, d’autres part, les avantages du libéralisme économique, mais en adoptant une démarche
nettement différente, d’où le terme néo-classiques pour qualifier ces nouveaux auteurs.
Définition : Libéralisme : doctrine économique qui se fonde sur la liberté individuelle et qui prétend
qu’il faut laisser agir les lois naturelle de l’économie (autorégulation sans intervention de l’État). Ce
sont les idées de l’École classique.
L’économie Néo-classique s’intéresse au comportement individuel des hommes en tant que
producteurs-consommateurs, alors que les classiques analysaient la société par grands groupe sociaux
tels que propriétaires, industriels, ouvriers, etc. Les néo-classique étudient la manière dont le
consommateur satisfait au mieux ses besoins par la meilleure distribution de ses dépenses et la façon
dont les producteurs rentabilisent le plus efficacement possible leur appareil de production :
Ce système supposait dans le cas le plus probable le plein emploi, et dans le pire un chômage
minimum.
Cette théorie fut suivie mais elle a été contredite par les faits qui se sont déroulés dans les années 30.
Rappelons les faits : en octobre 1929 éclate le célèbre Krach boursier de Wall Street, la bourse de
New-York. Le cours des actions s’effondre et beaucoup de banquiers et d’industriels sont au bord de la
faillite. Ils sont obligés de licencier et ainsi on compte plus de 13 millions de chômeurs aux USA en
1932 et plus de 15 millions en Europe. La production chute et la pression des chômeurs sur le marché
du travail entraîne une baisse des salaires. Et pour vendre, les entreprises doivent baisser les prix.
La théorie Keynésienne
L’homme qui va véritablement dénoncer les lacunes des théories néoclassiques s’appelle John
Maynard Keynes (1883-1946). Les classiques raisonnaient comme si le plein emploi était toujours
réalisé, si toutes les personnes désireuses de travailler pouvaient trouver un emploi à un certain salaire.
Pour Keynes, cette hypothèse ne correspond pas à la réalité.
Il va démontrer qu’en période de crise, l’Etat doit intervenir pour soutenir et régulariser l’activité
économique. C’est en créant un pouvoir d’achat que l’Etat va inciter les consommateurs à acheter, que
les entreprises vont réduire leur stock, qu’elles vont à nouveau engager des travailleurs, investir,
distribuer des salaires qui à leur tour permettront la consommation.
Il ne faut pas croire que Keynes, en prônant la supériorité de l’État sur les individus, s’oppose au
fonctionnement du capitalisme. Au contraire il faut l’aider à contrer ses points négatifs en mettant en
place une politique économique efficace. Le gouvernement doit laisser chaque partenaire libre mais il
doit soigner l’économie si elle est malade. Son intervention ne doit pas être permanente mais doit se
manifester seulement aux moments difficiles.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%