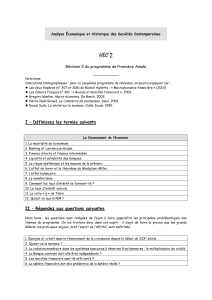Essai d`unification des définitions post

1
COLLOQUE DU CENTRE DE RECHERCHE SUR L’INTERGRATION ECONOMIQUE ET
FINANCIERE : « DU FRANC A L’EURO : CHANGEMENTS ET CONTINUITE DE LA MONNAIE »
Poitiers, 14-16 novembre 2001
ESSAI D’UNIFICATION DES DEFINITIONS POST-KEYNESIENNES DE LA
MONNAIE ENDOGENE : DES DIVERGENCES A LA COMPLEMENTARITE
POST-KEYNESIAN THEORIES OF MONEY : FROM DIVERGENCES TO
COMPLEMENTARITY
Virginie MONVOISIN∗∗
CEMF - LATEC / Université de Bourgogne
Résumé
Malgré l’utilisation de concepts fondateurs et communs, l’école post-keynésienne et
l’école circuitiste présentent des divergences à propos de la théorie de la monnaie
endogène. En réalité, chacun des deux courants privilégie l’une des deux composantes de
l’endogénéité de la monnaie : le comportement du système bancaire pour le premier et le
lien entre la monnaie et la production pour le second. Cette distinction permet d’apprécier
comment l’opposition post-keynésiens/circuitistes repose, non pas sur une divergence
fondamentale, mais sur une divergence des thèmes traités.
Abstract
The use of common and founding concepts notwithstanding, Post keynesian school and
circuitist school show divergences about the theory of endogenous money. In fact, each school
gives precedence to one of two components of the endogenous money, the behavior of the banking
system and the connection between money and production. This distinction gives some
appreciation of the opposition between post keynesians and circuitists do not depends on a
fundamental divergence but on a divergence about studied themes.
∗ ATER, IUFM de Lyon - CEMF-LATEC : Centre d’Etudes Monétaires et Financières - Laboratoire d’Analyse et de
Techniques Economiques (CNRS) / Université de Bourgogne (Dijon). E-mail : [email protected]

2
INTRODUCTION
Parmi les théories monétaires hétérodoxes contemporaines, l’analyse post-keynésienne
propose une multitude de réflexions approfondies relatives à la monnaie et donnant lieu à de
nombreux débats internes. Plusieurs concepts fondateurs assurent la cohérence des auteurs post-
keynésiens et les éléments d’une démarche commune (voir encadré). L’ensemble de ces concepts,
qui font toute l’originalité de cette école, peuvent être regroupés en trois idées essentielles :
l’opposition aux monétaristes ; l’héritage de Keynes, plus particulièrement à travers des écrits
antérieurs et postérieurs à la Théorie Générale tels que le Treatise on Money et les articles sur le
motif de finance ; l’appréhension du "monde réel" par le biais d’une méthodologie spécifique qui
insiste sur l’intégration du temps historique, de l’incertitude et des institutions dans l’analyse afin
de produire une théorie de "critical realism"1.
Ainsi aboutissons-nous à une vision endogène de la monnaie, qui forme le cœur de la
théorie post-keynésienne. Le système décrit est avant tout une économie monétaire et non une
économie réelle2. Par le biais du crédit, l’entreprise utilise la monnaie créée par les banques pour
financer la production et rémunérer les salariés. Les banques de second rang offrent ces crédits
qu’elles ont partiellement ou complètement créés ex-nihilo. L’offre de monnaie est endogène
puisqu’elle résulte d’une demande propre au système économique et non de l’action d’une
institution extérieure. Ces auteurs s’interrogent sur l’origine de la monnaie en tant qu’initiatrice du
processus de production.
CINQ PROPOSITIONS FONDAMENTALES A LA THEORIE MONETAIRE POST-
KEYNESIENNE
Proposition 1 : la causalité développée par la théorie quantitative entre la monnaie et le revenu est inversée.
La causalité va du revenu espéré par les entrepreneurs vers la demande de crédit, et donc de la monnaie
vers le revenu attendu.
Proposition 2 : la relation de causalité allant des réserves des banques en monnaie centrale vers les dépôts et
les crédits est également inversée. Les réserves des banques sont endogènes et n’exercent donc pas une
influence déterminante sur les prêts accordés par les banques. Ceci signifie que le modèle du
multiplicateur est rejeté.
Proposition 3 : La relation de causalité entre épargne (S) et investissement (I) est elle aussi inversée. Les
entreprises doivent en effet financer la production avant même que toute forme d’épargne n’ait été
généré.
1 P. Arestis (1996), p. 115.
2 L’économie réelle fait référence à un système où la monnaie est neutre : « Car dans l’économie réelle d’échange, la
monnaie ne met en œuvre que le nominal et non le monétaire », A. Barrère (1985), p. 6.

3
Proposition 4 : le taux d’intérêt est exogène. Il n’est pas déterminé par un quelconque mécanisme de marché
à travers lequel seraient confrontés une offre et une demande.
Proposition 5 : L’offre de monnaie est déterminée par la demande de crédit ("demand –determined and
credit driven"). La monnaie est créée ex-nihilo et n’est pas le résultat de décisions patrimoniales.3
Malgré un consensus général autour de cette séquence, les auteurs post-keynésiens ne
traitent pas tous avec le même intérêt ces différents thèmes, d'où l'émergence de débats et de
discussions au sein de l'école de pensée.
Lorsque l’on compare d’un côté la théorie des horizontalistes4/structuralistes5 et de l’autre la
théorie des circuitistes6 sur l’endogénéité de la monnaie, on note une différence d’importance
accordée aux deux composantes de l’endogénéité : le comportement du système bancaire
hiérarchisé et le lien entre la monnaie/production. En effet, on peut considérer que :
« La théorie de la monnaie endogène s’interprète à deux niveaux : celui des banques
commerciales et celui des Banques Centrales. A chacun de ces deux niveaux on peut dire que
l’offre s’adapte à la demande, au prix fixé. »7
On peut en déduire que l’endogénéité de la monnaie s’analyse à la fois dans la relation entre
la Banque Centrale (l’offre de monnaie centrale) et les banques commerciales (la demande de
monnaie centrale), c’est-à-dire dans le comportement du système bancaire hiérarchisé8, et dans la
relation entre les banques commerciales (l’offre de monnaie de crédit) et les entreprises (la
demande de monnaie de crédit), c’est-à-dire dans le lien monnaie/production. Les post-keynésiens
anglo-saxons privilégient l’étude de la première relation en s’intéressant aux fonctionnements du
système bancaire au sens large. Puis dans un second temps, après s’être penchés sur les
comportements des banques, ils étudient les comportements des agents non financiers face à la
monnaie. Les circuitistes, qu’en à eux, privilégient la relation monnaie/production, et tentent de
tirer toutes les conséquences de cette relation sur la théorie monétaire.
L’objet de cette communication est à la fois d’analyser cette divergence et la
complémentarité entre les deux points de vue. Il s'agit d'étudier en quoi la dimension plus
fondamentale de la définition de la monnaie des circuitistes demeure compatible avec la dimension
3 L.-P. Rochon (2001), p. 294.
4 Les horizontalistes regroupent des économistes essentiellement nord-américains et s’intéressant spécifiquement à la
question de l’offre Les auteurs les plus représentatifs de ce courant sont B. Moore et N. Kaldor.
5 Ce courant est sans doute le plus prolifique et a de nombreux représentants : V. Chick, T. Palley, P. Davidson.
6 Ici, la théorie circuitiste est considérée comme une composante du courant post-keynésien pour les raisons invoquées
plus haut dont les auteurs marquants sont A. Graziani, A. Parguez, B. Schmitt. Cependant, lors de cette étude le terme de
post-keynésiens désignera souvent les horizontalistes et les structuralistes uniquement.
7 M. Lavoie (1985), pp. 171-172.
8 Nous avons choisi d’utilisé le terme technique de "système bancaire hiérarchisé" comme équivalent au terme technique
de "système monétaire" ; il regroupe donc les banques de second rang et la Banque Centrale.

4
plus pragmatique et technique de la définition donnée par les autres post-keynésiens, les derniers
s’intéressant au rôle de la monnaie et à ses utilisations, alors que les premiers s’intéressant à la
nature et au statut de la monnaie.
I/ LE COMPORTEMENT DU SYSTEME BANCAIRE HIERARCHISE ET
L’INCERTITUDE
L’endogénéité de la monnaie suppose que les banques commerciales jouent un rôle
particulier car elles créent la monnaie en octroyant des crédits aux entreprises. Aussi, la définition
de la monnaie passe par l’étude du système bancaire hiérarchisé, plus précisément le comportement
des banques commerciales.
Sur ces points, les post-keynésiens ont consacré de nombreux travaux visant à décrire et à
comprendre le système bancaire. Il est possible d’en apprécier la teneur en étudiant la controverse
qui oppose deux courants post-keynésiens, celui des horizontalistes et celui des structuralistes. Les
débats portent sur les rôles respectifs de la Banque Centrale et des banques commerciales dans la
création et l’offre de monnaie. Leur étude nous permettra de synthétiser les différents arguments
avancés par les post-keynésiens anglo-saxons à propos des fondements de la monnaie.
Par ailleurs, le concept d’incertitude fournit aux post-keynésiens le moyen d’expliciter les
comportements des agents face à la monnaie et de justifier l’existence de cette dernière.
Compte tenu de ces éléments, nous verrons que les circuitistes ne répondent que de façon
partielle aux questions ayant trait aux comportements monétaires. Leur approche en terme de
hiérarchisation des agents s’avère moins féconde pour expliciter les comportements des banques et
des agents non financiers par rapport à la monnaie que l’approche post-keynésienne qui tend à
privilégier une approche davantage microéconomique.
1) Les autorités monétaires : une théorie monétaire dans un cadre institutionnel
On constate que ces auteurs apportent un soin particulier aux questions bancaires et à la
Banque Centrale. Reprenons le débat entre horizontalistes et structuralistes et tirons-en les
conséquences pour la théorie de la monnaie. Selon les principes communs à la théorie post-
keynésienne, la Banque Centrale ne contrôle pas le mécanisme d’offre de monnaie. Les banques
commerciales ont un rôle privilégié dans ce mécanisme, car ce sont elles qui sont à l’origine de la
dynamique monétaire grâce leur pouvoir de création de la monnaie. En revanche, horizontalistes et

5
structuralistes s’opposent sur mécanisme exact de cette offre. L’examen des relations entre la
Banque Centrale et les banques commerciales nous montre que leurs conclusions divergent
fortement. Les horizontalistes s’appuient sur une approche "passive" de l’offre : Les autorités
n’influencent en aucun cas la quantité de monnaie. La demande détermine l’offre et ce, de façon
inconditionnelle. La Banque Centrale est totalement accommodante.
« It is primarily the demand for bank credit, over which central banks have little or no
control, that is the chief determinant of money supply growth in all credit monetary economies
in both the short and the long run. »9
Les autorités monétaires s’efforcent de suivre ou de poursuivre l’évolution en volume de la
monnaie de crédit (dans le but d’atteindre des objectifs précis, comme éviter les crises financières
et les variations des taux d’intérêt). Les instruments traditionnels d’intervention demeurent
partiellement ou totalement inefficaces. L’open-market relève donc d’une politique plus défensive
qu’offensive ; les réserves obligatoires sont inefficaces ; et l’action par les taux d’intérêt est inutile
puisque la demande de monnaie reste indifférente au niveau des taux. En réalité, la base monétaire
est endogène, car les autorités ne font que s’adapter à la croissance du volume de la monnaie
bancaire, plus facilement d’ailleurs qu’à une baisse de ce volume. L’évolution de la base
monétaire est liée à celle de la monnaie bancaire et la monnaie de crédit étant strictement
déterminée par la demande, on en déduit que le montant de la base monétaire se fixe par le biais de
la demande (de crédit) et, par conséquent, est endogène au système économique.
En revanche, pour les structuralistes, les autorités monétaires peuvent refuser de refinancer
le système bancaire pour plusieurs raisons : inflation, pression sur les taux de change, manque
d’information sur l’état des liquidités dans l’économie. Le refinancement ne couvre pas la totalité
de la demande des banques. La Banque Centrale n’est pas totalement accommodante. Ainsi, le
système bancaire ne peut contraindre la Banque Centrale que dans une certaine mesure et en
retour, la Banque Centrale peut contraindre le système bancaire. La Banque Centrale est une
institution au sens fort du terme avec tous ses attributs. Aussi, les structuralistes apportent de
nombreuses nuances à la notion de monnaie endogène. P. Davidson reconnaît deux types de
création monétaire : la première, endogène, et initiée par les banques commerciales, la seconde
exogène et initiée par la Banque Centrale. Ici, la monnaie serait donc endogène et exogène.
Si cette contradiction dans les termes semble poser des problèmes de logique interne à la
théorie structuraliste, leur analyse pragmatique des relations entre les autorités monétaires et les
banques de second rang présente l’avantage de refléter les relations effectivement observées dans
la réalité. A l’inverse, l’analyse des horizontalistes paraît plus logique et plus cohérente d’un point
de vue méthodologique mais ses contradicteurs considèrent qu’elle pêche par défaut de réalisme.
9 B.J. Moore (1988b) , p. 70.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%