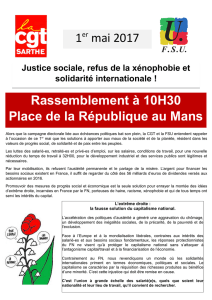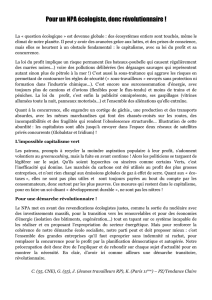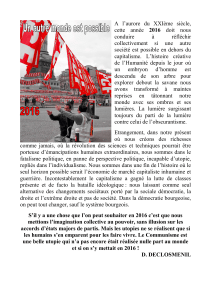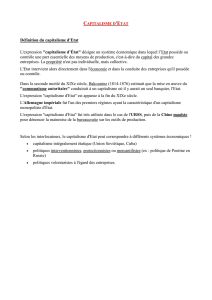Titre : le capitalisme comme objet pour la philosophie OU le

Séminaire de philosophie politique contemporaine 08-09 :
« Le capitalisme comme objet pour la philosophie »
L’activité prendra la forme d’un séminaire assuré par les membres du Service de philosophie
morale et politique, et accessible à tous les auditeurs intéressés par le sujet. La publicité sera
assurée par un affichage sur le site du Service. Il aura lieu un vendredi sur deux, de 14h00 à
16h00. Séance inaugurale le 5 décembre.
Que notre monde socio-historique soit celui de l'extension maximale de l'économie capitaliste
relève aujourd'hui de ce que la philosophie pourrait appeler "l'évidence naturelle". La "réalité"
du capitalisme — dans sa détermination vague de "société de marché", d'"économie libérale"
ou de "société du profit" — constitue le présupposé, tant de nombreux discours savants que
des discours politiques. A titre d'hypothèse, on peut avancer que, maintenue à l'état de
présupposé d'une évidence naturelle, la "réalité" du capitalisme marche de concert avec sa
naturalisation comme formation sociale (ou forme socio-économique). Posé comme réalité
donnée ou naturelle, "en soi" — à tout le moins, historiquement indépassable et totalisante —
le capitalisme pourrait tout au plus être perçu dans ses lois cycliques, dans sa rationalité omni-
englobante, ou, dans une veine hayekienne, comme le seul accompagnement possible de
l'infinie complexité de la réalité socio-économique. Chaque fois, le capitalisme apparaît
comme une réalité autonome, qui prive les sujets de toute possibilité d'agir sur lui, sauf en se
réclamant d’une situation de pure extériorité. "Système sorcier" dit Isabelle Stengers, pour
désigner l'objet de ces analyses, qui paralysent la pensée et l'action.
A rebours de cette "naturalisation", nous entendons rappeler que le capital et, par suite, le
capitalisme ont fait et peuvent encore faire l'objet d'une élaboration discursive, mais aussi
proprement théorique. L'idée que le capital constitue une réalité autonome obéissant à des lois
spécifiques, et que le capitalisme est une formation sociale dotée d'une rationalité propre a
d'abord fait le centre d'un débat théorique dont les conséquences étaient clairement
idéologiques et politiques. Ainsi chez Marx, dont l'effort théorique vise à produire, voire à
constituer l'intelligibilité de l'objet "Capital", avant de poser le capitalisme comme la réalité
ultime des rapport sociaux de la modernité.
C'est à ce niveau que le "capitalisme" (et le capital) peuvent faire l'objet d'un intérêt
proprement philosophique. A côté des données de fait fournies par les sciences sociales,
économiques ou politiques et sans prétendre se substituer à ces sciences, il reste nécessaire
d'interroger de façon critique les modalités discursives sous lesquelles capital et capitalisme
ont été et sont aujourd'hui encore constitués en objets de savoir. Il s'agira de réactiver, par-
delà sa dérive économiciste, ce que l'héritage marxiste a su produire comme critique théorique
et pratique du monde socio-historique. Comment le marxisme a-t-il constitué le capital en
objet de science ? Le "capitalisme" et le "capital" restent-ils des concepts pertinents et
adéquats pour comprendre le monde contemporain ? Quels sont les nouveaux concepts
apportés aujourd'hui par les théoriciens marxistes et postmarxistes ? Modifient-ils, ou non, les
problématisations classiques ? Que signifie "penser", "connaître" le capitalisme ? Le
"capitalisme", pour être pensable, doit-il être pensé comme un tout englobant et homogène ?
La contradiction demeure-t-elle la crux de l'intelligibilité du capitalisme ?

Ces questions seront adressées aussi bien à la tradition marxiste (de Marx à Althusser)
et à ses héritiers contemporains (Negri, Bidet, Gorz, etc.) qu'aux théoriciens étrangers à celle-
ci. En faisant l'hypothèse que l'institution discursive du "capital" et du "capitalisme" a sa
propre portée politique, nous nous demanderons quelles prises critiques nous donnent les
différentes "pratiques théoriques" qui les prennent pour objets.
PROGRAMME :
5 décembre (14.00 – 16.00, Commu II) :
•Denis Pierard : « Que veut le capitalisme comme religion ? ».
19 décembre (exceptionnellement : 13.00 – 16.00, Philo II) :
•Géraldine Brausch : « Les espaces du capitalisme selon Henri Lefebvre et David
Harvey »
•Thomas Bolmain : « La vie psychique du pouvoir, une approche critique » (autour
du livre de Judith Butler La vie psychique du pouvoir)
16 janvier (14.00 – 16.00, Philo II) :
•T. Berns : « Les abeilles et la question des externalités dans la pratique
entrepreneuriale du capitalisme contemporain »
23 janvier (14.00 – 16.00, Philo II) :
•Antoine Janvier : « Y a-t-il une rationalité du capitalisme ? »
30 janvier (14.00 – 16.00, Philo II) :
•Florence Caeymaex : « André Gorz et le capital immatériel. Quel style d’analyse
du capitalisme ? »
1
/
2
100%