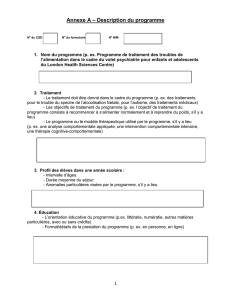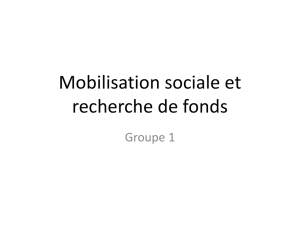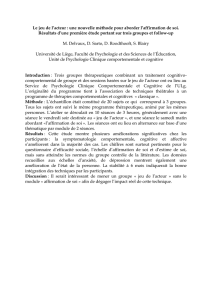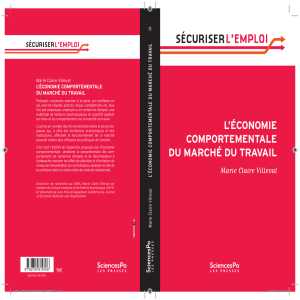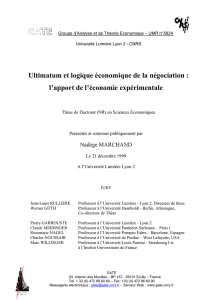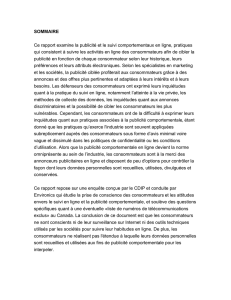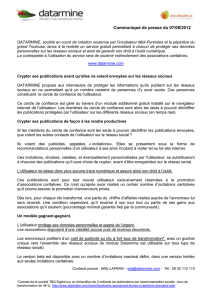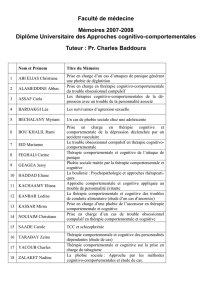ENTRETIEN AVEC MADAME MARIE CLAIRE VILLEVAL

DirectiondelaProspectiveetduDialoguePublic
20ruedulac‐BP3103‐69399LYONCEDEX03
www.millenaire3.com
1
ENTRETIEN AVEC MADAME MARIE CLAIRE VILLEVAL
directrice du Groupe d’Analyse et de Théorie Economique Lyon Saint
Etienne (GATE)
Le GATE est la principale Unité Mixte de Recherche de Rhône-
Alpes en économie, associée au CNRS, et aux Universités Lyon 2,
Lyon 1, St Etienne et à l’ENS de Lyon. Ses activités se répartissent
en 6 axes de recherche : « Jeux et marchés », « Micro-économie
du travail et des ressources humaines », « Economie de la
santé », « Espace et environnement », « Monnaie, finance,
économie internationale » et « Histoire de l’analyse
économique ».
Dans cette interview, Marie Claire Villeval, directrice du laboratoire
GATE Lyon St Etienne, nous expose les principes de l’économie
comportementale (discipline récemment nobélisée) dont l’objet
d’étude et les questionnements peuvent interpeller les politiques
publiques sur les déterminants des comportements humains.
Interview réalisée par Geoffroy Bing (Nova7), le 16 novembre 2010
On parle d’économie expérimentale et
d’économie comportementale. Pouvez-
vous nous expliquer ce que recouvrent
ces champs et les liens qu’ils ont entre
eux ?
L’économie comportementale consiste à
introduire une dimension psychologique
dans la formalisation et la compréhension
des comportements humains à l’occasion
des prises de décisions économiques. La
composante affective et émotionnelle de
nos prises de décisions joue en effet un
rôle considérable qui a longtemps été
ignoré volontairement. L’économie
expérimentale désigne principalement une
méthode de recherche permettant de
tester les modèles d’économie
comportementale. Les recherches en
économie comportementale s’appuient en
effet essentiellement sur l’expérimentation.
En quoi consiste l’expérimentation en
économie comportementale ?
Comme dans toute science expérimentale,
elle consiste à reproduire un modèle
théorique en laboratoire et à tester ce
modèle à l’aide de protocoles
expérimentaux appliqués à des sujets
humains pour étudier leur processus de
décisions et les déterminants des choix
individuels et collectifs. L’économie
comportementale nous fournit un modèle
de comportement théorique, et en
laboratoire nous allons tester si ce modèle
prédit effectivement les comportements ou
s’il convient d’amender le modèle. Pour
cela, nous reproduisons ce modèle dans
un environnement le plus contrôlé possible
pour se concentrer sur les dimensions et
les variables les plus fondamentales de la
prise de décision. Nous contrôlons ainsi le
type d’information que l’on donne à nos
« L'approche classique de la théorie économique consiste à postuler la
rationalité des acteurs. Mais les tests expérimentaux de la théorie des jeux et
de la décision ont généré, depuis les années 1980, un courant d'études,
l'économie comportementale..."»

DirectiondelaProspectiveetduDialoguePublic
20ruedulac‐BP3103‐69399LYONCEDEX03
www.millenaire3.com
2
sujets, les conditions d’échange, la
fréquence des interactions entre les
sujets, etc. Nous pouvons ainsi approcher
certaines dimensions que les enquêtes ne
nous fournissent généralement pas, telle
une mesure directe de l’attitude des
individus face au risque ou encore leur
préférence pour le présent, leur capacité à
faire confiance aux autres, etc. Nous
pouvons également introduire des
changements toutes choses égales par
ailleurs pour isoler l’effet d’un facteur, ce
qui nous est rarement donné d’observer
dans la réalité. Cette méthode a été
couronnée par deux Prix Nobel attribués à
Reinhard Selten en théorie des jeux en
1994 et, en 2002, à Vernon Smith pour
ses travaux sur les marchés et
l’information et à Daniel Kahneman pour
ses travaux sur les dimensions
psychologiques des comportements
économiques. Kahneman est en effet
psychologue ! Et il convient de savoir que
l’article de recherche le plus cité en
économie a été publié dans Econometrica
par Kahneman et Tversky qui sont tous
deux psychologues. Ces Prix Nobel ont
évidemment renforcé la crédibilité de cette
méthode.
Que nous apprend l’économie
comportementale?
Elle nous apprend que la rationalité n’est
pas parfaite, qu’elle est avant tout
contextuelle ; que nos préférences ne sont
pas stables ni nécessairement cohérentes
et que nous en avons une connaissance
imparfaite ; que nous ne basons pas
toujours nos décisions sur toutes les
informations disponibles et que parfois
nous les appuyons sur des informations
non crédibles. L’économie
comportementale nous apprend aussi que
les émotions jouent un rôle dans nos
prises de décisions économiques.
Certaines émotions nous aident à prendre
de meilleures décisions alors que d’autres
vont nous en empêcher. Le regret par
exemple peut nous aider à mieux décider
(il nous évite de refaire les mêmes
erreurs !). La jalousie ou l’envie peuvent,
au contraire, nous conduire à des choix
qui vont contre notre intérêt ! De même,
chacun sait que les décisions prises à
chaud ne sont souvent pas les mêmes
que celles que vous prendriez à froid.
L’économie comportementale se penche
également sur la question des incitations
monétaires et de leur efficacité. Les
incitations guident en effet les
comportements et chacun préfère gagner
plus que moins. Définir quelles sont les
incitations à mettre en place pour orienter
les comportements des agents
économiques peut résulter d’un modèle
théorique. Mais on découvre avec
l’économie comportementale qu’il y a des
situations dans lesquelles introduire des
incitations monétaires va avoir un effet
contraire à la performance. Par exemple,
si vous payez le don du sang, moins de
personnes donneront leur sang.
L’économie comportementale va donc
aider à mieux comprendre comment
incitations monétaires et incitations non
monétaires interagissent.
L’économie comportementale va
également nous aider à comprendre
pourquoi nous ne nous comportons pas de
la même manière face à des risques de
gains ou face à des risques de pertes et
comment cela influence nos stratégies et
nos investissements. Face à des risques
de gains, les gens sont averses au risque,
ils font des choix plus protecteurs. Au
contraire, face à des risques de pertes, les
gens font des choix plus risqués, ce qui
peut paraître a priori contre-intuitif !

DirectiondelaProspectiveetduDialoguePublic
20ruedulac‐BP3103‐69399LYONCEDEX03
www.millenaire3.com
3
Un autre domaine d’intérêt pour
l’économie comportementale est la
compréhension des préférences
temporelles. Dans quelle mesure accepte-
t-on d’attendre pour gagner plus ?
Certaines personnes préfèrent empocher
l’argent aujourd’hui plutôt que d’attendre
pour en recevoir plus dans un mois, même
si ce gain futur est assuré ! Si ce
comportement est généralisé, cela se
traduit par une société qui investit peu, qui
prend peu de risques, qui a du mal à
entreprendre et, au final, accuse un retard
de développement économique.
Qu’est-ce qu’un « comportement » pour
un économiste comportementaliste ?
Je dirais que c’est le résultat d’un
processus cognitif et émotionnel de
délibération et de décision individuel ou
collectif. Les gens raisonnent, anticipent,
comparent des choix et des non-choix, et
de ce processus résulte une décision que
j’appellerai comportement.
En quoi la démarche
comportementaliste dont vous vous
réclamez se distingue-t-elle de la
psychologie ?
Nous ne sommes pas psychologues. Nous
ne nous intéressons aux décisions de
l’individu qu’en tant qu’il s’agit de choix
économiques ou ayant des implications
économiques. Nous partons toujours d’un
modèle économique dans lequel nous
introduisons des facteurs psychologiques
mais nous ne nous substituons pas à des
psychologues. Pour prendre un exemple,
la sur-confiance chez les traders peut
expliquer des perturbations sur les
marchés financiers à travers des prises de
risques excessives. En tant
qu’économistes, nous allons étudier
comment cette surconfiance influence la
prise de décision mais nous ne
chercherons pas à savoir pourquoi il y a
de la surconfiance chez tel individu. De
même quand nous étudions la jalousie,
l’imitation ou l’importance de l’image de
soi, nous lisons de la psychologie pour
comprendre ce que veulent dire l’image de
soi ou la jalousie, mais nous ne cherchons
pas à mettre au jour le processus
psychologique à l’origine de ces
phénomènes.
La neuroéconomie constitue un champ
de recherche qui suscite beaucoup
d’interrogations. En quoi consiste-
elle ?
La neuroéconomie se développe depuis
une dizaine d’années à travers la
coopération entre neuroscientifiques et
économistes. Elle vise à mieux
comprendre les processus neuronaux qui
président à nos choix économiques. Si l’on
constate que les émotions jouent, on veut
savoir quel est le mécanisme cognitif qui
guide ces émotions et comment elles
s’imbriquent avec le raisonnement
économique. La neuroéconomie va nous
permettre de comprendre ce qui se passe
dans le cerveau quand l’individu évalue
diverses options économiques et qu’il
prend sa décision. Les zones du cerveau
activées nous aident à comprendre
comment l’individu analyse une situation
et nous permet de prédire ses choix. Cela
nous permet d’expliquer ce qui relève de
mécanismes automatiques ou de
mécanismes de raisonnement et
d’apprentissage.
Quand on pense neuroéconomie, on
pense surtout scanners et IRM. Mais cela
recouvre aussi des méthodes moins
lourdes qui recourent par exemple à des
mesures physiologiques (mesures de la
conductivité de la peau,
électrocardiogrammes, oculomètres, etc.).
Ces dispositifs nous permettent de

DirectiondelaProspectiveetduDialoguePublic
20ruedulac‐BP3103‐69399LYONCEDEX03
www.millenaire3.com
4
mesurer les émotions et de voir si
l’intensité des émotions ressenties est
corrélée avec tel ou tel type de choix. De
même, l’étude du rôle des hormones a
amélioré notre compréhension des
mécanismes qui sous-tendent la confiance
d’un individu pour un autre ; or la
confiance est une dimension
fondamentale dans les relations
économiques.
A-t-elle déjà débouché sur des résultats
intéressants, et si oui lesquels ?
Prenons un exemple : dans un jeu de
partage d’une somme d’argent entre une
autre personne et vous-même, si vous
recevez une part qui vous paraît
extrêmement inégale et donc injuste, la
zone de votre cerveau qui est activée est
celle qui est activée quand vous éprouvez
de la douleur physique. Le ressenti d’une
injustice morale ou d’une violence
physique active notre cerveau de manière
proche. De même, on a montré que
lorsque vous réparez une injustice en vous
vengeant par une punition, même si cela
vous coûte de l’argent, la partie du
cerveau qui s’active est celle qui s’active
également lorsque vous ressentez du
plaisir face à un gain monétaire ou en
réaction à une excitation sexuelle. Voilà
quelques résultats issus de la
neuroéconomie et qui sont importants
pour l’économiste car ils montrent que
l’utilité de l’agent économique ne se
mesure pas seulement par la
maximisation du gain monétaire mais
aussi et de manière plus complexe, par la
maximisation de gains monétaires et
moraux en présence de préférences
sociales.
Est-ce que l’économie
comportementale s’intéresse à la
notion d’acceptabilité, et si oui sous
quel angle ?
Pour nous, l’acceptabilité relève d’une part
de la volonté ou non de payer pour obtenir
quelque chose, et d’autre part, de la
volonté de renoncer à un gain pour
satisfaire une préférence sociale ou pour
respecter une norme morale.
Sur le premier point, si l’on s’intéresse à
l’environnement par exemple, il est
intéressant de savoir quelle valeur les
individus accordent à une meilleure qualité
de vie et d’environnement. Nous avons
des méthodes qui permettent de mesurer
cette volonté de payer, c’est-à-dire cette
acceptation de sacrifier de l’argent pour un
bien qui n’a pas de prix et surtout pour
lequel un marché n’existe pas (ou pas
encore). Quand un bien n’a pas de
marché, comment déterminer sa valeur ?
En effet, pour conduire les citoyens à
changer de comportement sur le plan
environnemental, il faut comprendre quelle
valeur ils attribuent à ce type de biens.
D’autre part, l’acceptabilité sociale désigne
notre propension à renoncer à un gain
monétaire pour faire un choix qui nous
paraît plus acceptable sur un plan collectif
ou moral. Il peut être facile de frauder si la
probabilité d’un contrôle est relativement
faible mais notre morale nous interdira de
le faire. Une autre question est de savoir
jusqu’où vous acceptez de contribuer à un
bien commun si les autres citoyens ne le
font pas. Il n’est pas toujours facile de
mesurer l’acceptabilité par des enquêtes
et dans la réalité, l’acceptabilité sociale se
mesure de manière coûteuse quand les
gens vont dans la rue ! Or, on sait bien
étudier ces phénomènes en laboratoire.

DirectiondelaProspectiveetduDialoguePublic
20ruedulac‐BP3103‐69399LYONCEDEX03
www.millenaire3.com
5
Face à un défi tel que réduire la place
de la voiture en ville, quelle approche et
méthode préconise un économiste
comportementaliste ?
Sur le plan théorique, je suis économiste,
donc je crois aux incitations mais j’en
connais les limites car je suis économiste
comportementaliste. Je serais donc tentée
de réfléchir à cette question en creusant
deux pistes. Tout d’abord on peut infléchir
les comportements par la piste des
incitations monétaires (soit à travers une
augmentation des coûts – l’impôt-, soit à
travers des récompenses – la subvention).
Ensuite, on peut explorer la piste des
incitations non-monétaires en travaillant
sur l’importance des interactions sociales
et des normes sociales. On peut ainsi se
servir de l’exemple des autres et jouer sur
les comparaisons pour changer les
comportements individuels.
Sur le plan méthodologique, deux
méthodes expérimentales peuvent être
utilisées pour tester l’efficacité de diverses
mesures. D’une part, l’expérimentation de
laboratoire, et d’autre part,
l’expérimentation de terrain. En
laboratoire, on peut simuler différentes
options de récompenses/sanctions
financières et jouer sur les préférences
temporelles (comprendre à quelles
conditions les individus sont prêts à
renoncer à un gain immédiat à travers
l’usage de la voiture personnelle pour un
gain à plus long terme à travers un
environnement de meilleure qualité permis
par l’usage des transports en commun ou
le covoiturage). Les individus les moins
prêts à faire cet arbitrage sont ceux qu’il
convient d’inciter davantage par des
politiques ciblées.
L’expérience de terrain consisterait à
sélectionner des quartiers de Lyon
auxquels on affecterait de manière
aléatoire des traitements différents
pendant plusieurs semaines. Les habitants
d’un quartier recevraient par exemple une
information sur les conséquences
monétaires et sanitaires d’un
environnement dégradé si les
comportements ne changent pas
(information négative). Les habitants d’un
autre quartier recevraient une information
positive présentant les avantages
monétaires et environnementaux des
transports en commun (information
positive). Les habitants d’un troisième
quartier recevraient une information sur
les bonnes pratiques de leurs voisins
(information comparative). Enfin ceux d’un
quatrième quartier pourraient bénéficier
d’une distribution gratuite de tickets de
bus. Ensuite, il s’agirait de comparer les
pratiques d’usage des transports en
commun avant, pendant, et après chacun
des traitements pour comparer leur
efficience relative. C’est ce que l’on
appelle dans notre jargon des expériences
« randomisées ».
Précisément, que savons-nous des
bénéfices des incitations monétaires
sur les changements de
comportement ?
Nous savons bien que les individus
réagissent aux incitations monétaires,
qu’elles soient positives (récompenses) ou
négatives (sanctions) en adaptant leurs
comportements : davantage d’incitations
conduit à davantage d’effort. Ce que nous
savons moins bien anticiper en revanche
est l’effet de l’introduction d’une incitation
là où elle n’existait pas auparavant. Nous
connaissons des exemples où
l’introduction d’incitations monétaires peut
avoir un effet contreproductif. C’est le cas
en particulier dans les domaines où les
pratiques dépendent de la bonne volonté
ou de la morale des citoyens. Introduire de
 6
6
 7
7
1
/
7
100%