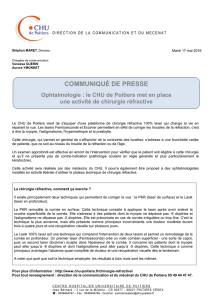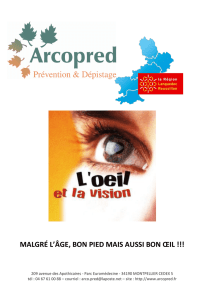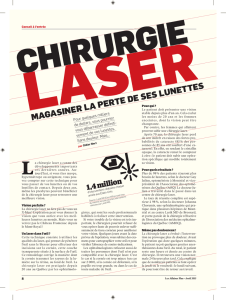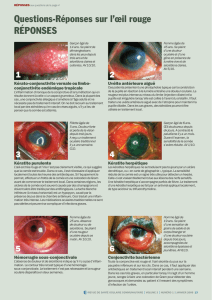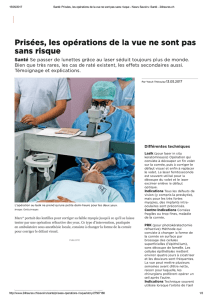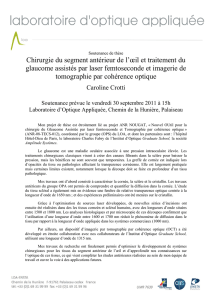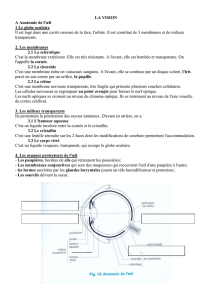La chirurgie oculaire au laser est-elle la solution?

SOMMAIRE
Capsule Médicaments
2
Les désignations de
bénéficiaire
Clarté et précision
évitent bien des
complications
3
Stressé? Vous n’êtes
pas seul!
4
La cyberchronique
6
Questions de
réglementation
8
La chirurgie oculaire au laser
est-elle la solution?
L
es médias ont beaucoup parlé de la
chirurgie oculaire au laser ces dernières
années. Et avec raison! Les personnes qui
portent des lunettes ou des verres de contact
savent à quel point il serait bon de pouvoir s’en
passer. Toute personne qui porte des lunettes
sait qu’il est extrêmement frustrant de chercher
ses lunettes juste pour lire l’heure sur le réveil-
matin.
Mais avant de se précipiter à la clinique de
chirurgie au laser la plus proche, les gens
doivent connaître les risques et les avantages
de la chirurgie oculaire au laser. Ils doivent
comprendre que l’intervention est irréversible.
Toute personne qui envisage la chirurgie
oculaire au laser doit consulter un médecin et
être aussi franche que possible sur ses
antécédents médicaux et sur ses attentes. Le
médecin doit avoir tous les renseignements
pour conseiller l’acte médical approprié.
Types d’interventions
La laser excimère, le laser de base utilisé pour
la chirurgie oculaire, émet des rayons
ultraviolets à haute énergie. Le laser est précis,
réduisant au minimum les dommages aux tissus
voir Chirurgie oculaire à la page 2
Se passer
de lunettes :
une réalité
possible
Avantages
sociaux
BULLETIN
TRIMESTRIEL
Volume 8 • Numéro 3
Troisième trimestre de 2001

Capsule
Médicaments
Les médicaments d’ordonnance peuvent
souvent remplacer d’autres formes de
thérapies plus coûteuses telles que
l’hospitalisation. Par conséquent, la
pharmacothérapie permettrait-elle en fait de
réduire les coûts liés aux soins de santé?
Peut-être…
Les médecins utilisent de plus en plus la
pharmacothérapie pour traiter des affections
avant qu’elles ne posent problème. L’utilisation
accrue de la pharmacothérapie n’est pas le seul
facteur contribuant à l’augmentation des coûts
liés aux médicaments. En effet, les produits
nouveaux et plus efficaces sont de plus en plus
chers. Selon une étude américaine menée par
Express Scripts, entre 1996 et 2000 le coût moyen
des ingrédients utilisés par chacun des
participants par année a bondi de 85 %. Les
nouveaux médicaments d’ordonnance mis sur le
marché depuis 1996 ont généré environ 35,7 % de
ce coût.
Le secteur de l’assurance fait face à un défi de
taille : comment trouver le juste équilibre entre le
besoin de donner l’accès à des médicaments plus
efficaces (et plus coûteux) et le besoin de limiter
le coût des régimes d’avantages sociaux.
Express Scripts suggère quelques moyens qui
peuvent limiter le coût des régimes médicaments.
Aider les employés à comprendre le coût des
ordonnances peut, par exemple, contribuer à
limiter la montée des coûts. Hausser le montant
de la quote-part s’est aussi avéré une stratégie
efficace pour certains régimes, car cette mesure
décourage toute tendance à faire exécuter des
ordonnances inutiles. Dans le même ordre
d’idées, réduire la quantité de comprimés délivrés
par ordonnance pour une nouvelle
pharmacothérapie peut également permettre de
prévenir le gaspillage. Enfin, la révision de
l’utilisation de médicaments empêche d’exécuter
plusieurs ordonnances pour traiter une seule
affection, ce qui offre la possibilité de réduire les
coûts et de préserver la sécurité des participants.
Express Scripts souligne que la solution n’est pas
aussi simple. Par exemple, l’augmentation de la
quote-part peut décourager les employés de
demander des ordonnances inutiles, mais peut
aussi dissuader les travailleurs à faible revenu de
faire exécuter des ordonnances nécessaires. En
outre, cette mesure pourrait amener les patients à
réduire la posologie et à prolonger la période de
traitement. En élaborant les régimes
médicaments, les administrateurs de régime
doivent veiller à ce qu’ils répondent le mieux
possible aux besoins des participants.
Le défi auquel fait face le secteur de l’assurance
est le suivant : comment rembourser des
médicaments plus chers tout en répondant aux
besoins des participants sur le plan de la santé. La
Financière Manuvie cherche toujours à trouver le
meilleur moyen de limiter les coûts tout en offrant
le meilleur régime médicaments possible aux
participants.
Source : Express Scripts 2000 Drug Trend Report –
Données américaines
2
périphériques. Deux méthodes de chirurgie
oculaires correctrices ont retenu le plus
d’attention : le KISAL (ou LASIK) et la PRK.
Le KISAL (kératomileusis in situ assisté par
laser) est utilisé pour traiter la myopie,
l’hypermétropie et l’astigmatisme. Le KISAL
est l’intervention la plus récente utilisée pour la
chirurgie oculaire au laser, car elle semble plus
efficace et présente moins de complications que
la PRK. Lors de cette intervention, le
chirurgien doit d’abord couper une lamelle
dans le stroma (la couche intermédiaire de la
cornée) et utiliser le laser pour retirer une partie
des tissus sous la lamelle afin de remodeler la
cornée. La lamelle est ensuite replacée et la
cornée peut se cicatriser naturellement.
L’intervention dure à peine quelques minutes
par oeil.
La PRK (photokératectomie réfractive) peut
également être utilisée pour traiter la myopie,
l’hypermétropie et l’astigmatisme. Lors de
l’intervention, le chirurgien utilise un laser
pour remodeler la cornée en retirant des tissus
de sa surface. Comme dans le cas du KISAL,
cette intervention ne dure que quelques minutes
par oeil.
La kératotomie radiale (KR) est utilisée de
moins en moins souvent et corrige la myopie
légère à modérée. Lors de cette intervention, le
chirurgien pratique des incisions disposées en
rayons sur la cornée du patient, ce qui l’aplatit
et réduit ainsi la myopie. Cette intervention
prend généralement moins d’une demi-heure.
Les avantages constatés par les patients portent
habituellement sur le changement des habitudes
de vie, mais ils peuvent être importants et
résumés par un seul mot : liberté.
Libre de nager, de jouer au basket-ball ou de
danser sans verres de contact ni lunettes
spéciales. Libre de regarder avec des jumelles
ou un appareil photo sans devoir préalablement
enlever ses lunettes. Ne plus avoir à acheter de
nouvelles lunettes tous les deux ans.
Toutefois, certaines personnes doivent
continuer de porter des lunettes même après
l’intervention. Au fur et à mesure que les gens
vieillissent, l’acuité visuelle se détériore malgré
la chirurgie correctrice. La chirurgie corrige la
vision; elle ne traite par les causes sous-
jacentes de la détérioration de la vision.
Le rétablissement varie beaucoup selon les
patients. Certains patients pourront voir
clairement en moins de 24 heures, alors qu’il
faudra plusieurs semaines à d’autres personnes
pour obtenir une acuité visuelle. Même si un
patient peut voir clairement à un stade précoce
du rétablissement, il est important d’éviter
toute activité trépidante pendant plusieurs mois.
Les sports de contact tel le football, et autres
mouvements violents comme l’activation des
sacs gonflables, peuvent causer des
complications post-chirurgicales.
Le patient devrait toujours respecter les
prescriptions du médecin. Il ne faut pas prendre
de raccourcis lorsqu’il est question de la vue.
Chirurgie oculaire, suite de la page 1
La chirurgie au laser modifie la couche externe de l’œil, plus particulièrement la
cornée. La partie externe de l’œil est constituée de trois éléments : la cornée, la
partie transparente qui couvre la pupille et l’iris; la sclérotique, la partie blanche de
l’œil; et le limbe, la partie externe de la cornée
où elle s’attache à la sclérotique.
La lumière est réfractée en deux
étapes, premièrement par la cornée,
deuxièmement par le cristallin. La
lumière doit converger clairement
sur la rétine (le récepteur du nerf
optique) pour obtenir une bonne
vision.
Chirurgie au laser
suite à la page 6
Sclérotique
Iris
Cornée
Pupille
Cristallin
Rétine

3
L
’assurance-vie, les désignations de
bénéficiaire et les droits de succession ne
suscitent généralement pas autant d'intérêt que
les placements dans les fonds mutuels ou les
rendements des indices boursiers mais ils
exigent autant de vigilance.
Une désignation de bénéficiaire ambiguë peut
entraîner de l’anxiété durant une épreuve déjà
douloureuse. Les difficultés peuvent être
accrues au lieu d'être allégées si le produit de
l'assurance est versé en retard. Voici donc
quelques conseils utiles entourant les
désignations de bénéficiaire.
• En cas de désignation de la « succession »
comme bénéficiaire, le produit de
l'assurance risque d'être assujetti aux
réclamations de créanciers et, dans certains
cas, à des droits de succession. Pour éviter
des telles situations, les participants peuvent
désigner une ou plusieurs personnes comme
bénéficiaires.
• Quand la succession est désignée comme
bénéficiaire, ou en l’absence de désignation,
il est capital de rédiger un testament. Le
chèque de la prestation décès ne peut être
encaissé que si un exécuteur testamentaire
ou un administrateur a été nommé. En
l’absence de testament, le tribunal nomme
un administrateur.
• Incitez les participants à consulter un
conseiller juridique ou financier pour toute
question relative aux testaments, aux
fiduciaires et à la planification successorale.
Les promoteurs et les administrateurs de
régime ne sont pas en mesure de fournir des
avis juridiques et financiers personnels.
• Assurez-vous toujours que la désignation de
bénéficiaire est signée et datée avant de la
classer.
• Quand le participant ajoute une deuxième
page où figurent les noms de bénéficiaires,
assurez-vous que cette page est signée,
datée et référencée en tant que pièce jointe.
• Il ne faut jamais utiliser l’expression « et/ou
» quand plusieurs bénéficiaires sont
nommés et se contenter de leur assigner un
numéro. Par exemple, il ne faut pas inscrire
« Marie Tremblay et/ou Luc Desjardins » ni
« 1. Marie Tremblay, 2. Luc Desjardins ». Il
faut plutôt inscrire tous les noms les uns à
la suite des autres (exemple : Marie
Tremblay, Luc Desjardins). Dans ce cas,
chaque personne reçoit une part égale du
produit de l'assurance.
• Il faut inscrire tous les noms en
assignant à chacun un pourcentage
(exemple : Marie Tremblay reçoit 75 %
et Luc Desjardins, 25 %) dans le cas où
le participant ne veut pas que le produit
de l'assurance soit réparti également. Les
pourcentages doivent totaliser 100 %.
• Il faut utiliser les expressions «
bénéficiaire principal » et « bénéficiaire
subsidiaire » pour stipuler que le premier
reçoit la prestation décès intégrale, à
moins qu’il ne soit décédé, auquel cas la
prestation intégrale revient au
bénéficiaire subsidiaire (exemple : « La
bénéficiaire principale est Marie
Tremblay. Le bénéficiaire subsidiaire est
Luc Desjardins »).
• Conservez l’original de la désignation.
Parfois, une copie ne suffit pas.
• Ne divulguez jamais le nom d’un
bénéficiaire à un tiers, à moins que la loi ne
vous y oblige. La désignation de
bénéficiaire constitue une information
confidentielle. (Quand la désignation de
bénéficiaire est transmise directement à
l’assureur, le code de confidentialité
empêche ce dernier de divulguer les noms
des bénéficiaires au promoteur du régime
ou à quelque autre tiers.)
• Quand un ou plusieurs des bénéficiaires
sont des mineurs, conseillez au participant
de nommer un fiduciaire ou un tuteur aux
biens des mineurs, afin d’éviter que la
prestation décès ne soit consignée en justice
ou ne soit gelée jusqu’à ce que les mineurs
atteignent la majorité.
• En cas de cessation de la couverture des
participants, conservez toujours les
désignations des personnes bénéficiant de
l'exonération de primes ou touchant des
prestations d'invalidité de longue durée. En
l’absence de désignation, la prestation décès
est versée à la succession au décès de la
personne.
• Dans certains cas de divorce ou de
séparation, le participant peut se voir
intimer par le tribunal de désigner un
bénéficiaire particulier. Le participant au
régime est tenu d'obtempérer sinon la
prestation décès peut être consignée en
justice.
Les désignations de bénéficiaire doivent être
absolument claires et précises. L’ambiguïté, si
elle ne peut être levée, génère des retards ou
peut entraîner un paiement à la succession ou
une consignation en justice.
Nota : Cet article n’a pour but que d’informer et ne
constitue pas un avis juridique. Vous devez toujours
consulter votre conseiller juridique et votre conseiller en
avantages sociaux, conjointement avec le représentant
de la Financière Manuvie, avant d’apporter des
modifications à votre régime.
Les désignations de bénéficiaire
Clarté et précision évitent bien des complications
Les désignations irrévocables
Comme leur nom l'indique, les désignations irrévocables ne peuvent être révoquées ni
modifiées.
• Au Québec, la désignation du conjoint marié est automatiquement irrévocable, sauf
indication contraire. En cas de divorce, la désignation complète (et non seulement
l’irrévocabilité) tombe en déchéance. Des règles spéciales s’appliquent aux
désignations de conjoint et aux divorces antérieurs au mois de décembre 1982; il
convient d'obtenir un avis juridique dans chaque cas.
• Quelle que soit la province, l'assuré peut désigner le bénéficiaire de son choix de
façon irrévocable. Il suffit d'ajouter une note spécifiant que la désignation est
irrévocable.
• La désignation d'un bénéficiaire irrévocable ne peut être modifiée qu'avec le
consentement du bénéficiaire désigné, à moins que celui-ci ne décède avant l’assuré.
• La désignation irrévocable demeure valide même si le titulaire du contrat change
d’assureur.
• Les règles qui régissent la désignation de bénéficiaire sont complexes. L'obtention
d'un avis juridique peut s'imposer.

4
L
’année a été stressante pour les travailleurs canadiens qui, pour la
plupart, voient l’avenir du système de soins de santé avec de plus en
plus de pessimisme, selon une récente étude d’Aventis Pharma. D’après
les résultats du sondage Aventis sur les soins de santé de 2001, le stress au
travail a augmenté de façon spectaculaire au cours de la dernière année.
De plus, bien qu’ils soient actuellement satisfaits du système de soins de
santé, les Canadiens craignent pour son avenir.
L’étude a également démontré que les Canadiens sont généralement
satisfaits de leur régime collectif de soins de santé, mais dans une moindre
mesure que l’année dernière. La plupart des employés estiment que leur
employeur cherche davantage à limiter les coûts qu’à offrir un excellent
régime de soins de santé.
Stress
Le milieu de travail est stressant pour les Canadiens. Le sondage Aventis
démontre que 62 % des répondants estiment éprouver beaucoup de stress
au travail, soit 15 % de plus que l’an dernier. Les Brittano-Colombiens
arrivent en tête de liste.
Les femmes sont plus stressées que les hommes : 65 % des femmes vivent
beaucoup de stress au travail, comparativement à 58 % des hommes. De
plus, 38 % des femmes ont déclaré que le stress au travail les a rendues
malades, comparativement à 30 % des hommes.
D’après les réponses recueillies, la charge de travail est la première cause
de stress, devant les obligations financières personnelles. Les symptômes
de stress les plus courants sont l’irritabilité et l’anxiété, l’insomnie, la
fréquence des maladies et l’absentéisme.
Pas moins de 41 % des répondants affirment que les employeurs sont loin
de faire assez d’efforts pour lutter contre le stress au travail, alors que
57 % estiment que leur employeur fait juste assez ou plus qu’assez
d’efforts pour le combattre.
Stressé? Vous n’êtes pas seul!
0
20
40
60
80
100
47 %
62 %
51 %
61 %
39 %
59 %
42 %
60 %
42 %
63 %
52 %
69 %
53 %
64 %
Proportion des employés estimant vivre beaucoup
de stress au travail
Échelle
nationale
C.-B.
Alberta
Sask. et
Man.
Ontario
Québec
Prov. de
l’Atlantique
2000 2001
0
20
40
60
80
100
« Mon travail est si stressant qu’il m’a parfois rendu
physiquement malade »
Nombre de répondants ayant répondu « oui »
34 % 30 %
38 %
Total Hommes Femmes
Oui 31 %
Ne sait
pas 22 %
Non 47 %
Oui 42 %
Non 58 %
Modalités du régime sur Internet
Selon 51 % des répondants, la diffusion sur Internet des modalités du régime
les aiderait à mieux comprendre et à mieux utiliser leurs garanties. Il s’agit
d’une hausse par rapport au sondage de 2000 (45 %) et de 1999 (44 %).
Pourcentage des employés ayant
accès à Internet et dont les
modalités de leur régime sont
diffusées sur Internet :
Pourcentage des employés qui
utilisent Internet pour consulter
les modalités de leur régime :
Pourcentage des employés qui utilisent Internet pour
consulter les modalités de leur régime :
0
20
40
60
80
100 Selon la région
59 % 53 % 49 % 40 % 33 % 29 %
Alberta
Sask. et Man.
Ontario
Prov. de
l’Atlantique
C.-B.
Québec
0
20
40
60
80
100 Selon le revenu
48 %
38 %
14 %
Plus de
60 000 $
De 30 000 $ à
60 000 $
Moins de
30 000 $

5
0
20
40
60
80
100
Les cinq initiatives potentielles en matière de santé mises
en place par l’employeur et la proportion des répondants
les estimant prioritaires
Programme
d’abandon du
tabac
Programme
d’exercice
Couverture des
nouveaux
médicaments
Clinique annuelle
de dépistage à
l’interne
Programme
d’amaigrissement
77 % 70 % 65 % 63 % 55 %
Satisfaction
Moins de Canadiens sont satisfaits de leur
régime collectif de soins de santé : seulement
66 % des répondants affirment que leur régime
de soins de santé répond à leurs besoins, par
rapport à 73 % il y a deux ans. Les participants
à un régime souple (69 %) et les employés à
temps plein (67 %) sont les plus satisfaits de
leur régime. Ce pourcentage chute à 55 % chez
les employés à temps partiel.
Lorsqu’on leur a demandé si leur régime s’était
amélioré au cours des cinq dernières années,
23 % des répondants ont répondu oui et 15 %
ont répondu non. Selon les répondants,
l’amélioration de la couverture est la principale
raison de l’amélioration du régime :
1. Couverture en général 35 %
2. Soins dentaires 21 %
3. Soins de la vue 19 %
4. Assurance médicaments 16 %
5. Coûts/primes 10 %
Les répondants ont indiqué que les coûts ou les
primes sont la principale raison de la
détérioration du régime :
1. Coûts/primes 39 %
2. Couverture en général 38 %
3. Assurance médicaments 19 %
4. Soins dentaires 17 %
5. Soins de la vue 10 %
Alors que 81 % des répondants qualifient le
système public de soins de santé
d’« excellent », de « très bon » ou de « bon »,
46 % estiment qu’il se détériorera au cours des
deux prochaines années; 28 % affirment qu’il
restera le même et 24 %, qu’il s’améliorera.
Les répondants qui ont fait appel au système
récemment (ceux ayant éprouvé des problèmes
de santé dernièrement) sont les plus
susceptibles de le désapprouver. Par exemple,
31 % des patients atteints de cancer croient que
notre système de soins de santé est mauvais,
comparativement à une moyenne nationale de
19 %. Les trois principales sources
d’inquiétude sont l’accès aux soins et aux
établissements médicaux (38 %), la pénurie de
médecins et d’infirmières (32 %), et les délais
et les listes d’attente (23 %).
Attitudes face aux
régimes d’avantages
sociaux
Les employés maintiennent (51 % sont
fortement ou plutôt d’accord) que leur
employeur cherche davantage à limiter les
coûts qu’à offrir le meilleur régime possible.
Les employés ont également l’impression
(55 %) de n’avoir aucun droit de parole sur leur
régime de soins de santé.
La majorité (56 %) des répondants affirment
qu’ils seraient disposés à payer des primes plus
élevées pour maintenir leur niveau de
couverture actuel si leur employeur s’avérait
incapable ou refusait de supporter
l’augmentation (par rapport à 50 % il y a deux
ans). Seulement 14 % préfèrent une réduction
de la couverture à une augmentation des
primes.
Les Canadiens aiment leurs
médicaments… ou du moins
leur assurance médicaments.
Lorsqu’on leur a demandé quelle couverture est la
plus importante pour eux, 60 % des répondants ont
choisi l’assurance médicaments, 34 % se disant
fortement d’accord.
La vaste majorité des répondants (90 %) considèrent
que tous les médicaments qui leur sont prescrits
devraient être couverts par leur régime.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%