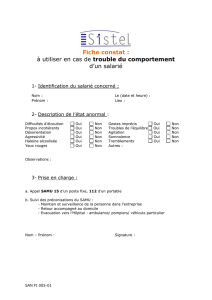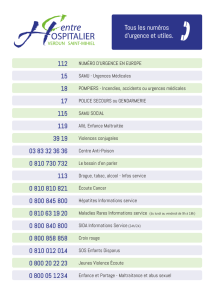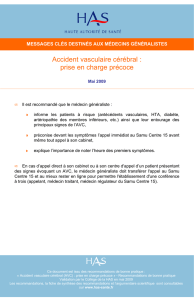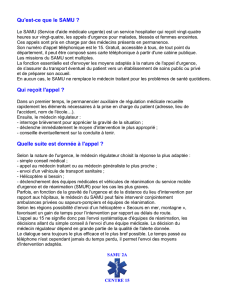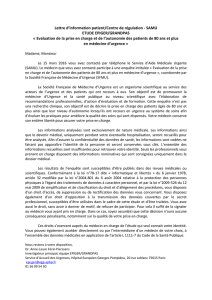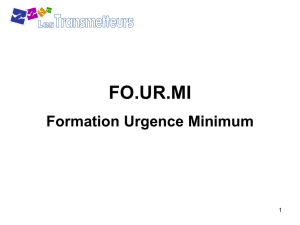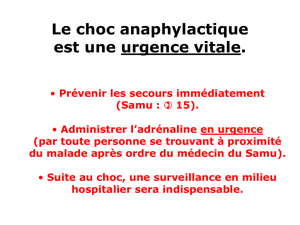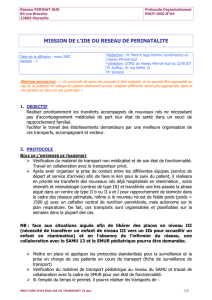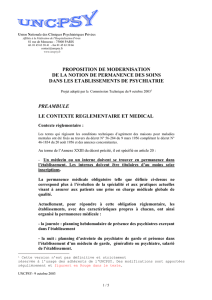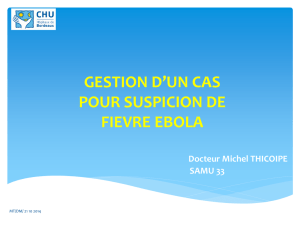Etude de faisabilité


Projet de modernisation des SI et Télécom des Samu-Centres 15
Note de synthèse de l’étude de faisabilité
Classification : non sensible, public 1 / 85
1. Sommaire
1. SOMMAIRE .............................................................................................................................................. 1
2. RAPPEL DU CONTEXTE DE L’ETUDE .......................................................................................................... 4
2.1. UNE ETUDE MENEE DANS LA CONTINUITE DE PREMIERES REFLEXIONS SUR LA MODERNISATION DES SAMU .................... 4
2.2. UN CONSTAT DE FRAGILITES TECHNIQUES DES SAMU CONFIRME ........................................................................... 6
2.3. UNE INSTRUCTION DETAILLEE DU SCENARIO DE MODERNISATION .......................................................................... 7
2.4. UNE MOBILISATION DES ACTEURS GARANTE DE L’ADHESION AUX CONCLUSIONS DE L’ETUDE DE FAISABILITE ................... 8
2.5. UNE ETUDE ETAYEE PAR UNE ANALYSE DES RISQUES ......................................................................................... 10
3. UN PROGRAMME DE MODERNISATION FONDE SUR DES PRINCIPES STRUCTURANTS POUR REPONDRE
AUX BESOINS DE L’AIDE MEDICALE URGENTE ................................................................................................ 11
3.1. APPORTER LE JUSTE SOIN SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE AVEC UN SERVICE DE QUALITE ELEVEE .............................. 13
3.2. DONNER UNE COHERENCE NATIONALE AU DISPOSITIF ....................................................................................... 14
3.3. FACILITER LA GESTION DE SITUATIONS DE CRISE NATIONALE ............................................................................... 15
3.4. DEVELOPPER LES INTERACTIONS AVEC LES PARTENAIRES .................................................................................... 18
3.5. DEVELOPPER LES INTERACTIONS AVEC LES LOGICIELS DE SANTE ROR, DMP ET MSSANTE ....................................... 20
3.6. DISPOSER D’UN SYSTEME HAUTEMENT DISPONIBLE .......................................................................................... 21
3.7. GARANTIR LA CONFIDENTIALITE DES DONNEES DE SANTE ................................................................................... 23
3.8. METTRE EN ADEQUATION LA DEPENSE PUBLIQUE ET L’ACTIVITE DES SAMU ........................................................... 24
4. UNE REPONSE EXHAUSTIVE AUX BESOINS METIER DANS LE RESPECT DU CADRE JURIDIQUE DES APPELS
D’URGENCE .................................................................................................................................................... 25
4.1. UNE ANALYSE DES PROCESSUS METIER DES SAMU PREALABLE A LA DEFINITION DES FONCTIONNALITES ATTENDUES ....... 26
4.2. UN PERIMETRE FONCTIONNEL RICHE, REPONDANT AUX BESOINS ACTUELS ET FUTURS .............................................. 28
4.3. UN SI-SAMU ADAPTE AU CADRE JURIDIQUE DE L’ACTIVITE DE REGULATION MEDICALE URGENTE ............................... 32
5. UNE DEMARCHE DE MISE EN ŒUVRE QUI PREND EN COMPTE LA COMPLEXITE DU PROGRAMME ........ 37
5.1. UN SECTEUR INDUSTRIEL A MEME DE RELEVER LES DEFIS TECHNIQUES DU PROGRAMME, UNE STRATEGIE D’ACHAT DE
NATURE A CONTRIBUER AU PATRIMOINE MAITRISE PAR LA PERSONNE PUBLIQUE ................................................................. 37
5.2. UN OBJET TECHNIQUE COMPLEXE A CONSTRUIRE DANS UNE DYNAMIQUE AGILE ET COLLECTIVE ................................. 48
5.3. UNE MONTEE EN CHARGE PROGRESSIVE DU DEPLOIEMENT, SOUTENUE PAR UNE INDUSTRIALISATION DES MOYENS ET LA
DEMONSTRATION DE LA QUALITE DU SERVICE RENDU..................................................................................................... 58
6. UN PORTAGE DU PROGRAMME A AFFIRMER ......................................................................................... 68
6.1. UNE GOUVERNANCE PROPOSEE DANS LA CONTINUITE DE L’ETUDE MENEE ............................................................ 68
6.2. UNE PLANIFICATION AMBITIEUSE MAIS REALISTE ............................................................................................. 71
7. GLOSSAIRE ............................................................................................................................................. 73
7.1. GLOSSAIRE GENERAL DE L’ETUDE.................................................................................................................. 73
7.2. GLOSSAIRE DE LA CARTOGRAPHIE FONCTIONNELLE ........................................................................................... 75

Projet de modernisation des SI et Télécom des Samu-Centres 15
Note de synthèse de l’étude de faisabilité
Classification : non sensible, public 2 / 85
Le Samu, un nouveau service public… Préface de Marc Giroud
Il s’était d’abord agi, il y a une cinquantaine d’années, de lutter contre l’insoutenable mortalité
routière en envoyant des équipes hospitalières « au pied de l’arbre », selon la formule du Professeur
Louis Lareng, l’un des pères fondateurs de ce service et l’inventeur de son appellation « Samu ».
Encouragés par la confiance de la population, les pionniers ont progressivement étendu le champ
d’intervention des équipes mobiles hospitalières d’urgence et de réanimation. Au fil des ans, la
traumatologie routière a cédé le pas aux pathologies médicales sous toutes leurs formes,
intoxications, détresses respiratoires, infarctus du myocarde, AVC...
Une telle évolution n’a pas manqué de faire apparaître la nécessité de trier les appels pour réserver
aux cas les plus lourds l’intervention sur place des équipes mobiles hospitalières. C’est ainsi qu’en
s’inspirant de l’organisation des urgences en Europe de l’Est, et en la dépassant, la régulation
médicale des appels urgents a été mise en place en France, avec le numéro téléphonique 15. Le
principe d’action initial, qui consistait seulement à trier les cas les plus graves, a progressivement fait
place à une pratique beaucoup plus large de télémédecine d’urgence, associant les urgentistes des
Samu et des généralistes de la permanence des soins. En 2011, les recommandations de la Haute
Autorité de Santé sur l’organisation des centres de régulation médicale sont apparues comme la
reconnaissance officielle de cette nouvelle composante de l’art de soigner. La reconnaissance de la
population, elle, n’avait pas attendu si longtemps. En effet, le nombre d’appels reçus n’a cessé
d’augmenter (les 101 Samu-Centres 15, couvrant la France reçoivent aujourd’hui plus de 31 millions
d’appels par an conduisant à 15 millions de prises en charge). Et, au-delà de leur nombre, c’est aussi
la variété de ces appels qui s’est singulièrement accrue jusqu’à couvrir toutes les situations d’urgence
quelle qu’en soit la gravité supposée.
Ces développements ont stimulé les progrès de la médecine d’urgence qui s’est ainsi construite en
France sur les Urgences, l’intervention extra-hospitalière et la régulation médicale téléphonique,
pratiques médicales indissociables sur les plans de la formation initiale universitaire, de la formation
continue et de la recherche clinique.
Toutefois, cet essor intellectuel ne s’est pas accompagné d’une évolution parallèle des moyens
opérationnels. La préparation des services de santé à la pandémie grippale, tout en soulignant
l’immense intérêt des centres de régulation médicale, a mis en évidence l’insuffisance et le
cloisonnement de leurs équipements techniques de télécommunication et de systèmes
d’information, dont le rôle est pourtant vital. Aucune analyse d’ensemble n’en avait, du reste, jamais
été réalisée. La construction de ces centres de régulation médicale s’était, de fait, opérée de façon
empirique, avec, au plan technique, des modèles locaux d’efficacité limitée, sans réelle
interopérabilité. La réflexion a alors objectivé des besoins d’entraide territoriale entre les centres, de
sécurisation, de surveillance épidémiologique, de recherche clinique sur la régulation médicale… et,
pour assurer la cohérence, l’efficacité et l’efficience de l’ensemble, le besoin d’une gouvernance du
système d’information des Samu.
Il est aujourd’hui plus qu’encourageant de voir, d’une part, la qualité objective de l’étude conduite
par l’ASIP Santé, à un niveau d’expertise et de concertation n’ayant rien de commun avec ce qui avait
pu être fait jusque-là, et, d’autre part, l’adhésion croissante des urgentistes hospitaliers, dont

Projet de modernisation des SI et Télécom des Samu-Centres 15
Note de synthèse de l’étude de faisabilité
Classification : non sensible, public 3 / 85
certains avaient initialement manifesté de fortes réserves et qui sont aujourd’hui impatients
d’accéder aux progrès attendus, en termes de qualité et de sécurité.
Marc Giroud

Projet de modernisation des SI et Télécom des Samu-Centres 15
Note de synthèse de l’étude de faisabilité
Classification : non sensible, public 4 / 85
2. Rappel du contexte de l’étude
2.1. Une étude menée dans la continuité de premières réflexions sur la
modernisation des Samu
Lancée en 2008, une large étude auprès des Samu a permis d’établir un état des lieux des grands
schémas d’organisation des Samu, tant d’un point de vue des équipements techniques (téléphonie,
système d’information et de radiocommunication…) que des ressources humaines et des
infrastructures. Les résultats de cette étude sont détaillés dans le rapport relatif « à la
modernisation des Samu », remis par le docteur Mardegan en juillet 2010. Ce rapport insiste sur la
persistance de fragilités opérationnelles et technologiques préoccupantes, ainsi que sur la grande
hétérogénéité des équipements et des ressources.
Par ailleurs et dans un contexte de risque de pandémie grippale due au virus A(H1N1), l’ASIP Santé a
été missionnée par le ministère chargé de la Santé pour conduire un audit des infrastructures de
télécommunication des Samu-Centres 15, afin d’effectuer un diagnostic sur la capacité de ces
structures à gérer un débordement d’appels lié à une situation de crise. Les infrastructures ayant été
diagnostiquées trop fragiles lors de la phase de préparation à cette possible pandémie, il a fallu
développer en urgence un outil « palliatif », dénommé SIN-Samu. Dans ce contexte, l’ASIP Santé a
été mobilisée pour la mise en place d’un système d’information national spécifique à la gestion de
cette pandémie grippale, déployé au sein des Samu-Centres 15. A cette occasion, l’audit mené par
l’ASIP Santé s’est in fine traduit par une étude de « Renforcement des centres 15 – Bilan et
préconisations » adressée en 2010 à la DGOS et permettant une première analyse des fragilités
techniques des Samu.
L’évolution croissante et constante de l’activité des Samu, de l’ordre de 5 à 15 % par an
1
, à laquelle
s’ajoutent les besoins de renouvellement de leurs outils techniques (système d’information,
téléphonie, radiocommunication), expliquent, en partie, les difficultés qu’ont rencontrées certains
de ces services pour assurer leurs missions de manière satisfaisante (inadaptation de l’outil, retard
technique). Cette question de l’adaptation des moyens techniques est au cœur de l’élaboration d’un
dispositif en capacité de gérer efficacement la situation nominale et les possibles situations de crise
sanitaire (pandémie grippale, etc.).
Ce constat a incité le ministère chargé de la santé à s’interroger sur la nécessité d’une action de
modernisation des plateformes d’appel des Samu-Centres 15 et a confié à l’ASIP Santé une étude sur
ce sujet, intitulée « Etude de modernisation du système d’information et de télécommunication des
Samu-Centres 15 ».
Les conclusions de cette étude, rendues en 2012, ont permis de démontrer l’opportunité de mener
un tel programme de modernisation. Malgré l’existence de projets et investissements menés dans
1
PENVERNE Y., JENVRIN J., DANET N., PINEAU CARIÉ S., POTEL G., LOUÉ B., VALLÉE JC., LAGARDE S., BERTHIER F.
De nouveaux métiers et nouvelles pratiques. Congrès Urgences. 2009. Paris, 79:793-806.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
1
/
85
100%