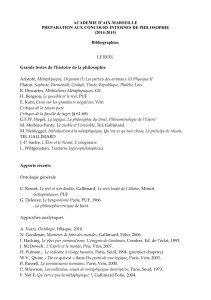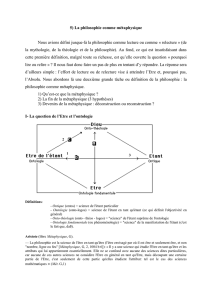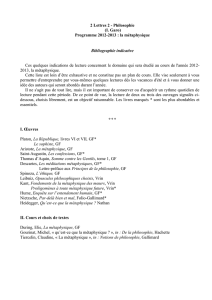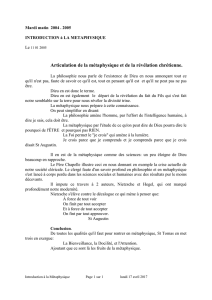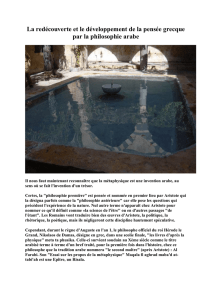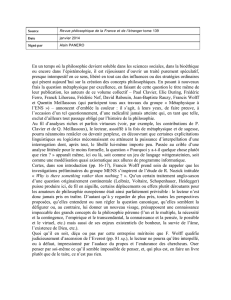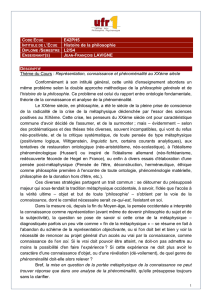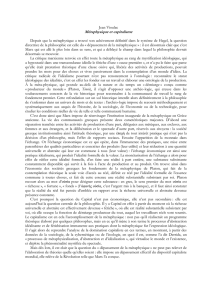PHI 1102 – Introduction à l`ontologie et à la métaphysique 1

PHI 1102 – Introduction à l’ontologie et à la métaphysique
1
PHI 1102 – Introduction à l’ontologie et à la métaphysique
Hiver 2016
Jeudi 09h30-12h30
Local : A 2885
Professeure : Aude Bandini
Courriel : [email protected]
Local : W-5275 ou W-5285
Réception des étudiants : le jeudi, de 14h à 15h30.
1. Description de l’annuaire :
Introduction à l'ontologie comme « métaphysique générale » et à la métaphysique comme
« philosophie première », donc à la recherche d'une Science (unificatrice et fondatrice) des
sciences. Présentation de quelques systèmes métaphysiques importants dans l'histoire
ancienne, médiévale et moderne, en dégageant leurs formes propres de leur fond
commun. À travers l'examen de diverses thèses ou théories métaphysiques sur l'Être,
Dieu et le monde, l'âme et le corps, la raison, la liberté, le hasard et la nécessité, etc., on
étudiera la spécificité de la pensée métaphysique.
2. Description spécifique et objectifs du cours :
Le voile des apparences
Pour introduire à ces sous-disciplines particulières de la philosophie que sont la
métaphysique et plus précisément encore l’ontologie, notre réflexion portera
essentiellement sur la délicate distinction entre apparences et réalité.
Tous, nous avons appris – parfois à nos dépens – qu’il ne faut pas se fier aux
apparences, car celles-ci ont la vilaine réputation d’être superficielles, inconsistantes ou
encore trompeuses. Par contraste, la réalité, ce sont les choses telles qu’elles sont,
concrètement, intrinsèquement, de manière stable et telle que l’on peut s’y fier, aussi bien
pour penser que pour agir. Si la philosophie doit avoir un sens et une portée, c’est de cela
– la réalité – dont elle doit traiter. Si en effet on se trompe d’objet, et que l’on fait porter
la réflexion sur les choses telles qu’elles apparaissent plutôt que sur ce qu’elles sont, on se

PHI 1102 – Introduction à l’ontologie et à la métaphysique
2
retrouve à parler de ce qui n’existe pas et par conséquent, finalement, à ne parler de rien.
La rigueur méthodologique exigerait donc qu’on commence, en philosophie comme dans
tous les autres discours qui prétendent constituer un savoir, par s’assurer de la réalité de ce
dont on parle. Or chercher à distinguer entre apparences et réalité, c’est se demander,
fondamentalement, ce qui est, ce qui existe. On entre alors de plein pied dans « la science
de l’être en tant qu’être », ou encore dans ce que l’on a eu coutume d’appeler
« philosophie première ».
Le problème est qu’il n’est pas si facile, au moins à première vue, de toujours bien
faire la différence entre l’être et l’apparaître. À quoi cette confusion renvoie-t-elle ?
Comment est-elle possible et, enfin, quels moyens avons-nous d’y échapper ? Ces trois
questions, qui traversent dans une certaine mesure l’ensemble de l’histoire de la
philosophie, vont nous permettre d’aborder l’enquête ontologique et métaphysique, dans
ce qu’elle a de spécifique, de radical mais aussi de risqué. À travers l’étude de quelques
grandes figures de l’histoire de la philosophie, de l’Antiquité jusqu’au XXème siècle, nous
tâcherons de faire la lumière sur ce qui a pu motiver, en Occident, l’idée qu’une réalité qui
nous est rationnellement accessible se cacherait derrière le voile des apparences, ainsi que
les obstacles auxquels la volonté de constituer la métaphysique comme science ou du
moins connaissance digne de ce nom s’est heurtée et se heurte encore. C’est ainsi la
légitimité de la métaphysique à se prononcer sur le réel en général et sur les objets qu’elle
revendique comme lui étant propres (tels que l’essence de la matière et de l’esprit, Dieu, la
liberté ou encore le temps) que nous aurons l’occasion d’interroger.
3. Méthodologie
La présence au cours est très vivement recommandée, ainsi que la participation aux
discussions présentées durant les séances : bien que ces dernières prendront souvent la
forme de cours magistraux, l’enseignante prendra soin d’aménager des périodes de
réflexion (individuelle ou en groupe) et les questions des étudiants et étudiantes seront
bienvenus en tout temps.
L’enseignante ainsi que le moniteur ou la monitrice du cours se feront un plaisir
d’accompagner les étudiants et étudiantes dans leur compréhension du cours et la
préparation de leur travaux.

PHI 1102 – Introduction à l’ontologie et à la métaphysique
3
Pour ce qui concerne les travaux préparés à la maison, les étudiants et étudiantes
trouveront sur le site web du Département de philosophie de l’UQÀM des documents qui
les aideront à organiser leur travail et à formater leurs devoirs en fonction des règles en
vigueur : http://philo.uqam.ca/fr/etudes/1er-cycle/soutien-apprentissage.html
Pour chaque évaluation, l’enseignante fera parvenir aux étudiants et étudiantes une
fiche de méthodologie spécifiant les consignes ainsi que les critères d’évaluation.
Veuillez enfin noter qu’en principe, aucun travail en retard ne sera accepté, à moins
d’une entente préalable conclue avec l’enseignante ou de la présentation d’un justificatif
en bonne et due forme.
4. Textes :
L’ensemble des extraits de textes vous sera envoyé sous forme électronique. Il est
fortement recommandé de les imprimer afin de pouvoir les annoter.
Il est primordial que ces textes aient été lus avec attention avant la séance qui les
concerne. Leur taille est délibérément limitée, il est également impératif que les étudiants
les aient à disposition lors des séances de cours.

PHI 1102 – Introduction à l’ontologie et à la métaphysique
4
5. Programme des séances :
Semaine
Thème
(Évaluations)
Lectures obligatoires
1
7 janvier 2016
Présentation du plan de cours et
problématique.
2
14 janvier 2016
I. Sous le voile des apparences
B. Russell, extrait de Les problèmes de
philosophie.
3
21 janvier 2016
Platon, extrait de République.
4
28 janvier 2016
Aristote, extrait de Métaphysique.
5
4 février 2016
Descartes, extrait de Méditations
Métaphysiques.
6
11 février 2016
Schopenhauer, extrait de Métaphysique de
l’amour sexuel.
7
18 février 2016
Examen de mi-session sur table.
8
23 février 2016
II. La métaphysique : reine des
science occultes ?
Nagel, extrait de Qu’est-ce que tout cela veut
dire ?
3 mars 2016
Semaine de lecture
9
10 mars 2016
Remise de l’explication de texte.
D. Hume, extrait de l’Enquête sur l’entendement
humain
10
17 mars 2016
D. Hume, extrait de l’Enquête sur l’entendement
humain
11
24 mars 2016
Kant, extrait de La Critique de la Raison Pure
12
31 mars 2016
Kant, extrait des Prolégomènes à toute
métaphysique future
13
7 avril 2016
III. Peut-on se passer de
métaphysique ?
Heidegger, extrait de Qu’est-ce que la
métaphysique ?
14
14 avril 2016
Remise de la dissertation finale.
Carnap, extrait de Empirisme, Sémantique et
Ontologie

PHI 1102 – Introduction à l’ontologie et à la métaphysique
5
5. Proposition d’évaluation :
#1. Une explication de texte : à préparer à la maison. Pondération : 30% de la note
finale.
#2. Un examen de connaissances (mi-session) : une liste de questions à développement
court, à faire sur table (3h). Pondération : 30 % de la note finale.
#3. Une dissertation de fin de session. Pondération : 40% de la note finale.
6. Notation :
A+
4.3
90-100
A
4.0
85-89.9
A-
3.7
80-84.9
B+
3.3
77-79.9
B
3.0
73-76.9
B-
2.7
70-72.9
C+
2.3
65-69.9
C
2.0
60-64.9
C-
1.7
57-59.9
D+
1.3
54-56.9
D
1.0
50-53.9
E
0.0
00-49.9
7. Matériel obligatoire et bibliographie :
Je vous enverrai l’ensemble des extraits de textes sur lesquels nous travaillerons par voie
électronique – veillez penser à consulter régulièrement votre boîte courriel de l’université.
Bibliographie indicative en français :
CARNAP, R., « Le Dépassement de la Métaphysique par l’analyse logique du langage », in
Soulez, A., Manifeste du Cercle de Vienne et autres écrits, Paris, PUF, 1985.
« Empirisme, sémantique et ontologie », in Signification et vérité, trad. De Rouilhan et
Rivenc, Paris, Gallimard, 1997.
CASATI, R. & DOKIC, J., La philosophie du son, Nîmes : J. Chambon, 1994
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%