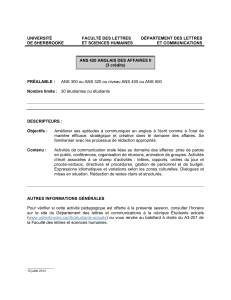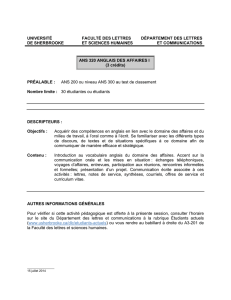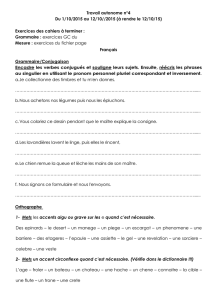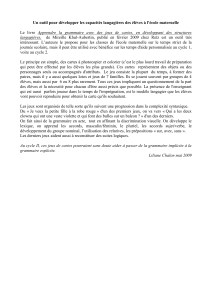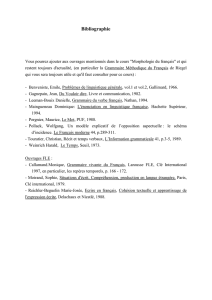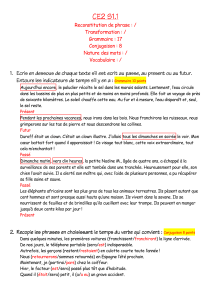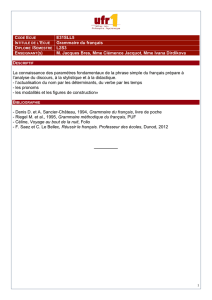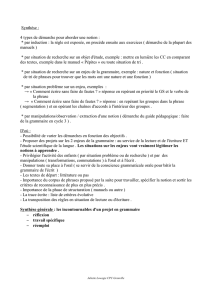Dans la grammaire de la responsabilité ainsi que dans divers

1
Responsabilité et solidarité : Etat libéral, Etat-Providence, Etat réseaux.
Jean-Louis Genard1
Dans la grammaire de la responsabilité2 ainsi que dans divers articles, j’ai tenté de montrer
l’intérêt théorique d’aborder la responsabilité dans une optique qui s’approcherait de la
théorie des conventions3 ou de ce que L.Thévenot et L. Boltanski ont appelé un
« investissement de forme »4, en y ajoutant toutefois une dimension linguistique appuyée qui,
elle, se revendiquerait davantage de l’appel lancé par Habermas dans Sociologie et théorie du
langage5.
J’ai ainsi proposé de rapporter historiquement la responsabilité à un tournant dans ce qu’on
pourrait appeler « l’interprétation de l’action », ou plus généralement, dans l’interprétation de
« ce qui se passe ». On peut aisément admettre que toutes les cultures ont cherché à répondre
à cette question et y ont, de fait, apporté des réponses très diverses, au travers desquelles se
sont structurés leurs rapports au monde, aux autres, à eux-mêmes, se sont modelés leurs
environnements institutionnels.
Sans entrer dans leur description et leur analyse historique, on peut ainsi évoquer, au fil du
temps, différents modèles d’interprétation de l’action ou de « ce qui se passe » : destin,
souillure, hasard, fortune, déterminisme astral, péché originel, grâce, providence, inconscient,
mythe, caractère, accident, loi des séries,… et responsabilité.
Une théorie de la modernité.
A partir des hypothèses développées dans La grammaire de la responsabilité se profile une
théorie de la modernité. Celle-ci se trouve en effet ancrée sur l’émergence de l’interprétation
responsabilisante de l’action, une interprétation qui va s’imposer lentement au travers d’une
lutte difficile avec d’autres modèles d’interprétation de l’action alors dominants, en
l’occurrence principalement les modèles théologiques du péché originel, de la grâce ou de la
Providence et le modèle du déterminisme astral hérité de l’aristotélisme. Cette lutte durera
jusqu’au 18e siècle. Mais le siècle des Lumières ne sanctionnera pourtant pas le triomphe
définitif du modèle responsabilisant. Au contraire, il consacrera l’émergence de nouveaux
concurrents, étayés cette fois sur les différentes sciences humaines en train de naître, et qui,
1 Jean-Louis GENARD est philosophe et docteur en sociologie. Directeur de l’Institut Supérieur d’Architecture
de la Communauté Française « La Cambre » à Bruxelles, il est également chargé de cours à l’Université Libre de
Bruxelles et aux Facultés universitaires Saint-Louis. Il dirige le GRAP, groupe de recherches en administration
publique, attaché à l’ULB. Il a publié plusieurs ouvrages comme auteur ou comme éditeur : Sociologie de
l’éthique (L’Harmattan, 1992), Les dérèglements du droit (Labor, 1999), La Grammaire de la responsabilité
(Cerf, 2000), Les pouvoirs de la culture (Labor, 2001), La motivation dans les services publics (avec T. Duvillier
et A. Piraux, L’Harmattan, 2003), Enclaves ou la ville privatisée (avec P. Burniat, La Lettre volée, 2003), Santé
mentale et citoyenneté, (avec J. De Munck, O. Kuty, D. Vrancken, et alii, Academia, Gand, 2004), Qui a peur de
l’architecture ? Livre blanc de l’architecture contemporaine en communauté française de Belgique (avec P.
Lhoas, La Lettre Volée, La Cambre, 2004), Expertise et action publique (avec St. Jacob, Presses de l’Université
libre de Bruxelles, 2004)… ainsi que de très nombreux articles. Ses travaux portent principalement sur l’éthique,
la responsabilité, le droit, les politiques publiques, la culture, l’art et l’architecture.
2 J.L. GENARD, La grammaire de la responsabilité, Humanités, Cerf, Paris, 1999.
3 Ch. BESSY et O. FAVEREAU, Economie des conventions et institutions, http://forum.u-
paris.fr//telecharger/seminaires/ecoinst/EI231003 (conculté en novembre 2005)
4 L. BOLTANSKI et L. THEVENOT, De la justification, Gallimard, Paris, 1991.
5 J. HABERMAS, Sociologie et théorie du langage, A. Colin, Paris, 1995.

2
toutes, selon des modalités diverses, proposeront des modèles renvoyant l’interprétation de
l’action vers des modèles déterministes plus ou moins forts, proposant ainsi de l’homme
l’image d’un « doublet empirico-transcendantal », comme l’écrira M. Foucault en s’inspirant
de l’antinomie kantienne du déterminisme et de la liberté, ou de son dualisme « phénoméno-
nouménal ».
A suivre les avatars de l’interprétation responsabilisante de l’action dans ses relations
conflictuelles avec ses concurrentes se dégageraient donc deux modernités. Une première qui
irait du moyen-âge au siècle des Lumières où s’impose l’interprétation responsabilisante de
l’action, l’image de l’homme autonome et rationnel qu’illustrera le cogito cartésien. Mais à
partir du 18e siècle, une seconde où l’interprétation responsabilisante de l’action se trouve
contestée par de nouveaux concurrents étayés par les savoirs psychopathologiques, médicaux,
sociologiques, statistiques…
A présenter les choses de cette façon, on court évidemment le risque de verser dans une sorte
d’historicisme des idées. Bien entendu, la réalité est moins simple et plus dialectique. Si
émerge l’interprétation responsabilisante de l’action, c’est que, sans doute, ses conditions
d’émergence se trouvaient déjà à l’œuvre dans des dispositifs sociaux qui vont en permettre
l’explicitation. Et, à l’inverse, si elle s’impose lentement, c’est aussi parce qu’elle s’incruste
dans des dispositifs sociaux qui, la présupposant, vont sans cesse contribuer à en avérer la
pertinence. Quelques exemples illustreront mon propos.
Ainsi, l’émergence de ce que j’appelle l’interprétation responsabilisante de l’action va-t-elle
contribuer à la transformation de nombreux dispositifs sociaux centraux. En particulier, on va
assister à un processus de « subjectivisation » du droit, pour reprendre l’expression de M.
Villey6. Abandonnant sa dominante objectiviste héritée de l’Antiquité, le droit va en venir
progressivement à calquer sa logique sur celle de la responsabilité. La sémantique, de la
volonté, de l’intention… vont s’y imposer. Le droit traitera désormais de « vol » bien plus que
de « chose volée ». L’anthropologie s’en trouvera également modifiée orientant l’essentiel de
ses réflexions vers les conditions de l’autonomie, la raison bien sûr mais aussi la volonté,
terme que ne connaissait par exemple pas le grec des grands philosophes de l’Antiquité7. Les
anciennes pratiques religieuses elles-mêmes connaîtront des réorientations : la place de
l’intention et de l’examen de conscience occuperont une position centrale dans la confession.
Toute une série de pratiques s’appuieront désormais sur l’engagement, le consentement, le
consensus,… comme le mariage, l’acquisition de la citoyenneté urbaine, le contrat, le
serment…
Les tensions entre modèles concurrents donneront lieu à des disputes comme celle, durant la
première modernité, concernant le statut des sorcières (considérées comme sujets de droit et à
ce titre punissables) et des possédées (pénétrées de l’extérieur sans y porter de responsabilité).
Ou comme les innombrables querelles qui traverseront la seconde modernité entre les
interprétations responsabilisantes des multiples anomies et les interprétations
déresponsabilisantes qu’en proposeront les différentes sciences humaines : le délinquant bien
sûr, mais aussi le vagabond, le fou… Les divergences interprétatives donnant lieu à des
« traitements sociaux » différents. La prison ou l’hôpital psychiatrique. La répression ou la
prévention. La moralisation ou la thérapie. La tension majeure aujourd’hui étant celle que
génèrent les découvertes actuelles des neurosciences par rapport au modèle de l’acteur
autonome, j’y reviendrai brièvement.
6 Voir J.L. GENARD, op. cit., p. 55s.
7 Voir H. ARENDT, La vie de l’esprit II, Le vouloir, PUF, Paris, 1983.

3
La dimension linguistique.
Dans la grammaire de la responsabilité, suivant en cela la suggestion de J. Habermas dans
Sociologie et théorie du langage, j’ai également suggéré que l’ancrage de l’interprétation
responsabilisante de l’action se situait au cœur de certaines de nos structures linguistiques les
plus essentielles. J’y ai attiré l’attention sur deux d’entre elles : d’une part la grammaire des
pronoms personnels, d’autre part, celle des modalités.
a) Sans entrer dans les détails, je rappellerai tout d’abord que la responsabilité est à la fois
faculté de commencer, obligation de répondre de ses actes à l’autre, obligation de répondre de
l’autre, qu’elle peut aussi se concevoir de manière collective… Historiquement, l’émergence
de l’interprétation responsabilisante de l’action sera d’abord celle d’une responsabilité pensée
comme faculté de commencer, d’une responsabilité envisagée à la première personne (Je).
Mais ce que je me reconnais à la première personne, je dois également l’accorder à l’autre.
Cet autre qui est celui à qui je dois répondre de mes actes : comme l’entérinera rapidement le
droit, la responsabilité-Je est commutative. Ma liberté, ma faculté de commencer s’arrête là
où commence celle de l’autre (Tu commutatif)).
Mais l’autre n’est pas seulement ma propre réversibilité, il est aussi une obligation pour moi
comme l’a souligné E. Lévinas (Tu). Cette responsabilité-Tu, comme obligation de répondre
de l’autre ne s’inscrira pas dans le droit de la première modernité, bien que cela ait été
l’occasion de débats. Ceux-ci furent toutefois tranchés au travers de l’opposition entre droits
parfaits et imparfaits, ces derniers, liés précisément aux exigences de bienveillance, de
sollicitude… n’entraînant aucune obligation légale, aucun droit d’exiger non plus de la part
des bénéficiaires potentiels. Alors que la responsabilité-Je s’inscrivait dans le droit, en y
intégrant sa dimension commutative, la responsabilité-Tu se trouvait renvoyée vers la morale
et ce n’est qu’avec l’Etat social que cette question acquit une dimension politico-juridique.
Mais la responsabilité peut quitter la dimension du singulier. Elle peut être pensée et assumée
(Nous) ou imputée (Vous) collectivement. Elle peut enfin être renvoyée vers des traitements
impersonnels (Il, Eux…), comme ce sera le cas avec les systèmes assuranciels.
b) la deuxième structure linguistique essentielle pour saisir les diverses accentuations et
métamorphoses de la responsabilité est ce que les linguistes appellent la grammaire des
modalités.
Dans la théorie classique, existent trois modalités : la nécessité, la possibilité et
l’impossibilité. Celles-ci s’énoncent à l’aide de ce que les linguistes appellent des auxiliaires
de modalité. Parmi ceux-ci, on en distingue habituellement deux principaux : devoir et
pouvoir ; et deux secondaires : vouloir et savoir. Chacun de ces verbes pouvant évidemment
connaître des variantes. Ainsi, peut-on également exprimer la modalité du groupe « savoir », à
l’aide de verbes ou locution comme « croire », « être conscient »… Ainsi, le verbe
« pouvoir », peut-il également se dire « être capable de ».
Les linguistes toujours proposent une catégorisation de ces auxiliaires selon les axes suivants :
Modalisations
Objectivantes
Subjectivantes
Virtualisantes
Devoir
Vouloir
Actualisantes
Savoir
Pouvoir

4
Il existe une relation fondamentale entre cette grammaire et la responsabilité. Sans entrer dans
le détail, on peut aisément se convaincre que répondre à la question « est-il responsable de
cela ? », revient en réalité à se poser des questions comme « devait-il ou non faire cela ? »,
« a-t-il réellement voulu cela ? », « savait-il ce qu’il faisait ? », « pouvait-il faire
autrement ? », cette dernière question pouvant d’ailleurs –nous aurons à y revenir- se
comprendre en deux sens « avait-il la possibilité ? » et « était-il capable ? », la première
renvoyant plutôt à un pouvoir « objectif », la seconde à un pouvoir « subjectif ».
Se référer à cette grammaire formelle peut être très éclairant pour saisir d’autres accentuations
possibles de la responsabilité. Sans entrer dans des explications théoriques complexes, j’en
donnerai des illustrations. Ainsi, l’imputation de responsabilité peut-elle par exemple se
focaliser sur les seules dimensions virtualisantes et vérifier les intentions de l’acteur. C’est ce
que proposait la morale kantienne, morale du devoir et de la (bonne) volonté, et ce que faisait
prioritairement le droit classique. Mais elle peut également se focaliser sur les modalisations
actualisantes : peu importe l’intention, ce qui importe c’est le résultat et tout compte fait
l’acteur « aurait pu éviter… », « aurait dû savoir… ». L’extension actuelle de la responsabilité
sans faute s’appuie sur une conception objective de la responsabilité découplée de
l’évaluation de l’intention et de nombreux procès contemporains en arrivent à des
condamnations selon le principe du défaut de précaution. L’intérêt heuristique de se référer à
cette grille s’éclairera notamment dans la suite du texte au travers des références qui y seront
faites aux concepts de capacité et de capacitation.
Trois strates étatiques et leurs formes de responsabilité correspondantes.
Si le propos de départ de la Grammaire de la responsabilité se situait prioritairement sur le
terrain d’une anthropologique philosophique mêlée de sociologie, il invitait à multiplier les
incursions dans d’autres domaines dont quelques intuitions laissaient clairement penser que
des interprétations à partir du canevas rapidement rappelé ici pouvaient y apporter des
éclaircissements significatifs. Cette conviction s’est trouvée renforcée par une invitation
initiée par Fr. Ost à participer à des séminaires, un colloque et, ensuite une publication
consacrée au thème La responsabilité, face cachée des droits de l’homme8, dont le propos
était de suggérer une relecture du droit, de ses tensions récentes comme de ses évolutions
historiques à partir de la responsabilité.
L’idée de proposer, à partir de la question de la responsabilité, une interprétation des
transformations du politique, se trouvait par ailleurs encouragée par la ré-irruption du
vocabulaire de la responsabilité au sein même du discours politique, en l’occurrence celui de
l’Etat « social actif ».
Dans le cadre de travaux développés principalement à propos de l’évolution des politiques
publiques en matière de santé mentale9, j’ai eu, avec d’autres, l’occasion de réfléchir à
l’évolution des formes d’intervention étatique. De ces réflexions collectives se sont imposées
trois formes d’Etat, correspondant à trois types dominants de droits. C’est cette typologie que
je souhaiterais reprendre ici, mais sous l’angle de la responsabilité cette fois. Pour qu’il n’y ait
pas de mécompréhension de mon propos, je tiens à préciser d’emblée que les différentes
8 F. OST, H. DUMONT, S. VANDROOGENBROECK (éd), La responsabilité, face cachée des droits de
l’homme, Bruylandt, Bruxelles, 2005.
9 J. DE MUNCK, J.L. GENARD, O. KUTY, D. VRANCKEN et alii, Santé mentale et citoyenneté, les mutations
d’un champ de l’action publique, Academia, Gent, 2004.

5
formes étatiques qui se dégageront ici forment en réalité des strates qui, à la fois, se succèdent
historiquement mais, au travers des dispositifs qu’elles déposent chacune, laissent leurs traces
et donc se superposent autant qu’elles se succèdent.
Par ailleurs, mes développements demeureront relativement superficiels, insistant
principalement sur les mutations des relations entre responsabilité et solidarité.
L’Etat libéral et la responsabilité-Je.
La première forme étatique s’appuie sur ce que l’on a coutume d’appeler les droits-libertés
qui constituent l’essentiel des premières déclarations universelles des droits de l’homme. Ces
droits s’identifient à des possibilités physiques et intellectuelles qui sont accordées aux
citoyens, telles les libertés de réunion, de culte ou d’opinion. Accorder de telles libertés
signifie, selon le principe du libéralisme politique, interdire à l’Etat d’imposer un seul système
de représentation ou un seul « style de vie » dans les domaines couverts par ces libertés. Ces
libertés ouvrent donc pour l’acteur des espaces d’autonomie. L’accentuation se porte à
l’évidence sur la responsabilité Je dont on a vu qu’elle s’était inscrite dans le droit et avait
fondé le processus de subjectivisation ou de moralisation du droit dont parle M. Villey.
L’Etat est là considéré dans sa forme minimale. Moins il intervient dans les domaines
couverts par les libertés, mieux ces libertés sont garanties. A certaines réserves près toutefois,
celles qui touchent à la sécurité d’une part, aux bonnes mœurs de l’autre. L’Etat libéral est un
Etat-gendarme ou sécuritaire.
Dans sa dimension sécuritaire d’abord, cette restriction peut s’interpréter comme la traduction
institutionnelle du principe de commutativité que supporte traditionnellement l’accentuation
Je de la responsabilité. Ce que je me reconnais à moi-même, je dois le reconnaître également
à l’autre. La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres.
L’interprétation de la dimension « bonnes mœurs » nous renvoie quant à elle plutôt vers la
grammaire des modalités. Comme c’était le cas des morales de l’époque, par exemple la
morale kantienne, l’accentuation est mise sur les modalités intentionnelles de l’action le
devoir et le vouloir, ceux-ci étant référés à un ensemble de valeurs substantielles qui
restreignent l’étendue des libertés. La définition classique que donne Montesquieu de la
liberté politique est à cet égard très parlante : « pouvoir faire ce qu’on doit vouloir ». Le
« pouvoir faire » des libertés publiques que doit garantir l’Etat se trouve circonscrit dans les
limites moralisantes du « devoir vouloir ».
Quant à la question des modalisations actualisantes, elle est « traitée » au travers d’une
segmentation capacitaire des citoyens dont les effets se vérifient très largement dans le droit,
et notamment au niveau des droits-participations qui s’ajoutent aux droits-libertés et qui
s’appuient sur une différenciation forte entre citoyens « capables » et « incapables ». Cette
distinction est pensée selon des termes objectivistes et renvoyée à des « indicateurs » sociaux
comme la fortune, la situation sociale, le sexe… Sont par exemple considérés comme
incapables, les domestiques, les fous, les femmes, les personnes dépendantes
économiquement… Quant à l’image de l’individu « capable », elle se trouve clairement
associée à celle d’une responsabilité-Je, celle de l’acteur autonome qui, en fonction de ses
ressources sociales et subjectives (sa raison guidant sa volonté), est en mesure de choisir, de
prendre des initiatives… bref jouit d’une « faculté de commencer » à partir de laquelle se
pense d’ailleurs une société civile dont le prototype est le marché.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%