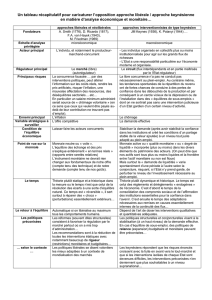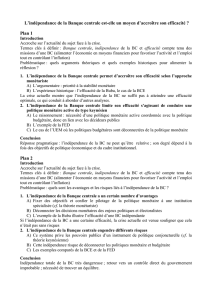Doctrines économiques et politique monétaire notions

Doctrines économiques et politique monétaire
notions de base
1) L’analyse keynésienne souligne l'incapacité des mécanismes marchands spontanés
(donc du laisser-faire) à assurer une croissance stable et le plein-emploi : la notion de « chomâge
involontaire » s’oppose à la thèse libérale du « chômage volontaire » selon la quelle le refus de
baisser les salaires relatifs serait la cause du chômage ; le salaire étant à la fois un coût et un
débouché, et l’investissement (créateur d’emploi) étant lui-même tributaire d’anticipation sur les
débouchés, la baisse des salaires peut creuser la crise au lieu de la résorber – et elle n’assure en
aucun cas un équilibre de plein-emploi. Quant à l’action sur le taux d'intérêt (politique monétaire
visant, dans une optique libérale à égaliser l'épargne et l'investissement), elle se heurte aussi, dans
l’optique keynésienne à la comparaison faite par les investisseurs potentiels entre taux d’épargne et
« efficacité marginale de l’investissement » (assimilable à l’anticipation de profits et de débouchés
associés à un investissement productif). Si celle-ci est basse, même de faibles taux d’intérêt
n’assureront pas l’investissement et donc la création d’emploi. En outre, pour Keynes, le taux
d’intérêt n’égalise pas épargne et investissement mais agit sur l’offre et la demande de monnaie dans
une économie de production monétaire (où la monnaie n’est pas un voile neutre).
Les politiques d’inspiration keynésiennes pendant les « 30 glorieuses » retiennent l’idée que
les mécanismes spontanés du marché peuvent être défaillants, notamment face au chômage et à la
crise et que l’action sur les taux d’intérêt est insuffisante :
• D'où les priorités (volontaristes) des politiques économiques (croissance et plein-emploi).
• Dans ce cadre, la politique budgétaire vise à soutenir la « demande effective » par des dépenses
publiques ou par une politique fiscale redistributive (en faveur des catégories à bas niveaux de
revenu dont la propension marginale à consommer est forte). La politique monétaire (crédits
facilités, taux d'intérêts faibles) appuie ces orientations qui poursuivent une pluralité d'objectifs
finals (croissance, contrôle des prix, plein-emploi) selon la phase du cycle économique (logique
contracyclique, politiques de « stop and go », discrétionnaire, c’est-à-dire selon les phases de
surchauffes inflationnistes ou de ralentissement de la croissance).
• Au plan théorique, ces interventions se situent dans le cadre d'une interprétation non
dichotomique de l’économie (articulation et non pas séparation entre sphère monétaire et sphère
« réelle ») ; elles relèvent aussi de l’interprétation néokeynésienne de la courbe de Phillips1 selon
laquelle un peu d'inflation est le prix à payer pour tendre vers le plein emploi. Ceci suppose en
effet un rôle actif de la politique monétaire sur l'économie réelle : les crédits (servant à financer
l'Etat ou l'économie) et les taux d'intérêts bonifiés doivent soutenir les politiques de relance ou
des secteurs particuliers de l'économie.
2°) Les approches monétaristes réaffirment au contraire une vision dichotomique de l'économie
(fonction privilégiée de la monnaie comme intermédiaire aux échanges, sorte de voile neutre, bien que,
sous l'influence keynésienne, la monnaie soit désormais considérée comme un actif financier liquide.
L’inflation est, selon Friedman, un phénomène exclusivement « monétaire » lié à une trop grande
quantité de monnaie en circulation.
Dès les années 60 la polémique sur la courbe de Phillips oppose Friedman à la relecture de
Samulelson/Debreu. Friedman a toutefois introduit une distinction entre court terme et long terme :
car il lui fallait bien reconnaître dans les années 1960 une certaine efficacité des politiques
d’inspiration keynésiennes sous l’angle du plein-emploi. Il admettait dès lors que la politique
monétaire pouvait à court terme stimuler la création d'emplois, mais il la rejetait comme globalement
1 On rappelle que Phillips a publié en 1958, une courbe montrant une corrélation inverse entre taux de chomâge
et taux d’accroissement des salaires nominaux établie à partir d’une étude empirique sur près d’une siècle (1861-
1957) de données concernant la Grande-Bretagne. Cette courbe a fait l’objet d’une « relecture » de Samuelson et
Solow en 1960 : passant du taux de croissance des salaires au taux d’inflation (moyennant l’hypothèse d’une
croissance du taux de salaire supérieure à celle de la croissance de la productivité du travail), les auteurs
interprétaient la courbe en termes de «dilemme inflation-chômage ». Il s’agit évidemment d’une interprétation
restrictive et discutable de l’inflation dont la cause essentielle est réduite à la hausse des salaires.

et à long terme perverse. Son effet de court terme était dû, selon lui, à l'illusion monétaire pesant de
façon dissymétrique sur les salariés et les employeurs. En dernier ressort, le plein-emploi ne peut
résulter que des mécanismes marchands « libérés » - ce qui impose un retour à la « flexibilité » du
travail et des salaiires.
On en revient en effet à l'interprétation néo-classique du chômage comme « volontaire » :
l’emploi est déterminé sur un « marché du travail » où des offres et de demandes d’emplois
s’expriment en fonction des salaires réels (ou relatifs, s/p) et non pas nominaux (s). Selon ce schéma,
une baisse du salaire réel implique une baisse de l’offre de travail (des salariés) et une hausse de la
demande émanant des entreprises. Le salaire réel est une variable d’ajustement. Le salaire réel doit
évoluer comme la productivité du travail (qui est supposée baisser quand l’embauche s’accroît). On
retrouve alors l'analyse libérale du “ chômage volontaire ” dû aux résistances des salariés qui
refusent la baisse du salaire réel - ou qui préfèrent des allocations plutôt que travailler... D’où les
préceptes libéraux : supprimer les protections et l’interventionnisme d’Etat.
Les “nouveaux classiques” radicaliseront l'approche de Friedman en affirmant qu’à court et à
long terme dominent des « anticipations rationnelles » intégrant en fait l’effet de l’inflation, et donc
déjouant toute illusion monétaire. La défiance envers les politiques économiques impulsées par l'Etat
(cf. aussi « Supply siders » et Ecole du Public Choice) se traduira notamment par la recommandation
de rendre les Banques centrales indépendantes des pouvoirs publics. Cette approche inspirera le statut
de la Banque centrale européenne (BCE), plus indépendant des pouvoirs publics que la FED (Banque
centrale des Etats-Unis).
Globalement, la politique monétaire doit selon l'approche monétariste accompagner le cycle
(donc assurer des liquidités dans l'économie proportionnelles à la croissance du PIB) : ceci ramène à
une conception de la monnaie comme “voile” neutre, et à l'approche quantitative de la monnaie selon
laquelle la « masse monétaire » détermine les prix. Les autorités monétaires doivent donc contrôler la
masse monétaire et briser les anticipations inflationnistes…
Ce qui soulève trois questions récurrentes
- Quel agrégat exprime ici la « masse monétaire » ?
- les BC contrôlent-elles la création monétaire et ces agrégats ?
- l’inflation est-elle seulement due à la quantité de monnaie en circulation
3°) On ne peut identifier politiques néo-libérales et monétarisme – ce dernier courant n’étant
qu’une des composantes des écoles néo-libérales, et des divergences opposants les courants se
réclamant Hayek (avec les « supply siders » - théoriciens mettant l’accent sur les conditions de
« l’offre ») et les monétaristes.
- les premiers n’adhèrent pas à la conceptions quantitativiste (monétariste) de la monnaie – et ne
retiennent donc pas un objectif de masse monétaire comme « objectif intermédiaire visant à réguler les
prix. Ils en reviennent à des politiques plus pragmatiques, et à l’utilisation « classique » des taux
d’intérêt comme variable supposée ajuster épargne et investissement.
- les théoriciens de l’offre ont critiqué la politique monétariste de la FED du tournant des années 1980
comme cause de la récession – aggravant au lieu de réduire les conditions « de l’offre » (de profit et de
coûts – avec la hausse des taux d’intérêt)…
En pratique, comme en théorie, la BCE doit concilier des approches différentes entre BC nationales
(BCN) du SEBC (système européen de banques centrales) : elle s’appuie donc sur « deux
stratégies »… dans sa politique monétaire : l’une de « masse monétaire », et l’autre… de contrôle
direct de l’inflation.
Le vrai point commun des uns et des autres est la conception de l’emploi et des salaires, devant obéir à
une logique de compétition marchande.
1
/
2
100%