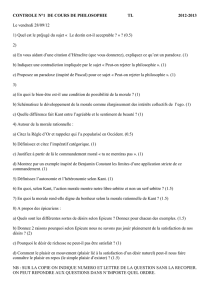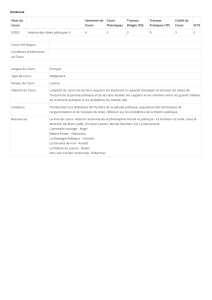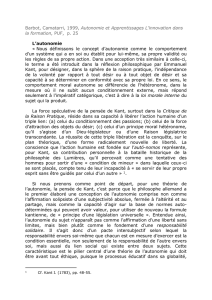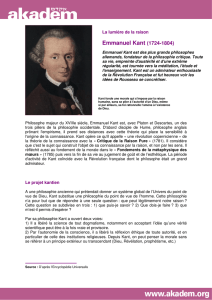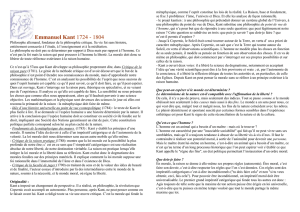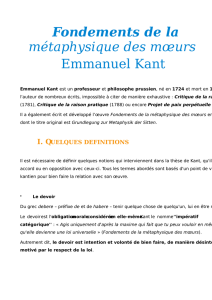Le mal dans l`éthique de Kant

Kant2 Cours Jean-Claude Wolf – Le mal Printemps 2009-04-06
Le mal dans l’éthique de Kant
Selon Kant, la valeur morale puise sa source uniquement dans la bonne volonté. Les actes
n’ont de valeur morale que s’ils émanent de la bonne volonté.
Il ne suffit que les actes soient conformes au règlement ; ils doivent également être accomplis
par devoir.
La première des difficultés rencontrées par l’argument de Kant :
Les actes accomplis par devoir sont raisonnables.
Les actes moralement faux ne sont pas raisonnables.
Les actes mauvais sont extrêmement déraisonnables.
Le mal est complètement incompréhensible.
La deuxième difficulté :
Les actes accomplis par devoir sont libres.
Les actes moralement faux ne sont pas libres.
Les actes mauvais ne sont pas libres d’une manière extrême.
Il n’y a pas de responsabilité morale pour les actes mauvais.
La troisième difficulté
Les actes accomplis par devoir sont issus de la bonne volonté.
Les actes moraux proviennent de la mauvaise volonté
Il n’y a pas d’actes sans une mauvaise intention.
La quatrième difficulté
Les hommes ne peuvent pas utiliser les autres comme un moyen. (Interdiction de
l’instrumentalisation)
Si les autres nous agressent ou nous menacent, nous ne pouvons pas nous défendre sans que
nous les mettions hors d’état de nuire ou que nous les détruisions comme nous détruirions des
obstacles ou des sources de danger. Nous les traitons donc comme des moyens
d’autoprotection.
Kant propose les solutions suivantes :
Pour la première difficulté : Les actes moralement faux ne sont pas raisonnables, mais ils
peuvent être expliqués par le calcul intelligent ou les tendances d’une personne. C’est
pourquoi, le mal n’est pas complètement incompréhensible.
Pour la deuxième difficulté : Les actes moralement faux ne sont pas libres, ils découlent
d’une décision interne ; ils sont relativement libres et peuvent ainsi être blâmés ou punis.
Pour la troisième difficulté : Tous les actes mauvais ne sont pas diaboliques (accomplis avec
une mauvais intention, avec l’intention de nuire à autrui). Les actes diaboliques ne forment
qu’une partie de tous les actes mauvais. Ils sont plutôt rares et ne permettent pas d’expliquer
la totalité des mauvais agissements.
Pour la quatrième difficulté : Kant pourrait répondre à cette objection en soutenant une
théorie à deux niveaux. La théorie idéale : dans des conditions idéales, les hommes se
comportent tous de manière morale parce qu’ils vivent en harmonie dans le « règne des fins ».
La théorie non-idéale : les conditions font que quelques hommes agissent de manière
immorale, qu’ils sont coupables moralement ou même mauvais. Aussi méritent-ils d’être
blâmés, voire punis. Cette théorie règlemente notre rapport avec le mal (dealing with evil).

Cette distinction a été proposée par John Rawls et par Christine Korsgaard à la lumière de leur
propre interprétation de Kant.
La Théorie idéale : les hommes sont considérés dans des conditions qui font qu’ils se
comportent conformément à la morale (strict compliance). La réalisation de la morale n’y est
dont pas systématiquement empêchée (par des traditions d’oppression, de discrimination,
etc.). Dans de telles conditions idéales, l’homme doit respecter les maximes qui sont
universalisables. Il ne peut pas se servir des autres personnes comme moyen (interdiction de
l’instrumentalisation), de même que si nous vivions dans le « règne des fins ». Nous n’aurions
alors pas besoin de tenir compte des conséquences de nos actes ni de ce que font les autres.
L’interdiction d’instrumentaliser autrui y est absolue.
La Théorie non idéale considère les hommes dans des conditions réelles et donc imparfaites.
A ce niveau, nous devons réagir à l’injustice et au mal fait par autrui. Nous ne devons
enfreindre aucune des règles qui servent à protéger autrui et à réinstaurer la paix. (L’homicide
en état de légitime défense, les punitions, la désobéissance civile sont des exemples discutés
par Rawls.) Dans des situations très particulières, nous pouvons légitimement recourir au mal
pour combattre le mal. (Korsgaard tente d’interpréter Kant d’une manière plus plausible à
l’aide de cette distinction.)
Les difficultés du modèle de Korsgaard : nous ne vivons pas dans un monde idéal.
Comment pouvons-nous alors appliquer cette théorie idéale ? Nous sommes toujours,
potentiellement du moins, dans une situation particulière qui nécessiterait d’enfreindre les
normes concernant la vie d’autrui.
Le modèle kantien de l’explication du mal :
Les actes mauvais découlent d’une maxime qui dit : si mes devoirs sont inconciliables avec
mes intérêts, je ferai peut-être une exception pour moi en agissant en fonction de mes intérêts.
Le mal vient de cette réserve personnelle qui privilégie notre propre égoïsme. La plupart du
temps, elle n’est pas avouée publiquement, car l’homme mauvais se ment à lui-même. Elle
permet d’embellir ses intentions et ses agissements et d’en refuser la responsabilité. (« Je ne
voulais que ce qu’il y a de mieux. » « J’avais des idéaux élevés et ne pouvais pas respecter les
règles morales » « Mes penchants étaient plus forts que ma raison. » « Les circonstances m’en
ont obligé. » « Les autres m’y ont incité. »)
Objection : Kant diabolise les penchants et les intérêts humains en les expliquant par le mal
radical. Il pense de manière quasiment calviniste en acceptant que nos penchants soient
radicalement pervertis.
Réponse de Kant : les penchants humains et tant que tels ne sont ni bons ni mauvais. Le mal
concerne les décisions humaines ou les attitudes personnelles qui peuvent être formulées au
moyen d’une mauvaise maxime. Cette maxime permet aux hommes de s’extraire du filet des
devoirs moraux.
Mon objection : Kant veut à tout prix bannir les fondements égoïstes de la morale. Chose qui
n’est ni réaliste, ni bien fondée.
Littérature :
Korsgaard, Christine M. (1986): Kant on Dealing with Evil, in: Philosophy and Public Affairs
15, 420-440.
Rawls, John (1971): A Theory of Justice, Cambridge, MA 1971, secs 2, 11, 26, 39, 46.
Wolf, Jean-Claude (2007): Egoismus und Moral, Fribourg.
1
/
2
100%