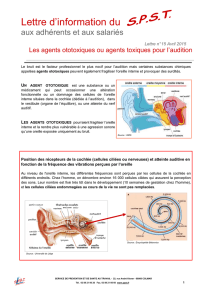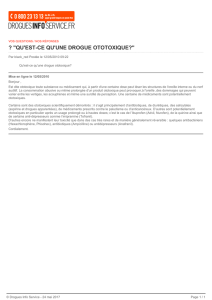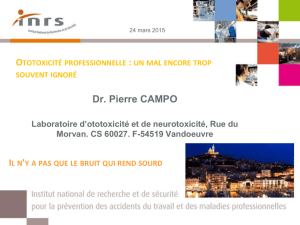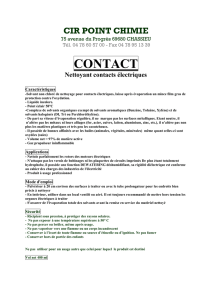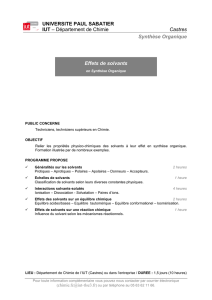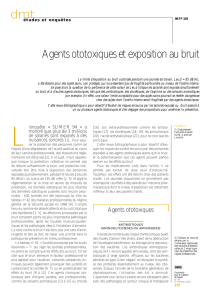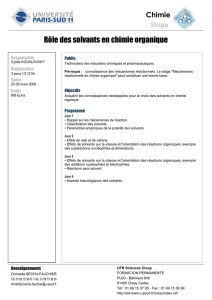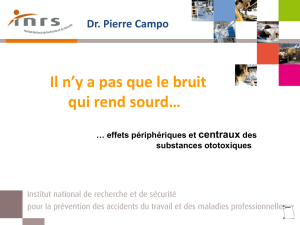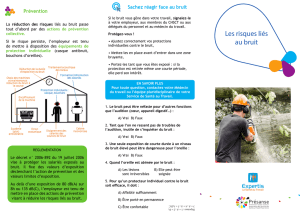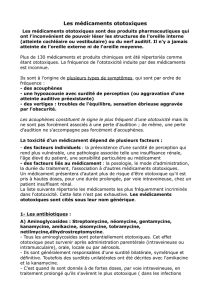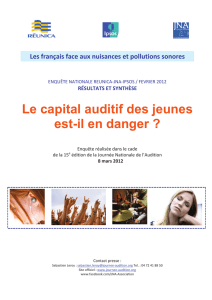Bruit et agents ototoxiques

Si le bruit reste la nuisance la plus
nocive pour l'audition, certains
agents toxiques professionnels
comme les solvants aromatiques,
le monoxyde de carbone et l’acide
cyanhydrique, ou extra-
professionnels comme
les antibiotiques, les diurétiques,
les salicylates et les anti-tumoraux,
peuvent fragiliser l’oreille interne
des salariés. Or, les limites
réglementaires à l’exposition
au bruit ont été établies pour des
sujets sains ne présentant pas de
fragilité de l’oreille interne. Une
oreille envahie par un agent
ototoxique, ou une oreille
vieillissante, pourrait se révéler plus
vulnérable à une agression sonore
qu'une oreille exposée uniquement
au bruit. La question de la
pertinence des limites d’exposition
au bruit, ou des valeurs limites
moyennes d’exposition à des agents
ototoxiques lorsque des personnes
sont exposées à plusieurs nuisances
reste donc posée. Pour cette raison,
la réglementation devrait prendre
en considération les résultats
scientifiques récents pour protéger
l’audition des personnes exposées
à des multinuisances.
ED 5028 février 2005
En 1997, l’enquête SUMER 94 a montré que
plus de 3 millions de salariés étaient encore
exposés à des nuisances sonores pouvant
entraîner des surdités professionnelles,
malgré une réglementation française et
européenne [cf. infra Réglementation].
Rappelons que lorsque la protection
collective ne permet pas de réduire
suffisamment le niveau de bruit, une
protection individuelle doit être mise à
disposition des personnes exposées
pendant 8 heures à plus de 85 dB(A), ou à
plus de 135 dB « crête ». Les dernières
statistiques indiquent pourtant que 613 et
494 surdités ont été respectivement
reconnues en 2000 et 2001 au titre du
tableau n°42 du régime général des
maladies professionnelles. S’il est clair que
le bruit demeure le facteur professionnel le
plus nocif pour l’audition, certaines
substances chimiques peuvent également
provoquer des surdités en agissant
directement sur l’organe sensoriel de
l’audition, la cochlée (Fig. 1 page suivante),
ou en potentialisant les effets du bruit. Ces
agents chimiques toxiques peuvent avoir
une origine professionnelle, comme des
solvants aromatiques ou chlorés, ou extra-
professionnelle, comme des antibiotiques,
des diurétiques, des anti-tumoraux ou de
l'acide acétylsalicylique, pour ne citer que les
principaux. Les risques de surdité encourus
par des personnes exposées à des agents
ototoxiques (agents toxiques pour
l’audition) autres que le bruit, mais aussi la
potentialisation éventuelle de ces toxiques
sur les effets du bruit seront évoqués, en
fonction des différents agents que l’on peut
trouver sur le lieu de travail.
LE POINT DES CONNAISSANCES SUR...
Bruit et agents ototoxiques
Une protection individuelle contre
le bruit et un suivi audiométrique
doivent permettre de protéger
l’audition des salariés exposés
à des ambiances professionnelles
multifactorielles.

2Point des connaissances ED 5028
RISQUES
POUR L’HOMME
1. Les agents otoxiques
professionnels
1.1. Solvants aromatiques
Les solvants aromatiques comptent parmi
les produits chimiques les plus utilisés dans
l'industrie. Que ce soit le toluène, qui entre
dans la composition de peintures, vernis,
encres et agents dégraissants, le styrène,
limité essentiellement au processus de
fabrication des résines renforcées à la fibre
de verre, sans oublier le xylène et l'éthylben-
zène, tous ces solvants organiques sont très
volatils et peuvent être toxiques pour les
salariés qui les inhalent. En France, plus de
520 000 personnes travaillent dans des
industries produisant et/ou utilisant des
résines polyester, et au moins 30 000 pro-
fessionnels sont directement exposés au
styrène auxquels on se doit d'ajouter les
populations exposées au toluène, au xylène
et à l'éthylbenzène. De nombreuses études
épidémiologiques ont déjà souligné le
caractère ototoxique de ces solvants aroma-
tiques. Cependant, la difficulté majeure est
de distinguer la surdité induite par les sol-
vants, de celle induite par d'autres facteurs
confondants comme le bruit par exemple.
L'audiométrie tonale, seule technique utili-
sée pour diagnostiquer une surdité, ne per-
met pas de dissocier le traumatisme chi-
mique du traumatisme acoustique, tous
deux se manifestant par une diminution de
la sensibilité auditive au voisinage des 4-6
kHz, encore appelée scotome auditif. Ce
moyen d'investigation ne fournit donc pas
de signature audiométrique permettant
d'affirmer que la surdité diagnostiquée est
due à une intoxication par les solvants
(Fig. 1), et pas seulement à l'exposition au
bruit. Ceci explique sans doute pourquoi
aujourd'hui, seul le bruit est considéré
comme agent responsable de la surdité pro-
fessionnelle et fait l'objet de prévention puis
d'indemnisation lorsque « le mal est fait ».
En prévention, le nouveau défi à relever
serait d'utiliser des outils capables d'identi-
fier la nature du dommage cochléaire et par
là-même, la nature d’agents ototoxiques
insoupçonnés jusqu’à aujourd’hui. Une fois
identifiés et reconnus, ces agents oto-
toxiques pourraient alors faire l'objet d'une
véritable politique de prévention. Le modèle
animal a fourni des informations précieuses
concernant le pouvoir ototoxique de sol-
vants aromatiques. En outre, il a permis
l'identification des tissus cochléaires les plus
sensibles aux solvants : les cellules ciliées
externes (CCEs) se sont révélées les plus vul-
nérables (Fig. 1). Il a permis aussi de distin-
guer les traumatismes cochléaires induits
par les solvants de ceux provoqués par le
bruit.
Le bruit endommage mécaniquement les
stéréocils implantés au sommet des cellules
ciliées externes (CCEs) et internes (CCIs),
tandis que les solvants empoisonnent les
CCEs par leur base en préservant les CCIs.
Ces caractéristiques histopathologiques
entre les effets de solvants et ceux du bruit
offrent des pistes prometteuses pour amé-
liorer la prévention. En effet, la recherche de
l'outil de diagnostic des souffrances
cochléaires engendrées par les solvants doit
s'inspirer de la connaissance des méca-
nismes ototoxiques.
Si l'audiométrie tonale reste un outil perfor-
mant pour diagnostiquer une surdité glo-
bale et centrale, il n'est certes pas le plus
adapté pour déceler un empoisonnement
du récepteur auditif périphérique, et plus
spécifiquement des CCEs qui sont capables
de vibrer. Lorsque la physiologie générale de
la cochlée est quelque peu perturbée, ces
cellules constituent en fait le générateur
d’oto-émissions. En provoquant les oto-
émissions et en les mesurant chez des
sujets exposés aux solvants, il serait sans
doute possible de mesurer la souffrance des
CCEs induite par l'intoxication aux solvants.
Les produits de distorsion acoustique (2f1-f2),
déjà utilisés en clinique, seraient sans doute
un outil précieux dans la surveillance de
l'audition des personnes exposées. Par
ailleurs,l'empoisonnement des CCEs par des
solvants laisse présumer une fatigabilité
accrue et donc une diminution des perfor-
mances dans le traitement des informa-
tions auditives par le nerf auditif. L'enregis-
trement des potentiels auditifs engendrés
par des bouffées de stimulations acous-
tiques de plus en plus rapprochées (rythme
croissant de stimulation) pourrait égale-
ment constituer un test de fatigabilité.
Pour achever cette réflexion sur les effets
ototoxiques de solvants, on ne peut passer
sous silence les effets d'exposition combinée
au bruit et aux solvants. Cette fois encore,
l'expérimentation animale et des études épi-
démiologiques chez l’homme ont montré
qu'il existe un risque réel de potentialisation
des effets du bruit par les solvants.
1.2. Monoxyde de carbone
et acide cyanhydrique
Le monoxyde de carbone [CO] et l’acide
cyanhydrique [HCN] comptent parmi les gaz
les plus dangereux en milieu professionnel.
Il est apparu récemment chez le rat que, si
CO et HCN n’engendrent aucune perte audi-
tive par eux-mêmes, ils peuvent néanmoins
potentialiser les effets du bruit. Par ailleurs,
il a été montré qu’une exposition sonore
non traumatisante peut le devenir lorsque
du CO ou de l’HCN est présent simultané-
ment à l’exposition au bruit. Les risques
inhérents aux expositions combinées au
bruit et au CO ou HCN doivent donc faire
l’objet d’une attention particulière et d’une
surveillance audiométrique régulière.
Comme pour les autres agents ototoxiques
déclinés ci-dessus, se pose alors la question
de la pertinence des limites d'exposition
lorsque les personnes sont en exposition
multifactorielle.
2. Les agents ototoxiques
extra-professionnels
2.1. Antibiotiques
Parmi les différentes classes d'antibiotiques,
seuls les aminoglycosidiques (AA), antibio-
tiques à large spectre, seront évoqués en rai-
son de leur ototoxicité. Depuis l'arrivée des
céphalosporines,l'utilisation des AA a baissé
bien que leur recours s'avère encore néces-
saire dans bien des pathologies, surtout
lorsqu’une résistance aux micro-organismes
est constatée. Les plus largement utilisés à
des fins thérapeutiques sont énumérés
dans le tableau ci-dessous.
Figure 1.
Organe de Corti
témoin.
Organe de Corti
endommagé
par un solvant.
Cochlée : récepteur
auditif périphérique.
Antibiotique Utilisation thérapeutique
Amikacine infection nosocomiale
Gentamicine pneumonie, méningite
Tobramycine associé avec gentamicine
Kanamycine tuberculose si résistance
Néomycine infection de peau et muqueuse
Streptomycine endocardite, tuberculose

ED 5028 Point des connaissances 3
L'ototoxicité des AA se traduit par des
pertes auditives aux fréquences élevées
(sons aigus) se propageant ensuite vers les
basses fréquences (sons graves) en fonc-
tion de la durée du traitement. C'est sur-
tout l'organe de Corti (Fig. 1) qui est lésé, les
CCEs du premier rang disparaissent les pre-
mières, suivies par celles du second rang,
puis par celles du troisième rang. Les AA
pénètrent dans les liquides de l'oreille
interne (OI) en traversant la barrière
hémato-labyrinthique. Si l'élimination des
AA ne nécessite guère que 8 heures, elle est
plus longue dans les liquides de l’OI. Chez le
rat, par exemple, l’AA peut persister 15 jours.
Par ailleurs, les recherches sur animaux ont
montré que les AA peuvent s’accumuler
dans les cellules ciliées jusqu’à en devenir
toxiques. Les AA sont donc des agents
potentiellement ototoxiques.
Bien entendu, les risques pour l’audition
encourus par les personnes sous traite-
ment sont pris en considération par le
médecin ; il s'agit bien souvent du seul
choix possible compte tenu des patholo-
gies développées par les patients. La perti-
nence du choix de tel ou tel AA ne sera donc
pas discutée ici, nous soulignerons plutôt
les risques encourus par les personnes qui,
au terme de leur convalescence, reprennent
leur travail. En effet, des études chez le
cobaye ont montré qu'il existe une synergie
entre les effets ototoxiques des AA et ceux
du bruit. Fort de ces données expérimen-
tales, il convient d’informer le personnel
ayant subi un traitement des risques
encourus, ou de le protéger (protecteurs
individuels contre le bruit, pauses sous-
trayant au bruit, suivi audiométrique) des
ambiances sonores limites par rapport à
celles recommandées à ce jour par la légis-
lation : 85dB(A) pour 8 heures de travail.
2.2. Diurétiques
Le furosémide, l'acide éthacrynique, le
bumétanide sont trois diurétiques connus
pour leurs effets ototoxiques regrettables
mais temporaires. Trois caractéristiques
essentielles permettent de distinguer l'oto-
toxicité de ces diurétiques de celle des AA :
1 ■la surdité apparaît quelques minutes
seulement après l'administration ou l'inges-
tion du diurétique ;
2 ■à la différence de celle induite par les
AA, la surdité régresse parallèlement à l’éli-
mination des diurétiques et cesse à la dispa-
rition totale du produit ;
3 ■l'ototoxicité des diurétiques n'inté-
resse que la cochlée (Fig. 1); le vestibule
(récepteur neurosensoriel de l’équilibre)
semble être préservé de l'action toxique du
diurétique.
Les diurétiques perturbent les équilibres
ioniques existant entre le sang et les
liquides de l’OI, entraînant ainsi une baisse
de l’acuité auditive. Les personnes sous trai-
La Réglementation
Actions requises selon les niveaux sonores
■
Réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible, compte tenu de l’état des techniques.
■
Maintenir l’exposition sonore à un niveau compatible avec la santé des travailleurs.
■
Établir et mettre en œuvre un programme de mesures techniques et d’organisation du travail afin de
réduire l’exposition sonore ; le présenter au CHSCT dans le programme annuel de prévention des risques
professionnels.
■
Estimer l’exposition sonore des travailleurs et identifier tous les travailleurs exposés.
■
Prévoir le mesurage de l’exposition dans un document soumis pour avis au CHSCT.
■
Mesurer les niveaux d’exposition sonore.
■
Tenir les résultats du mesurage à disposition des travailleurs exposés, du médecin du travail, du CHSCT.
■
Informer et former les travailleurs sur les risques dus à l’exposition sonore et sur les moyens pris pour
les prévenir.
■
Organiser la surveillance médicale incluant le contrôle audiométrique des travailleurs.
■
Fournir des protecteurs individuels aux travailleurs.
■
Prendre toutes les dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés.
■
Signaler les lieux de travail bruyants.
EXPOSITION DES SALARIÉS
AU BRUIT
Directive 2003/10/CE du parle-
ment européen et du conseil du
6 février 2003.
La réglementation française
concernant l’exposition des
salariés au bruit est issue de
deux directives européennes : la
directive 86/188/CEE du 12 mai
1986 et la directive 89/392/CEE
du 14 juin 1989. Si la première
concerne la protection des tra-
vailleurs contre les risques dus à
l’exposition au bruit, la seconde
concerne les machines et spéci-
fie les exigences à respecter,
notamment en matière de bruit
émis. La réduction des risques
auditifs dus au bruit s’impose
donc non plus seulement aux
employeurs, mais aussi aux
constructeurs de machines ou
d’équipements industriels et
aux concepteurs des locaux de
travail.
La réglementation s’appuie
essentiellement sur deux indi-
cateurs de niveau de risque :
a) le niveau d’exposition sonore
quotidien ou niveau moyen de
bruit (85 dB(A)) auxquels est
exposé un travailleur durant sa
journée de travail (8 heures) ;
b) le niveau de pression acous-
tique de crête qui correspond à
l’intensité maximale, exprimée
en dB, qui ne doit pas être
dépassée sans porter un protec-
teur auditif (135 dB).
En cas de dépassement d’un des
deux niveaux de risque, les dis-
positions précisées dans le
tableau ci-dessous, sont appli-
cables.
TABLEAU DE MALADIE PROFESSIONNELLE
Le tableau 42 du régime général, publié au JO le 28-09-2003, régit les atteintes auditives provoquées par
des bruits lésionnels. Il ne prend en compte que les effets auditifs dus au bruit au cours d'une période
n'excédant pas une année après cessation de l'exposition au bruit professionnel.
tement doivent donc être informées des
risques encourus. De plus, des études expé-
rimentales et des cas cliniques montrent
qu'il existe une synergie entre les effets oto-
toxiques des antibiotiques et ceux des diu-
rétiques. Par ailleurs, une récente étude
révèle la potentialisation des effets oto-
toxiques de certains métaux lourds, comme
le cadmium, par le furosémide. La prescrip-
tion de diurétiques devra donc s’accompa-
gner d’une information non seulement sur
les risques d’hypoacousie contemporains à
la prise du médicament, mais aussi sur les
risques encourus par une prise combinée de
diurétiques avec d’autres médicaments oto-
toxiques.
Comme évoqué précédemment avec les AA,
il conviendra d’apporter une protection par-
ticulière au personnel sous traitement, sur-
tout lorsque les salariés sont soumis à des
ambiances sonores limites par rapport à
celles recommandées par la législation.
2.3. Salicylates
L'acide acétylsalicylique, ou aspirine, est le
médicament le plus couramment
consommé dans les sociétés industrielles
modernes. Si les effets analgésiques, anti-
inflammatoires ou anti-pyrétiques sont les
plus souvent recherchés, certaines per-
sonnes souffrant de maladies cardio-vascu-
laires peuvent également en consommer
pour accentuer la fluidité sanguine. Un
niveau sérique de 10-15 mg pour 100 mL cor-
respond à la dose généralement prise pour
calmer une migraine, un mal de dent, une
fièvre ; il correspond également au traite-
ment préventif des angines de poitrine. À de
telles concentrations, des déficits auditifs
partiels et temporaires peuvent survenir.

Certaines personnes ne s'aperçoivent même
pas de l’hypoacousie dont elles souffrent.
Lorsque la concentration sérique d’acide
acétylsalicylique atteint 19,6 mg pour
100 mL, la majeure partie des sujets ayant
une audition « normale » avant la prise d’as-
pirine, se plaint alors d'un sifflement de
l'oreille ou acouphène. Comme les diuré-
tiques, l'aspirine agit en modifiant les équi-
libres ioniques entre le sang et les liquides
de l’OI. Elle modifie le comportement des
cellules ciliées externes provoquant ainsi
une hypoacousie et des acouphènes. La
question de la potentialisation des effets du
bruit et de l'aspirine reste débattue à ce jour.
Quoi qu'il en soit, les salicylates peuvent être
à l’origine d’hypoacousies temporaires et,
pour des raisons déjà évoquées précédem-
ment, les acteurs de la prévention se doivent
d'informer les personnes exposées au bruit,
chacune d'entre elles étant un consomma-
teur potentiel d'aspirine.
2.4. Anti-tumoraux
Le cisplatine ou le carboplatine sont des
anticancéreux très employés en chimiothé-
rapie. Leur utilisation est susceptible de
modifier la composition électrochimique
des liquides de l’OI et de détruire des cellules
ciliées. Ils sont donc ototoxiques. Quant aux
effets conjugués du bruit et des anti-tumo-
raux, un risque accru de déficit auditif à l’ex-
position au bruit a été mis en évidence chez
l’animal. Il est donc fondamental d’avertir
les salariés concernés par ce type de traite-
ment des risques encourus par une exposi-
tion sonore, même de faible intensité et, le
cas échéant, de les en protéger.
COMMENT PROTEGER
LES HOMMES ?
Surveillance audiométrique
Une protection individuelle contre le bruit et
un suivi audiométrique des individus sou-
mis à des ambiances sonores dont le niveau
est proche de celui recommandé par la légis-
lation sont autant de pistes à explorer pour
protéger l’audition des salariés exposés à
des ambiances professionnelles multifacto-
rielles. Des outils audiométriques récents,
comme les produits de distorsion (2f1-f2),
sont plus sensibles aux agressions des cel-
lules ciliées externes que ne l’est l’audiomé-
trie tonale classique. Un tel outil pourrait
fournir la possibilité de découvrir des indices
précoces de souffrance cochléaire ou, dans
une hypothèse moins heureuse, d'identifier
des agents ototoxiques autres que le bruit.
Une fois identifiés et reconnus, ces agents
ototoxiques pourraient alors faire l'objet
d'une véritable politique de prévention.
Formation
Une formation des acteurs de la prévention
à l’usage des produits de distorsion serait
indiscutablement un atout supplémentaire
dans le dépistage de surdité induite par des
agents ototoxiques.
Information
Il conviendra d’informer et de surveiller les
personnes convalescentes (retour d’hospita-
lisation par exemple), d’insister sur la vigi-
lance particulière à apporter vis-à-vis des
signaux sonores d'avertissement pour les
salariés prenant occasionnellement des diu-
rétiques ou de l’aspirine.
Mesures d’ordre réglementaire
Les limites réglementaires à l’exposition au
bruit ont été établies pour des sujets sains
ne présentant pas de fragilité cochléaire. Or,
une oreille interne envahie par un agent
ototoxique, ou vieillissante, pourrait se révé-
ler plus vulnérable à une agression sonore
qu'une oreille exposée uniquement au
bruit. La question de la pertinence des
limites d’exposition au bruit, ou des Valeurs
limites de Moyennes d’Exposition à des
agents ototoxiques lorsque des personnes
sont exposées à plusieurs nuisances reste
donc posée [VME est exprimée en cm3/m3
(ppm) et en mg/m3. Elle vise à protéger les
travailleurs contre des effets résultant d'une
exposition prolongée, exposition au cours
d'un poste de huit heures. Ces valeurs sont
utilisées en France dans le cadre de la protec-
tion de la santé et de la sécurité des tra-
vailleurs contre les risques liés à une exposi-
tion à des agents chimiques sur le lieu de
travail]. Pour cette raison, les législateurs
devraient prendre en considération les
résultats scientifiques récents pour renfor-
cer la protection de l’audition des personnes
exposées à des multinuisances.
■Effets des salicylates sur le système auditif :
revue bibliographique. Cahiers de Notes Docu-
mentaires. 1991, 142 , pp. 79-86.
■Réduire le bruit dans l’entreprise. 1997, ED 808,
94 pages.
■Comment explorer l’ototoxicité des solvants
dans le cadre d’études épidémiologiques en
milieu professionnel. Notes scientifiques et tech-
niques. 2001, NS 202, 34 pages.
Articles parus dans Documents pour le médecin
du travail
■Audition : l'amplificateur cochléaire.
Documents pour le médecin du travail. 1992, 49,
pp. 15-22.
■SUMER 94. Documents pour le médecin du tra-
vail. 1997, 69 , pp. 63-70.
■Agents ototoxiques et exposition au bruit.
Documents pour le médecin du travail. 2001, 86,
pp. 177-182.
LES PUBLICATIONS DE L’INRS
Au sein du projet Européen Noisechem (de
2000 à début 2004), l’INRS a étudié les effets
ototoxiques des solvants aromatiques notam-
ment du styrène et du toluène, seuls et en
association avec du bruit. Des risques induits
par la synergie entre bruit et agents oto-
toxiques ont été mis en évidence.
Le vieillissement comme facteur de fragilisa-
tion de l’oreille interne a également été étu-
dié.
http://europa.eu.int/comm/research/quality-
of-life/ka4/ka4_noise_en.html
TRAVAUX DE L’INRS ET SES PARTENAIRES
Auteurs
: Pierre Campo avec Graziella Dornier •
Coordination
: Martine Puzin •
Contacts
•
Secrétariat de rédaction
: Christine Larcher •
Photographie
: Philippe Renault.
Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
30, rue Olivier-Noyer 75680 Paris cedex 14 •Tél. 01 40 44 30 00 •Fax 01 40 44 30 99 •Internet : www.inrs.fr •e-mail : [email protected]
paru dans Travail et Sécurité n°648, février 2005 © INRS
Point des connaissances ED 5028
1
/
4
100%