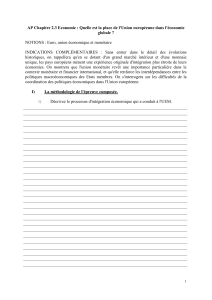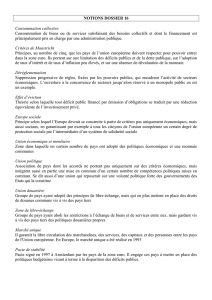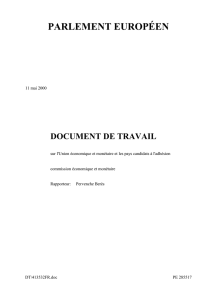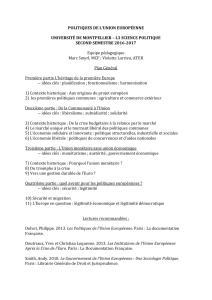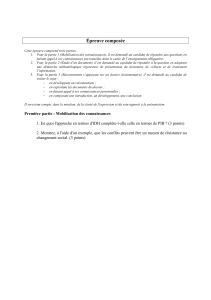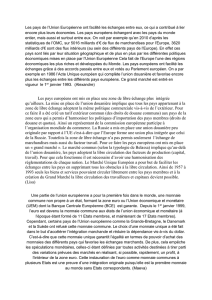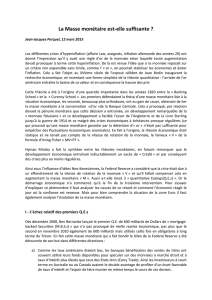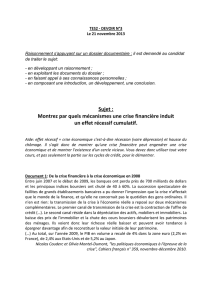un espace économique sans frontière

ESH ECE2 Camille Vernet
Nicolas Danglade 2016-2017
1
Module 3 La mondialisation économique et financière
Partie 3. L’intégration européenne
Chapitre 2. L’Europe économique et monétaire
1. La construction d’une Europe sans frontières intérieures : le projet de marché unique et ses
conséquences
1.1 Du traité de Rome à l’Acte unique
1.1.1 Le Traité de Rome : de l’Union douanière à l’eurosclérose
Document 1
Le Traité de Rome (1957) se fixe comme objectif la création d’un marché commun permettant les échanges sans
entraves de biens & services, de personnes et de capitaux.
Cette réalisation passe tout d’abord par l’élimination des droits de douanes et des quotas existants ainsi que par le
rapprochement des tarifs extérieurs douaniers. L’Union douanière est ainsi achevée le 01 juillet 1968.
Sur la décennie 1970, le projet de marché commun progresse peu. Il y a certes l’élargissement de la CEE au
Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark, mais l’utilisation par les Etats-membres de barrières non tarifaires
persiste. C’est le cas avec les normes techniques ou les aides aux « champions nationaux ». Les contrôles
frontaliers des biens et des personnes toujours présents, les marchés de capitaux restent cloisonnés. L’hétérogénéité
des réglementations professionnelles empêche l’exercice de certaines activités de services d’un pays à l’autre. Les
personnes, à la différence des travailleurs, ne peuvent toujours pas circuler librement dans l’espace européen.
Finalement, l’Europe des 6 reste encore un espace économique fragmenté où les frontières comptent. Cette
fragmentation alimente la situation d’ « eurosclérose » du début des années 1980.
1.1.2 L’Acte unique (1986) et la finalisation du marché commun
Document 2 : la mise en œuvre des quatre libertés
Les quatre libertés sont :
La liberté de circulation des marchandises et des services ;
La liberté d’établissement et la liberté de prestation ;
La liberté de circulation des personnes ;
La liberté de circulation des capitaux.
Le premier instrument sur lequel cette libéralisation des échanges va s’opérer est le principe de reconnaissance
mutuelle des législations nationales. Ce principe découle d’un arrêt de la Cour de justice rendu en 1979, l’arrêt
« Cassis de Dijon » : si la fabrication d’un produit respecte la législation nationale d’un pays membre, ce produit
doit être admis sur les marchés des autres pays de la CEE. Cet arrêt sert de base au travail entrepris par la
Commission pour réduire les pratiques protectionnistes des Etats membres et permettre la circulation des biens sans
uniformisation préalable des normes nationales. Il va également servir à partir de l’Acte unique pour faciliter les
échanges de services financiers (Banques, Bourses, Finances).
La Commission obtient que les décisions du Conseil des ministres concernant les normes soient prises à la majorité
qualifiée et non plus à l’unanimité. Ce qui agit comme un frein aux comportements protectionnistes.
A partir de 1988, la Commission lance une politique de déréglementation et de libéralisation dans les industries de
réseaux : les transports, les télécommunications, la distribution postale et l’énergie. Cette politique se traduit en
France par la disparition des monopoles légaux et la privatisation progressive des entreprises publiques.
Les marchés financiers sont déréglementés et décloisonnés et le 1er janvier 1990, la liberté de circulation des
capitaux est totale.
La liberté de circulation des personnes est réalisée le 1er janvier 1993.
Enfin en 2006, la directive Service (connue également sous le nom de directive Bolkestein) est adoptée par l’UE.
Son objectif : permettre à une entreprise installée dans un pays de détacher ses salariés dans un autre pays. Cette
directive connaît une seconde version en 2013 afin de limiter les risques de dumping social. Il y a en France en
2016 environ 300 000 salariés détachés.

ESH ECE2 Camille Vernet
Nicolas Danglade 2016-2017
2
Document 3 : la suppression des contrôles douaniers des biens et des personnes
Les contrôles frontaliers sont considérablement allégés à partir de 1993. Les contrôles administratifs relatifs au
passage de marchandises sont abandonnés et remplacés par un système coordonné au niveau européen et un code
douanier commun de l’UE. C’est un gain de temps appréciable, car en moyenne 50% des marchandises échangées
au sein de la CEE franchissaient au moins deux frontières. Avec la création de l’espace Schengen en 1993, les
contrôles automatiques de passeport sont supprimés au sein des Etats membres ayant signé la Convention de
Schengen et les restrictions aux permis de résidence sont supprimés pour permettre la libre circulation des
travailleurs. Source : J.C.Defraigne « Introduction à l’économie européenne », De Boeck, 2014, p.123
Document 4 : la diminution des barrières techniques
Dès la fin des années 1970, les institutions communautaires s’attaquent aux barrières techniques au commerce qui
ont jusqu’alors fragmenté le Marché commun. En 1979, la cour européenne de Justice rend l’arrêt dit « Cassis de
Dijon ». (…) La cour affirme que si la fabrication et la commercialisation d’un produit respectent la législation
nationale du producteur, ce produit doit être admis sur les autres marchés des Etats membres de la CEE. (…) La
Commission s’appuie ensuite sur cet arrêt pour faire consacrer de manière décisive le principe de reconnaissance
mutuelle des normes nationales des différents Etats membres. ce n’est pas encore une harmonisation européenne
des normes techniques et sanitaires mais cela signifie que les Etats ont moins de marge de manœuvre pour créer des
barrières techniques au commerce. (…) La Commission arrive aussi à développer une harmonisation technique
européenne dans certaines nouvelles technologies. On assiste ainsi à la création d’institutions européennes qui
peuvent émettre des normes techniques européennes (…). Une dernière avancée majeure contre les barrières
techniques est réalisée par la ratification de l’Acte unique, qui prévoit que l’unanimité ne soit plus requise pour les
décisions du Conseil relatives à l’harmonisation européenne réglementaire et technique. Une simple majorité est
désormais suffisante. Source : J.C.Defraigne « Introduction à l’économie européenne », De Boeck, 2014, p.124
Document 5 : la déréglementation des activités de réseau
Avant le marché unique certains secteurs, essentiellement de services n’étaient pas concernés par les quatre libertés
économiques inscrites dans le traité de Rome et avaient donc conservé une dimension locale. Les activités
concernées relevaient fréquemment de monopoles assurant un service public. L’article du traité de Rome
interdisant les situations de position dominante avait du reste prévu une exception pour ces entreprises. (…) La
Commission a lancé à partir de 1988 une politique de déréglementation-libéralisation, notamment dans les
transports, les télécommunications,la distribution d’énergie et la distribution postale. Lorsque dans une industrie les
rendements sont croissants, il est souhaitable qu’une entreprise fournisse la totalité du marché. Dans les industries
de réseau, ces coûts fixes sont particulièrement élevés en comparaison des coûts variables. (…) Plus l’entreprise
produit, plus le coût moyen diminue. (…) Dans la plupart des cas, les monopoles publics étaient intégrés
verticalement, assurant à la fois la production et la distribution. Les directives européennes conduisent à redéfinir
leur périmètre en séparant les deux fonctions. (…) Ainsi, on peut partager les chemins de fer entre la construction-
entretien des voies et la circulation des convois. (…) L’objectif est de permettre la circulation de trains appartenant
à plusieurs compagnies concurrentes.
Source : ss la direction de M.Dévoluy et G.Keonig « Les politiques économiques européennes », Points Economie, 2015, p.236
Document 6 : la directive Service 2006-2013
La directive service englobe des activités de services non concernées par le processus d’ouverture à la concurrence
des activités de réseau (télécom, Poste, transport ferroviaire …), n’ayant pas déjà fait l’objet de directives
spécifiques (banques, assurances, …) ou celles n’étant pas expressément exclues (santé, sécurité sociale, …). Sont
notamment inclus dans cette directive : les services aux entreprises tels que le conseil en management et gestion,
les services de certification et d’essai, de maintenance, d’entretien des bureaux, les services de publicité, les
services au recrutement et les services des agents commerciaux. Les services fournis à la fois aux entreprises et aux
consommateurs comme les services liés à l’immobilier, à la construction (les architectes notamment), au secteur de
la distribution, l’organisation des foires et salons commerciaux, la location de voitures et les agences de voyages.
Les services aux consommateurs comme le tourisme, les services de loisir, les centres sportifs et les parcs
d’attraction.
Document 7 : les problèmes posés par la libre circulation des services
Les services représentent environ 70% de la valeur ajoutée communautaire (…). Les services étant difficilement
exportables, la liberté de circulation, qui prend ici la forme de la liberté de prestation, doit être complétée par celle

ESH ECE2 Camille Vernet
Nicolas Danglade 2016-2017
3
de l’installation. En effet, la possibilité de produire sur place se substitue souvent à la vente à distance. Le principe
de reconnaissance mutuelle conduit alors à admettre toute prestation conforme à la réglementation du pays
d’origine. Comme ce pays pourrait aboutir à un alignement des exigences réglementaires sur celles qui sont les
moins contraignantes, il peut être tempéré par une réglementation minimale de l’UE. Lorsque la vente se fait à
distance, ou lorsque le siège social du vendeur est situé à l’étranger, il convient de déterminer les règles qui doivent
s’appliquer pour garantir au consommateur le respect des engagements pris par les entreprises.
Source : ss la direction de M.Dévoluy et G.Keonig « Les politiques économiques européennes », Points Economie, 2015, p.41
Document 8 : un marché unique qui s’élargit
La décennie 1990 est une période d’intensification du processus de libéralisation des marchés nationaux. Cette
intégration se fait dans un contexte d’élargissement de l’UE qui passe à 15 membres en 1995. L’UE décide
également d’intégrer au marché commun les membres de l’AELE (Accord européen de libre-échange, 1960) qui ne
sont pas membres de la CEE. La Norvège, l’Islande, le Liechtenstein forment avec l’UE, l’Espace économique
européen (EEE) qui est créé en 1994. Ils participent au marché intérieur européen, à l’exclusion de l’agriculture et
de la pêche. La Suisse qui refuse de rejoindre l’EEE, signe des accords bilatéraux avec l’UE. A la fin des années
1990, le marché commun concerne tous les pays de l’Ouest du Continent européen. A partir de 2003,
l’élargissement de la taille du marché commun se poursuit vers les pays d’Europe centrale et orientale. L’UE passe
de 15 à 28 pays membres entre 1995 et 2013.
Document 9 : les gains attendus du passage au marché unique
Document 10 : une meilleure allocation des ressources
Le marché intérieur vise d'abord à l'établissement d'un vaste espace commercial, sans frontières intérieures, au sein
duquel la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes est assurée. Du point de
vue de la théorie économique, il existe deux principaux arguments qui plaident pour une suppression des barrières
aux échanges. Premièrement, l'effet commerce, avec la réduction des barrières tarifaires et non tarifaires, générerait
une augmentation de la demande adressée au secteur exportateur, des gains d'efficience et, par conséquent, un
accroissement du revenu disponible. Deuxièmement, l’effet pro-concurrentiel, du fait de l’ouverture des marchés,
conduirait à des baisses de prix favorables aux consommateurs.
Ces deux effets seraient source de gains d’efficience. En effet, selon la théorie des avantages comparatifs,
l’accroissement des échanges commerciaux conduit à la spécialisation des économies dans les activités où elles
sont relativement les plus productives, ce qui a un impact positif sur l’activité et l’emploi. De plus, la hausse de la
concurrence pourrait générer une réduction des rentes de monopole et inciter les entreprises à faire des gains de
productivité et à innover pour se maintenir sur le marché ou pour limiter leur perte de marges.
Source : Trésor-Eco n°156, octobre 2015
Gains d’efficience : avec la même quantité de facteurs,
l’économie produit davantage et pour un prix moins élevé
Baisse coûts de transaction
Hausse de la
concurrence
Effet de rationalisation
Baisse des prix
Hausse de la demande
Choix de localisation
Eco. d’échelle /
innovation
Diversification offre
DIPP
Recul des contrôles
administratifs

ESH ECE2 Camille Vernet
Nicolas Danglade 2016-2017
4
Document 11: les gains tirés de la circulation des capitaux
Les gains d’efficience attendus ne concernent pas que le système productif, le système financier aussi est concerné.
En relâchant la contrainte de financement des économies fermées, la constitution d’un marché des capitaux
européen permet une meilleure allocation de l’épargne des agents à capacité de financement et une baisse du coût
d’accès au financement pour les agents à besoin de financement.
1.2 Les conséquences de l’instauration du marché unique sur l’intégration des économiques et
la croissance économique
1.2.1 L’impact sur les échanges communautaires et l’intégration des économies
Document 12 : évolution des échanges commerciaux intra-communautaires en % du PIB
Source : Trésor-Eco n°156, octobre 2015
Document 13 : une intégration économique qui progresse
Jörg König et Ohr Renate ont construit un indicateur agrégé d'intégration économique entre les pays en utilisant des
données sur le commerce intra-communautaire et sur la situation macro-économique. On observe ainsi que
l'intégration économique a progressé dans la quasi-totalité des pays de l'UE à 15 entre 1999 et 2010 (sauf Espagne),
et qu’elle a progressé aussi bien dans des pays déjà très intégrés (Belgique) que dans des pays qui l’étaient moins
(Danemark).
Source : Trésor-Eco n°156, octobre 2015

ESH ECE2 Camille Vernet
Nicolas Danglade 2016-2017
5
Document 14 : essor de l’échange intra-branche (en % des échanges manufacturiers totaux)
1970
1980
1990
2000
Allemagne
70
75
79
82
Belgique
77
86
83
90
Espagne
43
69
75
82
France
53
65
79
91
Italie
70
61
67
71
Source : OCDE
Document 15 : l’importance des échanges intrazone (en % du total des échanges)
Document 16 : la convergence des prix, un indicateur d’intégration des économies
Dernier indicateur d’intégration des marchés : la convergence des prix. Dans l’UE à 15 sur la période 1995-2010,
on observe que le coefficient de variation des niveaux des prix relatifs a baissé de 16% à 12%. Ce qui va dans le
sens d’un prix unique.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
1
/
40
100%