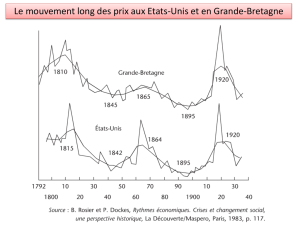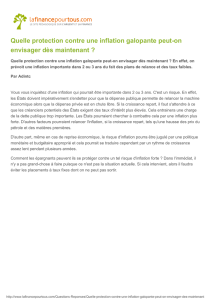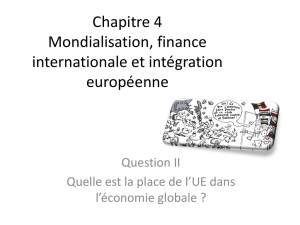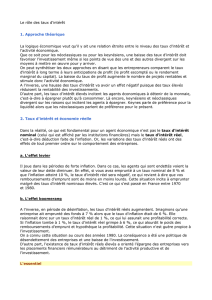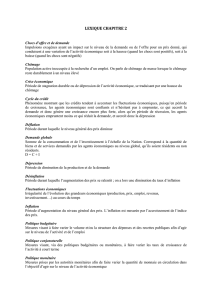Document Définitif Différentiel d`inflation UMOA

Un Peuple - Un But – Une Foi
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION DE LA PREVISION ET DES
ETUDES ECONOMIQUES
Document d’Etude N°17
Différentiel d’Inflation dans une Union
Monétaire : le cas de l’UMOA
DPEE/DEPE @ Août 2010

1
DIFFERENTIEL D’INFLATION DANS UNE UNION MONETAIRE :
LE CAS DE L’UMOA
Mouhamadou Bamba DIOP
1
Kalidou THIAW
1
Août 2010
Résumé
Cette étude a pour principal objectif d’apprécier le processus de convergence des taux
d’inflation et d’identifier les principales sources de fluctuations du différentiel d’inflation au
sein de l’UMOA. Les conclusions résultant des différentes approches utilisées suggèrent que,
depuis 2000, des taux d’inflation au sein de l’Union sont plutôt entrés dans un processus de
divergence croissante. De plus, le modèle d’équilibre général stochastique bayésien mis en
œuvre permet d’affirmer que l’origine du différentiel d’inflation est principalement le fait des
chocs asymétriques, mettant également en évidence les différences économiques structurelles
des pays membres de l’UMOA. En effet, plus de 66% de la variabilité du différentiel
d’inflation sont expliqués par ces chocs.
Classification JEL: C11, O47, E63
Mots clés: Modèles DSGE bayésien, β-convergence, σ-convergence, Union monétaire.
Abstract
The main goal of this paper is to appreciate the convergence process of inflation rates and
identify the most important sources of the inflation differential fluctuations within the West
African Monetary Union (WAMU). The conclusions resulting from various approaches
suggest that, since 2000, inflation rates within the Union rather went into an increasing
divergence process. Moreover, the bayesian dynamic stochastic general equilibrium model
implemented allows to state that the inflation differential is mostly due to asymmetric
shocks, also assessing the structural economic differences of the WAMU member countries.
Indeed, more than 66% of the inflation differential variability is explained by these shocks.
JEL Classification: C11, O47, E63
Key words: Bayesian DSGE models, β-convergence, σ-convergence, Monetary Union.
1
Direction de la Prévision et des Etudes Economiques (DPEE)

2
Introduction
Avec la création d’unions monétaires dans le monde (Zone euro, processus de dollarisation
complète, etc.) la théorie économique s’est beaucoup penchée sur les avantages et
inconvénients d’appartenir à une zone monétaire et de perdre ainsi la souveraineté nationale
en matière de gestion de la monnaie et du change. Concomitamment, la question des
différentiels d’inflation dans les unions monétaires est apparue comme une préoccupation
majeure, aussi bien pour les décideurs politiques que pour les académiciens.
Au lendemain de la dévaluation du FCFA, la stabilité des prix est devenue une priorité
communautaire parmi d’autres. D’ailleurs, des pays comme le Sénégal ont depuis toujours
rempli ce critère de convergence. Ce processus est stoppé par la crise alimentaire de 2007.
Ainsi, la hausse différenciée des prix dans les différents pays de l’UMOA a suscité beaucoup
d’interrogations au niveau des décideurs économiques. Pour comprendre, de façon globale, le
problème du différentiel d’inflation, beaucoup de travaux ont été réalisés (Diop (2002),
Commission de l’UEMOA (2007)).
De façon générale, les investigations sur les différentiels d’inflation font apparaître deux
types d’approches. La première fait appel aux concepts de β-convergence et de σ-
convergence largement usités, en particulier depuis les années 90, dans la théorie de la
croissance économique (Barro, 1991 ; Barro et Sala-i-Martin, 1992 ; Quah, 1994). Plus
spécifiquement, Weber et Beck (2005), Ogawa et Kamamoto (2008), Licheron (2007)
Angeloni et Ehrmann (2004, 2007), Horvàth et Koprnickà, (2008), etc., ont recours à cette
approche théorique pour analyser l’évolution des différentiels d’inflation dans l’UEM.
La seconde approche, quant à elle, privilégie les modèles néo-keynésiens (les modèles
dynamiques d’équilibre général stochastiques ou « DSGE models »). Plus exactement, ces
modèles s’appuient sur les interactions entre économies composant une union monétaire. Ils
permettent notamment d’introduire des rigidités nominales et réelles (Smets et Wouters
(2003)) ou encore, de travailler avec une économie à plusieurs secteurs. D’autre part, les
modèles DSGE sont capables d’évaluer l’effet Balassa-Samuelson, le rôle des politiques
budgétaire et monétaire, etc. Leur riche architecture fait actuellement que les modèles
DSGE sont au cœur de tous les dispositifs d’évaluation des politiques économiques et des
instruments que les institutions de recherche et les banques centrales utilisent dans leurs
investigations.

3
La contribution de cette étude est double : d’une part, elle combine deux méthodologies
généralement utilisées dans la littérature afin d’apprécier l’importance et l’évolution du
différentiel d’inflation au sein de la zone monétaire ouest africaine, et d’autre part, elle
cherche à identifier l’origine du différentiel d’inflation au sein de l’UMOA. A notre
connaissance, ce travail est le premier qui utilise un modèle DSGE bayésien pour analyser le
différentiel d’inflation dans l’UMOA.
Le reste du présent document s’articule comme suit. La section 1 est consacrée au survol de
la littérature. Elle traite des différentes méthodes communément utilisées. Il est question des
caractéristiques structurelles de l’UMOA à travers les faits stylisés dans la section 2. Dans
les troisième et quatrième parties, nous revenons sur les tests de convergence ainsi que sur
le modèle d’équilibre général stochastique (DSGE). Les résultats du modèle DSGE bayésien
sont déclinés dans la section 5 et la dernière partie est consacrée à la conclusion.

4
I. Un bref survol de la littérature
La question des différentiels d’inflation est récemment apparue comme une préoccupation de
plus en plus importante dans la littérature sur la formation des unions monétaires. Ce
phénomène s’inscrit particulièrement dans le sillage de la création de l’Union Economique et
Monétaire (UEM) en janvier 1999, faisant elle-même suite à l’adoption du Pacte de Stabilité
et de Croissance en 1997, qui fait de la convergence économique et de celle des prix une des
garanties essentielles à la pérennité de l’UEM et à la stabilité de la monnaie unique. C’est
ainsi que l’adoption de la monnaie unique européenne et l’hétérogénéité des politiques et
structures monétaires antérieures à l’UEM ont donné l’impulsion à une série de travaux
cherchant à caractériser l’évolution des disparités en matière d’agrégats structurels et de
politiques économiques parmi les économies concernées.
Dans le même ordre d’idées, depuis la mise en place de l’UMOA, la stabilité des prix est
devenue une priorité communautaire. D’ailleurs, des pays comme le Sénégal ont depuis
toujours rempli ce critère de convergence. Depuis le premier trimestre 2007, la hausse des
prix mesurée par l’indice harmonisé des prix à la consommation dans les capitales a suscité
beaucoup d’interrogations au niveau des décideurs économiques. Pour comprendre de façon
globale le problème de l’inflation, des travaux ont déjà été réalisés par la BCEAO (Diop
(2002)) et récemment, une étude effectuée par la Commission de l’UEMOA (2007) s’est
intéressée aux déterminants de l’inflation structurelle.
De manière générale, les travaux sur les différentiels d’inflation font apparaître deux
approches. La première fait appel aux concepts de β-convergence et de σ-convergence,
largement usités, en particulier depuis les années 90, dans la théorie de la croissance
économique (Barro, 1991 ; Barro et Sala-i-Martin, 1992 ; Quah, 1994) afin de tester
l’hypothèse selon laquelle les pays initialement pauvres tendent à rattraper les nations les
plus riches, en termes de revenus par tête. C’est ainsi que des auteurs tels que Weber et Beck
(2005), Ogawa et Kumamoto (2008), Licheron (2007) ont eu recours à cette approche
théorique pour analyser l’évolution des différentiels d’inflation dans l’UEM.
Si l’approche de la σ-convergence a essentiellement consisté en des tests des propriétés
statistiques des séries du différentiel d’inflation permettant de décrire l’évolution de la
dispersion des taux d’inflation, l’analyse par la β-convergence s’est attachée à expliquer
l’évolution et l’ampleur des différentiels par, d’une part, la persistance de l’inflation et d’autre
part, les facteurs cycliques tels que les différentiels de productivité (qui rendent compte
d’éventuels effets Balassa-Samuelson), les indicateurs de politique budgétaire (Licheron,
2007), le degré d’ouverture des économies, les effets du taux de change (Angeloni et
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
1
/
57
100%