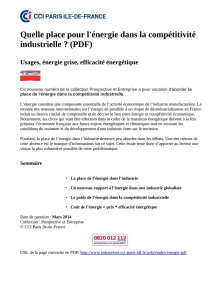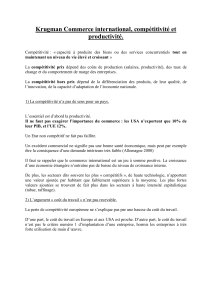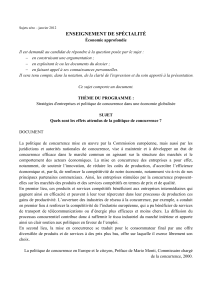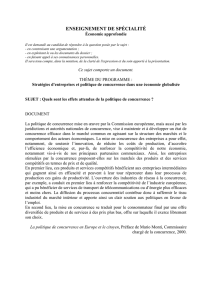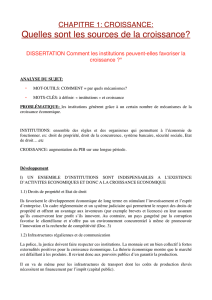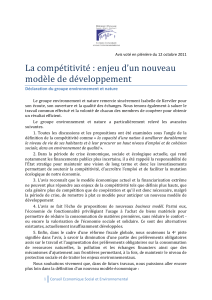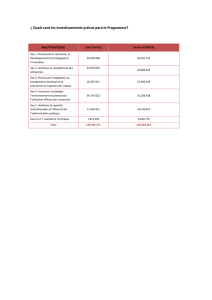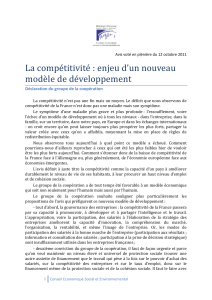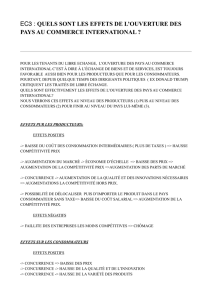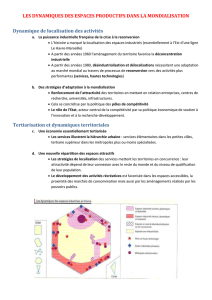Evolution du concept et de mesure de la compétitivité

1
République du Sénégal
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
M
MI
IN
NI
IS
ST
TE
ER
RE
E
D
DE
E
L
L’
’E
EC
CO
ON
NO
OM
MI
IE
E
E
ET
T
D
DE
ES
S
F
FI
IN
NA
AN
NC
CE
ES
S
CENTRE D’ETUDES DE POLITIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT
EVOLUTION DU CONCEPT ET DE LA MESURE DE LA
COMPETITIVITE
DOCUMENT DE TRAVAIL OCTOBRE 2008

2
I- Introduction générale
La compétitivité considérée unanimement comme un impératif dans le contexte de la
mondialisation, est un phénomène économique complexe et une question controversée. Le
concept ne fait ni l’objet d’une définition universelle, ni de mesures empiriques consensuelles.
Par ailleurs, l’enjeu de la compétitivité peut être considéré à plusieurs niveaux de
préoccupation ou d’agrégation: micro, meso, macro et meta d’une part ; produit, entreprise,
secteur/branche/filière/grappe, zone/région/pays. A chacun de ces niveaux, le concept de
compétitivité est à rapprocher à un objectif économique ou une finalité sociale, sans quoi, il
risque de rester une curiosité intellectuelle sans objet.
Ainsi, au niveau de la nation, la compétitivité renvoie généralement à la capacité d’un pays à
produire des biens et services qui supportent la concurrence de biens et services d’autres pays
pendant que leur cession sur les marchés cibles contribue à consolider ou à accroître sur le
long terme le revenu intérieur en termes réels. Un indicateur possible pour mesurer la
compétitivité est alors la croissance économique.
Mais des auteurs comme Michael Porter (1990) et Lundberg (1999) soutiennent que la
compétitivité est appréhendée avec plus d’intérêt au niveau sectoriel et sous-sectoriel, comme
capacité d’un pays à gagner et à préserver avec profit des parts des marchés intérieurs ou
extérieurs ciblés.
A travers le temps, les tentatives d’explication des sources de la compétitivité entre pays et
donc de profil de spécialisation et de commerce extérieur d’un pays, ont suscité la proposition
de deux concepts analytiques : l’avantage comparatif et l’avantage compétitif.
Un pays dispose d’un avantage comparatif dans un produit quand il peut le produire à un coût
d’opportunité plus faible que les autres pays, pour des raisons variées pouvant être liées à la
dotation en ressources naturelles, en facteurs, en technologies, en culture de la productivité,
Cette approche qui met en avant la relative maîtrise des coûts de production est différente de
celle fondée sur les économies d’échelle ou le potentiel de différentiation qui permet de placer
un produit malgré un prix plus élevé que la concurrence.
L’avantage compétitif ressort d’une vision dynamique de l’avantage comparatif. Il met
l’accent sur le processus de création de l’avantage relatif dont peut disposer un pays dans la
production d’un produit donné, contrairement à l’avantage comparatif qui, sur une base
statique, fait reposer la compétitivité sur des avantages hérités.
Au total, l’on peut répertorier comme suit les déterminants de la compétitivité :
o les facteurs de production disponible et leur qualité ainsi que l’état de la technologie
applicable par rapport à celle des concurrents ;
o les conditions macroéconomiques, notamment le niveau des taux d’intérêt et du taux
de change ;
o les autres politiques publiques à effets transversaux y compris la politique
commerciale et les accords commerciaux avec d’autres pays. Un cadre juridique
transparent, stable et prévisible, un système éducatif et de formation adapté et efficace,

3
le développement progressif de la recherche –développement sont des atouts
importants pour entretenir la productivité à court comme à long terme ;
o le développement conséquent des secteurs en amont et en aval des produits concernés
et les conditions sur les marchés intérieurs à travers l’existence de fournisseurs à offre
concurrentielle à l’échelle internationale et des clients faisant preuve d’une exigence
également à l’échelle concurrentielle.
Ce cadre des déterminants de la compétitivité fait référence, cependant, au Losange de
Michael Porter dont le caractère plutôt qualitatif et l’absence d’hypothèses testables ont été
soulignés mais aussi l’approche structurée qu’il propose pour l’analyse des forces et faiblesses
d’un secteur ou d’un pays en matière de compétitivité.
Au chapitre de la mesure du niveau de compétitivité, deux catégories d’indicateurs peuvent
être distinguées :
o les mesures de performance révélée fondées sur la comparaison de productivité ou de
technologies, sur la rentabilité, sur les taux d’autosuffisance et de parts de marché, et
sur les statistiques de commerce extérieur. Un exemple de ces indicateurs est
l’avantage comparatif révélé;
o les mesures de performance potentielle fondées sur les méthodes comptables telles le
coût en ressources internes.
Le présent document ressource du CEPOD revient sur ces différentes questions avec plus de
détail ainsi que sur les théories et les travaux empiriques qui sont développés sur la
compétitivité et sa mesure. Le Plan du reste du document-ressource est le suivant :
II. Rappels sur l’avantage comparatif
III. Définition et portée de la compétitivité
IV. Indicateurs simples de compétitivité
V. Les théories de la compétitivité
VI. Benchmarking et indicateurs synthétiques de la compétitivité
VII. Problématique d’un observatoire de la compétitivité d’une petite économie ouverte
VIII. Conclusions

4
II. De l’avantage comparatif à l’avantage compétitif
La compétitivité internationale qui renvoie aux performances économiques d’un pays, d’une
région ou d’une entreprise en présence d’autres pays, d’autres régions ou d’autres entreprises,
est certainement au centre du programme de recherche de l’économie internationale. Elle est
ainsi à la base d’une succession de concepts et d’approches dont compte est rendu est ci-
après.
1- Approche classique.
Xénophon, le précurseur de la science économique la décrit comme l’art et la science de tenir
en ordre sa maison et plus généralement ses biens. Mais l’analyse du commerce international a
commencé avec la théorie mercantiliste qui s’est développée à partir des années 1900.
Auparavant, Christophe Colomb avait découvert l’Amérique en 1492. Jusqu’à cette période, la
plupart des biens produits dans les communautés humaines ne faisaient pas l’objet d’échanges
extérieurs. Au fur et à mesure que les explorateurs découvrent de nouveaux pays et que
l’économie monétaire s’installe, les Etats-nations deviennent les forces dominantes dans
l’accumulation de richesses d’or et d’argent. Le mercantilisme a ainsi cours entre 1500 et 1776,
période dominée par le laissez-faire. Le commerce est alors florissant à l’intérieur des pays et
entre les pays, parallèlement à une utilisation accrue de la monnaie et une importance
croissante des villes. L’intensification de la rivalité entre nations fortes a, sur cette base, donné
naissance au fait colonial. Sur les cendres de l’auto-suffisance des communautés féodales, le
corps de doctrine mercantiliste promeut le nationalisme, confère dignité et puissance au négoce
et justifie une politique d’expansion économique et militaire le long des axes ci-après :
- l’or et l’argent représentent la forme la plus désirable de la richesse ;
- au nom du nationalisme ambiant, tout pays doit promouvoir les exportations et accumuler
des richesses aux dépens de ses voisins ou partenaires, quitte à réguler les échanges pour
un équilibre qui lui soit favorable. Conséquence : seules les nations puissantes peuvent
conquérir et garder des colonies, dominer les grandes routes de commerce, et participer
avec succès au commerce international ;
- l’importation libre de droits des matières premières qui ne sont pas produites localement,
la protection des produits manufacturés et des restrictions sur l’exportation des matières
premières locales ;
- l’intérêt du négociant l’emporte sur celui du consommateur : le négociant exporte et
accumule l’or pendant que le consommateur est rationné à travers les restrictions sur les
importations et que le pays gagne en richesse et puissance ;
- un gouvernement central fort doit garantir des privilèges de monopoles aux compagnies
de commerce, réguler l’accès aux affaires afin de limiter le commerce, subventionner et
protéger des importations l’agriculture, les mines et l’industrie.
Le mercantilisme a apporté à l’économie l’importance reconnue au commerce international et
produit un outil de comptabilité et d’analyse des échanges entre un pays et le reste du monde :
la balance des paiements.
2- L’école classique.
L’école classique naît en 1776 avec la publication de l’ouvrage d’Adam Smith « la richesse
des nations.» La doctrine classique est celui du libéralisme économique dont les bases sont :
la liberté de l’individu, la propriété privée, l’initiative individuelle, l’entreprise privée et le

5
gouvernement minimum. L’économie classique a rationalisé l’activité de l’entreprise, à
travers l’accent mis sur la concurrence et au moyen d’un corps de « lois » enseignées
désormais comme des principes économiques :
- la loi des rendements décroissants ;
- la loi de l’avantage comparatif ;
- la souveraineté du consommateur ;
- l’importance de l’accumulation de capital pour la croissance économique ;
- le mécanisme du marché pour concilier intérêt individuel et intérêt collectif.
Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823) et John Stuart Mill (1806-1873) ont
jeté les bases de la théorie du commerce international. Pour ces trois auteurs, tout pays peut
atteindre son niveau de revenu et de la croissance économique le plus élevée en maintenant un
commerce ouvert avec le reste du monde, guidé par les prix que les partenaires étrangers
proposent en échange des produits domestiques. En lieu et place des restrictions sur le
commerce, le gouvernement devrait mettre l’accent sur le maintien des marchés nationaux
concurrentiels et l’investissement dans des biens publics comme l’éducation et la recherche.
L’école classique a contribué à une meilleure compréhension des fondements de la production
et des échanges dans l’économie mondiale à travers :
- la division du travail évoquée par Adam Smith sous-tend la spécialisation des efforts d’un
individu et de la production d’une nation dans la société industrielle ;
- l’avantage comparatif décrit par David Ricardo permet d’identifier les activités dans
lesquelles un pays peut se spécialiser à son avantage ;
- les avantages tirés de l’échange avec l’extérieur permettent à une nation d’atteindre des
niveaux de consommation que sa production n’aurait permis d’atteindre.
3- Les modèles néoclassiques
En 1871, W. Stanley Jevons, Carl Menger et Léon Walras ont publié de façon indépendante
des travaux qui fondent les théories néoclassiques. Il s’agit d’une somme de modèles qui
décrivent les sources de l’avantage comparatif et de la spécialisation, c’est-à-dire les sources
de différences dans les coûts d’opportunité. Sans ces constructions néoclassiques, seules
l’expérience tirée de l’apprentissage pourrait justifier l’avantage comparatif.
a) Modèle de Heckscher et Ohlin.
Eli Heckcher (1919) et Bertil Ohlin (1933) distinguent les pays en fonction de leurs dotations
en facteurs de production et les produits en fonction des facteurs nécessaires à leur
production. Le modèle qu’ils proposent établit qu’un pays aura un avantage comparatif et
donc exportera le bien dont la production requiert relativement plus les services du facteur
dont le même pays est relativement plus doté. Cette conclusion repose sur la logique qui veut
que plus le facteur est abondant plus son coût est faible.
Le modèle d’Heckscher et Ohlin s’appuie et complète la théorie classique de l’avantage
comparatif. Toutefois, le paradoxe de Léontieff (1953), semble indiquer que même complété
par la contribution de Jaroslav Vanek (1968), le modèle de HO explique au mieux les sources
de l’avantage comparatif en cas de concurrence que la structure du commerce extérieur des
pays.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
1
/
44
100%