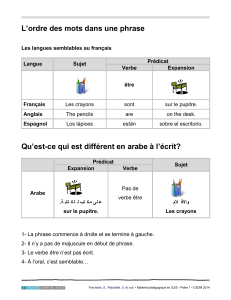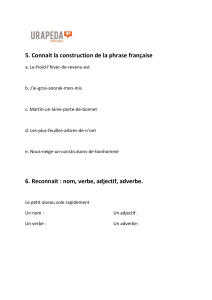La Dénomination

Langue française
http://www.necplus.eu/LFR
Additional services for Langue française:
Email alerts: Click here
Subscriptions: Click here
Commercial reprints: Click here
Terms of use : Click here
Sur les termes grammaticaux gurant dans les dictionnaires de la langue
générale. Réformer la terminologie en s’efforçant de conserver les
dénominations
Denis Le Pesant
Langue française / Volume 2012 / Issue 174 / June 2012, pp 77 - 93
DOI: 10.3917/lf.174.0077, Published online: 11 January 2013
Link to this article: http://www.necplus.eu/abstract_S0023836812174063
How to cite this article:
Denis Le Pesant (2012). Sur les termes grammaticaux gurant dans les dictionnaires de la langue générale. Réformer la
terminologie en s’efforçant de conserver les dénominations. Langue française, 2012, pp 77-93 doi:10.3917/lf.174.0077
Request Permissions : Click here
Downloaded from http://www.necplus.eu/LFR, IP address: 88.99.70.218 on 16 Apr 2017

Denis Le Pesant
Université Paris Ouest Nanterre La Défense & Laboratoire MoDyCo (CNRS UMR 7114)
Sur les termes grammaticaux figurant dans les
dictionnaires de la langue générale. Réformer la
terminologie en s’efforçant de conserver les
dénominations
Une partie non négligeable des termes de spécialité fait partie de la langue géné-
rale. C’est un phénomène qui a probablement toujours existé, mais qui semble
se renforcer de nos jours du fait de l’augmentation de l’offre et de la demande de
produits et services technologiquement sophistiqués, et de l’élévation du niveau
d’instruction d’une population de plus en plus avide d’informations fiables dans
tous les domaines. Les dictionnaires courants de la langue générale (en un ou
plusieurs volumes) enregistrent ce mouvement en opérant des mises à jour : des
termes nouveaux se manifestent, d’autres disparaissent ou sont signalés comme
désuets, et des dénominations anciennes voient leur définition revue et corri-
gée. C’est ainsi que des terminologies élémentaires de biologie, d’astrophysique,
d’économie, etc. figurent en bonne place dans les dictionnaires de la langue
générale, et qu’elles font l’objet de révisions et de mises à jour dans l’ensemble
satisfaisantes, en relation avec le progrès des différentes sciences.
La situation de la terminologie grammaticale figurant dans les dictionnaires
de la langue générale est différente. Elle s’inscrit dans un cadre théorique d’ins-
piration philosophique qui n’a plus guère d’adeptes en linguistique contem-
poraine, la théorie du jugement, laquelle fait du sujet le terme principal de la
proposition (cf. infra note 19 in fine) ; elle a peu varié depuis deux siècles, et les
mises à jour et révisions ont été relativement peu nombreuses, ce qui fait qu’elle
est loin de faire l’unanimité dans la communauté des linguistes.
Si les progrès des sciences du langage ne sont guère pris en compte par
les lexicographes, ce n’est ni la faute de ces derniers, ni celle des linguistes.
LANGUE FRANÇAISE 174
rticle on line
rticle on line
77
“LF_174” (Col. : RevueLangueFrançaise) — 2012/6/17 — 23:42 — page 77 — #77
i
i
i
i
i
i
i
i

La Dénomination
Les termes grammaticaux, même ceux qui sont vieillis ou définis de façon
inadéquate, conservent leur légitimité à figurer dans les dictionnaires de la
langue générale, dès lors qu’ils continuent à être utilisés tels quels par les
locuteurs. À peu près tous les locuteurs du français, depuis des générations,
ont dès l’enfance entendu parler du sujet, du verbe et du complément, des
compléments d’objet et des compléments circonstanciels, de la proposition
principale et de la proposition subordonnée, etc. Cela a eu pour effet que la
terminologie grammaticale véhiculée par l’école est fortement implantée dans la
langue ordinaire.
Mais il ne s’agit plus d’une terminologie de spécialité, car le système scolaire
français n’a pas su moderniser les programmes et instructions pédagogiques
relatifs à l’enseignement de la grammaire pour les rendre conformes à l’évolution
de la discipline. La terminologie grammaticale des dictionnaires de la langue
générale n’est donc pas à mettre sur le même plan que les terminologies de
biologie, d’économie, etc. évoquées supra, qui ont dans l’ensemble fait l’objet
des révisions nécessaires, parallèlement à celles qui sont intervenues dans les
programmes scolaires.
Cette situation ouvre la voie à ce qu’une nouvelle terminologie grammati-
cale de spécialité soit éventuellement introduite dans les futures rééditions des
dictionnaires de la langue générale. Est-ce à dire qu’il faudrait imposer une ter-
minologie entièrement refondée sur des bases plus « scientifiques » ? Certes non,
car ce n’est ni nécessaire, ni souhaitable, ni même possible, probablement. Ce
n’est pas nécessaire, parce que, si tant est que les dénominations grammaticales
font partie de la langue générale, elles peuvent bien connaître le même sort que
beaucoup de dénominations ordinaires, voire de dénominations techniques, à
savoir changer d’acception en diachronie ; ce n’est pas souhaitable, car les inno-
vations théoriques (et pas seulement en linguistique) sont plus faciles à diffuser
quand elles utilisent, plutôt qu’un système de néologismes, un large appareil de
dénominations existantes 1; et ce n’est sans doute pas possible, car un système
scientifique de dénominations linguistiques devrait avoir un caractère univer-
sel, i.e. référer à un système de concepts adéquats à la multitude des langues
décrites ; or, il ne va pas de soi que cela puisse jamais se produire 2.
Nous allons essayer de montrer dans ce qui suit qu’une mise à jour des
dictionnaires de la langue générale ne nécessiterait pas que beaucoup d’entrées
1.
C’est l’opinion de Dubois & Lagane (1973 : 2), qui, présentant leur Nouvelle Grammaire du français,
écrivent : « Il n’est pas indispensable de recourir à une terminologie qui pourrait paraître déroutante ; aussi
avons-nous conservé dans la mesure du possible les dénominations traditionnelles ». Dans un ordre d’idées
avoisinant, Colombat & Savelli (2001 : xvi) font ce constat : « Aujourd’hui, il semble qu’on procède plus au
coup par coup, en évaluant la terminologie préexistante et en étant attentif à articuler les créations avec cet état
antérieur ».
2.
Chevalier (2001 : 513 sqq.) montre que les participants aux trois premiers congrès internationaux de
linguistes (années 1928, 1931 et 1938) ont pris conscience des difficultés apparemment insurmontables du
projet d’une terminologie linguistique universelle.
78
“LF_174” (Col. : RevueLangueFrançaise) — 2012/6/17 — 23:42 — page 78 — #78
i
i
i
i
i
i
i
i

Sur les termes grammaticaux figurant dans les dictionnaires de la langue générale
nouvelles soient créées, car la plupart des dénominations traditionnelles peuvent
être conservées, mais au prix souvent d’une révision de la définition. Il ne s’agi-
rait donc, dans la plupart des cas, que de compléter les entrées grammaticales
existantes en y ajoutant la description d’un éventuel emploi technique contem-
porain. Dans la première partie de cet article, nous évoquons les aspects les plus
problématiques de la terminologie traditionnelle. La deuxième partie décrit une
méthode de révision des définitions visant à ce que soient conservées la plupart
des dénominations usuelles, et explicite les révisions suggérées. La synthèse de
celles-ci est présentée à la fin de l’article sous forme de tableaux.
1.
REMARQUES SUR LA TERMINOLOGIE GRAMMATICALE FIGURANT
DANS LES DICTIONNAIRES DE LA LANGUE GÉNÉRALE
Les termes syntaxiques de base se répartissent entre trois types de catégories
génériques : les catégories lexicales dites autrefois parties du discours (nom, verbe,
adjectif, etc.) ; les catégories syntaxiques (Phrase, Syntagme Nominal, Syntagme
Verbal, etc.) ; les catégories fonctionnelles ou fonctions (sujet, complément, etc.).
1.1. Les catégories lexicales ou parties du discours
La liste des catégories lexicales traditionnelles qui figure dans les dictionnaires de
la langue générale n’est à remettre en cause que sur quelques points relativement
secondaires. Considérons plus particulièrement le cas du traitement du terme
nom.
Il n’y a guère plus d’un siècle, par exemple dans le Littré (cf. les entrées
nom et adjectif ), les notions et les dénominations étaient en gros les mêmes
qu’au temps des grammairiens latins (Varron, Quintilien, Priscien, etc.) : on en
distingue deux sous-catégories, les noms substantifs et les noms adjectifs. Cette
dernière catégorie est elle-même divisée en deux classes : les adjectifs qualificatifs
et les adjectifs déterminatifs dits aussi articles, tels le,tout et aucun. La raison d’être
de ce regroupement semble être le phénomène d’accord en genre, nombre et cas
de l’environnement du substantif (d’où le terme d’adjectif ) avec le substantif
lui-même. Le choix des termes repose sur des considérations philosophiques :
l’opposition substantif vs. qualificatif est l’homologue de l’opposition aristotéli-
cienne substance vs. accident.
Dans la terminologie traditionnelle « modernisée » qui figure dans les diction-
naires courants, les trois termes de nom, d’adjectif (qualificatif) et de déterminant
constituent chacun une catégorie lexicale spécifique, et c’est dans une catégorie
non plus lexicale (le nom) mais syntaxique qu’ils sont regroupés : le Syntagme
Nominal. Toutefois, l’usage ancien de placer ce que l’on appelle aujourd’hui
les déterminants dans la catégorie des adjectifs n’a pas été abandonné par tous
LANGUE FRANÇAISE 174
79
“LF_174” (Col. : RevueLangueFrançaise) — 2012/6/17 — 23:42 — page 79 — #79
i
i
i
i
i
i
i
i

La Dénomination
les dictionnaires contemporains
3
. Une mise à jour est parfois réalisée, mais de
façon partielle, quand les anciens termes d’adjectif possessif,démonstratif,indéfini et
numéral subsistent tout en étant subsumés par le nouveau terme de déterminant
4
.
Dans un dictionnaire de la langue générale, les noms de catégories lexicales
ne devraient pas être rapportés à un domaine de spécialité particulier (par ex.
« LINGUISTIQUE » ou « GRAMMAIRE ») car leur cas illustre de façon particulière-
ment nette le bien-fondé de la thèse de Z. Harris (1988 : 34 ; 2002 : 8-9) sur le fait
que la métalangue de la linguistique fait partie de la langue
5
. De fait, dans un
dictionnaire comme le Nouveau Petit Robert 2009, les entrées verbe,adjectif,pronom,
adverbe,préposition,interjection ne sont pas rapportées au domaine technique de
la linguistique. Il est naturel qu’il en soit autrement pour l’entrée conjonction. On
est en revanche surpris de voir que l’entrée nom du Nouveau Petit Robert 2009
(qui, sur ce point comme sur la plupart des autres points, reprend l’essentiel de
ce qui figure dans le Grand Robert 1980) spécifie, à côté des emplois non tech-
niques I (nom propre) et II (nom commun), un emploi III rattaché au domaine
GRAMMAIRE, avec deux sous-domaines : III.1 COURANT et III.2 LINGUISTIQUE.
Il est frappant de constater que la définition de l’emploi de spécialité (« mot
lexical qui désigne un individu, une classe ») est à peu près identique à celles
des emplois non techniques (« mot ou groupe de mots servant à désigner un
individu » et « mot servant désigner les êtres, les choses qui appartiennent à une
même catégorie logique »), ce qui témoigne du caractère redondant de l’emploi
III.1. Mais citons maintenant le passage consacré à l’emploi III.2 :
LING. Catégorie utilisée par les grammairiens latins et classiques et reprise par cer-
tains grammairiens modernes, comprenant le nom au sens 1 (nom substantif), l’adjectif
et le pronom (nom adjectif) et parfois certaines formes verbales (noms verbaux : infinitifs,
participes)
Il s’agit effectivement d’emplois techniques du mot nom ; leur caractère
désuet est avoué, et on peut regretter le caractère confus de cette rubrique
du point de vue historique
6
. Tout compte fait, la rubrique III.2 n’est pas plus
3.
Par exemple, le Petit Larousse Illustré 2011 définit l’adjectif, en reprenant d’ailleurs presque mot pour mot
la formulation de Littré, comme étant un « mot variable qui qualifie ou détermine le substantif auquel il est
joint », et spécifie : « adjectif qualificatif, démonstratif, possessif ».
4.
Ainsi, le Dictionnaire Maxipoche 2011 écrit sous l’entrée Déterminant que « les articles, les adjectifs
possessifs, etc. sont des déterminants ». Pour le Nouveau Petit Robert 1996, « le déterminant est un constituant
du groupe nominal (article, adjectif, complément du nom) » et le Robert Micro 2006 donne comme exemples
de déterminants les « articles, adjectifs possessifs, etc. ».
5.
Les langues de spécialité sont considérées par Harris comme étant des sublanguages obéissant, selon
les termes de Swiggers (1999), « à un ensemble de conventions s’inscrivant à l’intérieur des conventions
distributionnelles générales valables pour la langue (ordinaire) qui l’englobe (langue superordonnée) ».
6.
Certes, comme nous l’avons déjà signalé, ce que nous appelons adjectif s’est appelé depuis l’Antiquité
jusqu’à l’époque de Littré nom adjectif (par opposition au nom substantif ) ; mais le pronom n’a généralement
pas été classé dans la catégorie des noms adjectifs. Toutefois, ce que nous appelons déterminants s’est appelé
nom adjectif déterminatif (cf. supra début du § 1.1) et le caractère pronominal des déterminants déictiques ou
anaphoriques avait été déjà relevé par les grammairiens de l’âge classique, ce qui pourrait expliquer que Le
Petit Robert place, dans une généralisation abusive, les pronoms dans la catégorie des noms adjectifs.
80
“LF_174” (Col. : RevueLangueFrançaise) — 2012/6/17 — 23:42 — page 80 — #80
i
i
i
i
i
i
i
i
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%