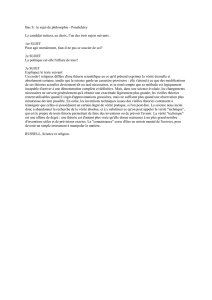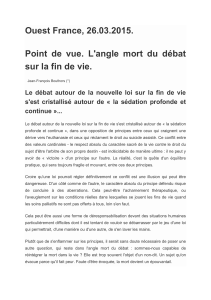Au.benefice.du.doute..

1
Au bénéfice du doute
Au bénéfice du douteAu bénéfice du doute
Au bénéfice du doute

2
Table des matières
Note liminaire ........................................................................................................ 3
Problématique : de la bêtise au doute ................................................................. 7
Question de départ : vérifions l’outil de la pensée .............................................. 8
Des rapports que nous avons avec la vérités ..................................................... 10
cadre conceptuel : croire – vérité – illusion ...................................................... 10
La malédiction des sens .................................................................................. 11
De la croyance – La vérité est ailleurs… ....................................................... 12
De croire par habitude ................................................................................... 15
Croire et se fier .............................................................................................. 17
De la crédulité à la bêtise .............................................................................. 18
Croire en grec ................................................................................................ 20
Croire en , besoin de confiance et risque de trahison .................................... 21
Croire pour connaître .................................................................................... 22
Des méthodes aux vérités, questionnement épistémologique ...................... 23
Entre croyance et vérité : la place du doute .................................................. 24
L’angoisse du doute ...................................................................................... 27
Croire pour faire ................................................................................................ 29
Le consensus un outil pragmatique ............................................................... 29
De la norme à la vérité .................................................................................... 32
C. Malèvre ou introduction au scepticisme ........................................................... 34
Cadre conceptuel du doute .................................................................................... 38
Socle théorique du doute ................................................................................ 41
Etymologie et analogies sémantiques linguistiques ...................................... 41
Histoire et interprétations .............................................................................. 45
De la prudence aristotélicienne au doute pyrrhonien .................................. 47
Le jardin d’enfant de Monrovia .................................................................... 48
La meilleure façon de penser ......................................................................... 50
Présentation et critique du principe de contradiction .................................... 51
Le tiers exclu ................................................................................................. 58

3
Intention du projet de thèse : ................................................................................. 59
Note liminaire
L’enseignement des sciences ne cesse de nourrir l’humanité tant en
espoirs et en certitudes qu’en termes de désillusions. Si l’histoire nous impose une
forme de méfiance envers la vérité de chaque chose, les espérances dans les
utilités attendues de cette science nous font poser, quelques fois, un mouchoir sur
le soupçon, le doute qu’il conviendrait pourtant souvent d’envisager. Il faut dire
que l’opinion couramment admise, accepte l’idée reçue du scepticisme dépeint
sous les traits plus ou moins effrayant d’un nihilisme exacerbé, angoissant et
mélancolique. Or le scepticisme ancien n’a pas été une entreprise de négation de
la raison, il s’est plus humblement borné, d’après Hegel, à « dresser le constat des
difficultés que la physiologie et la psychologie grecques éprouvaient à rendre
compte de la possibilité pour la perception d’appréhender ou de percevoir la
réalité en soi ou la réalité proprement dite des objets du monde extérieur.
1
» Ces
difficultés de perceptions ne semblent plus gêner en aucune façon notre
entendement contemporain, ou du moins en faisons-nous fi au profit des utilités
attendues. Cette logique de progression intellectuelle a servi et sert encore la
science, elle a servi toutes sortes d’utilités et l’histoire nous montre l’impertinence
de beaucoup de vérités fondées par cette méthode. Ce n’est pas l’erreur passagère
du savant qui est à blâmer ici mais plutôt l’attitude suffisante que certains
s’autorisent à l’approche d’une vérité. De là à trébucher dans la bêtise il n’y a
qu’un pas…
Il est des livres qui nous accompagnent le long de notre vie, ceux que
nous avons gardés à portée de main sur nos étagères. Ils nous ont surpris, agacés,
illuminés, attendris, mais par-dessus tout, ils nous ont permis de cheminer. Telle
est pour moi l’œuvre de Gustave Flaubert et plus particulièrement son dernier
volet : Bouvard et Pécuchet. Cette merveilleuse ironie de Gustave Flaubert envers
l’intelligence se décline dans une prodigieuse critique des systèmes scientifiques
qui s’opposent et se détruisent les uns les autres. Les pensées, les lois reconnues et
indiscutées sont aculées dans leurs contradictions pour n’en retenir que leur
impermanence. « Ce fil tenu tout le long de ce roman philosophique constate sans
cesse, en tout, l’éternelle et universelle bêtise. C’est l’histoire de la faiblesse de
l’intelligence humaine dans une promenade dans le labyrinthe infini de
1
Jean Paul Dumont, préface à G.W.F. Hegel, La relation du scepticisme avec la philosophie, trad.
B. Fauquet, Paris, Vrin, 1986, p.8.

4
l’érudition.
1
» Leur bêtise est érigée aujourd’hui comme un parapet (un garde-
fou ?) sur le gouffre de la connaissance.
L’homme avance comme Sisyphe poussant son rocher, il dégringole
inlassablement ce qu’il vient de gravir, aveuglé par l’immédiat bénéfice de la
progression de chaque pas. Si les contradictions des idées scientifiques
aboutissent à l’annihilation du savoir, ce n’est pas le néant qu’il faut retenir mais
que la continuité de la réflexion permet de s’extraire des certitudes. La
controverse permet de nourrir le débat et de maintenir vivant ce qui nous pousse
vers notre humanité.
Nous savons dans quelle mesure et pour quelle fin, la bêtise est nocive et
qu’elle est capable de rendre l’homme inhumain, barbare ou monstrueux ? Il est
bien possible comme l’indique Jean-François Mattei, que la barbarie se soit logée
au cœur même de notre civilisation « elle sait prendre son temps et mûrir son goût
du néant. La civilisation européenne n’a pas dissous la barbarie en conquérant de
lointaines steppes ou de nouveaux déserts, elle l’a introduite en son sein et l’a
laissé gagner par son propre processus de dissolution, irriguant de son sable les
déserts intérieurs.
2
»
Le dissensus, s’il est essentiel à la vie du débat, ne peut être, néanmoins,
considéré comme suffisant puisqu’il risquerait de nous enfermer dans une sphère
intellective sans lien avec le monde réel. Nous arrivons donc à légitimer la
nécessité de passer par l’étape de décision pour que l’éthicité de la réflexion
puisse être mesurable dans l’acte. Pour passer à l’action et que celle-ci soit
acceptable dans le sens commun, il est convenu que la décision soit aujourd’hui
consensuelle. Le consensus n’offre pas forcément les avantages que promettait
Habermas dans sa première étape de réflexion sur l’éthique de la discussion, il est
aussi aliéné aux limites humaines et fluctuantes de l’éthos. L’empathie solidaire
que prône Habermas, confrontée à ces limites de l’éthos, ne peut avoir de sens que
dans un monde où chacun adhère à cette logique. Utopie. Le monde vécu nous
montre à chaque seconde que les enjeux de la discussion ont raison de cette
solidarité et que se mettent en place des jeux de pouvoir. La rhétorique
aristotélicienne cède trop souvent la place à la sophistique car avoir raison de
l’altérité prend généralement le pas sur le partage des vérités. Les limites de
l’empathie solidaire nous renvoient inévitablement à son contraire : l’antipathie
individualiste dont la bêtise campe l’archétype et sur qui il faut compter dans le
monde vécu. L’hôpital est un terrain sensible pour la rencontre humaine et
réfléchir ensemble suppose l’expérience de la discussion pour laquelle aucun des
acteurs concernés n’a reçu d’enseignement.
Au cœur de l’institution hospitalière s’est construit un monde cloisonné,
où le « vivre ensemble » qu’Hanna Arendt a donné comme télos s’est transformé
rapidement en un « mal de vivre ensemble » où chaque catégorie barbarise l’autre
de telle sorte que le centre et l’objectif commun qui logiquement se trouve être la
personne soignée, justement, ne s’y retrouve plus. Oui, c’est bien de l’hôpital qu’il
s’agit et à tous les niveaux. Ce lieu destiné à l’intimité de la rencontre humaine
1
Guy de Maupassant, « Bouvard et Pécuchet », supplément du Gaulois, 6 avril 1881, in Gustave
Flaubert, Bouvard et Pécuchet, Dictionnaire des idées reçues, Paris, GF Flammarion, 1999, p.
445.
2
. Jean-François Mattei, La barbarie intérieure, Paris, Puf, 2001, p. 47.

5
qu’est le soin, risque bientôt de ne plus répondre dans ses priorités à sa fonction
première. La personne humaine est-elle devenue trop complexe pour la médecine ?
Où est-ce le système qui est devenu incompétent pour cette rencontre humaine ?
C’est dans ce qu’est devenu l’hôpital quand il dépasse le contrôle de l’homme,
qu’il ne se contrôle plus lui-même et bascule par le biais d’une bêtise systémique
dans une nouvelle forme de barbarie que nous puiserons notre grain à moudre
pour développer notre recherche.
Cette institution, l’hôpital, est un théâtre où même les acteurs ne se
reconnaissent plus entre eux. Les acteurs hospitaliers collent aujourd’hui à cette
tendance qui consiste pour la plupart à s’autoproclamer « soignant ». Certains
parce qu’ils ont une formation initiale et une culture du soin, d’autres qui
revendiquent à grand peine l’appellation (et qui la méritent) parce qu’ils sont dans
l’ombre du soin (je pense aux secrétaires qui sont en contact avec les patients et
leur famille, qui oeuvrent administrativement pour que le soin et sa continuité
puissent se faire). D’autres encore, ceux-là sont les pires, croient que leur grade ou
leur spécialité leur confère de fait le titre de soignant quand ce n’est pas une auto
proclamation condescendante qui veut que la grandeur de soi s’augmente quand
on s’identifie dans un plus petit. Bref, il suffirait donc de se vouloir soignant pour
le devenir ! Etre soignant est aujourd’hui de bon ton semble-t-il mais la confusion
souligne encore plus ce mal de vivre ensemble. On veut tellement se ressembler
que les différences et leurs fossés se creusent. La relation s’est dégradée, le
contexte socio-économique a favorisé les cloisonnements et le consensus entre
éthique et politique a de plus en plus de mal à s’effectuer si tant est qu’un jour il
pût se faire.
Le soin, si tous les acteurs hospitaliers s’en revendiquent, pourrait bien
devenir le point d’ancrage culturel en fédérant ceux qu’aujourd’hui il divise. Pour
ce faire, des outils comme le rapport Cordier
1
en termes de références (que si peu
d’acteurs de santé connaissent…) laisse imaginer le chemin qu’il reste à parcourir
pour injecter au sein des professions de Santé, dans leur formation initiale comme
dans leur formation continue une culture éthique sur le souci de l’Autre.
Ceci nous amène au constat paradoxal d’un système d’enseignement
cloisonné et éclaté entre les différentes professions du champ sanitaire et social. Si
chaque profession reconnaît la finalité de prendre soin de l’Altérité dans sa
spécificité, aucune passerelle ne permet à ces « soignants » de se reconnaître dans
leur différence. Leur complémentarité ne s’opère à ce jour qu’en passant de l’un à
l’autre, plus précisément en passant le patient d’une spécialité à une autre. Les
enseignements initiaux se passent dan le cloisonnement le plus total et les acteurs
se retrouvent au final sur le même terrain : l’hôpital. Des cultures de clochers se
construisent ainsi et l’hôpital les rassemble sans toutefois les mélanger. Les
échanges sont compliqués, les logiques enfermées et tout ceci contribue à des
incompréhensions, des difficultés qui nourrissent le mal de vivre ensemble. La
discussion s’aliène au cloisonnement des logiques, à la défense des territoires et
en attendant des consensus impossibles, les dissensus ne sont plus le moteur de la
discussion que souhaitait Paul Ricœur mais sont devenus d’inlassables diatribes
où se vautrent le pouvoir, l’indécence et la bêtise.
1
Commission Ethique et Professions de Santé, Ethique et Professions de Santé, Rapport au
Ministre de la Santé, de la Famille, et des Personnes Handicapées. Mai 2003.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
1
/
61
100%