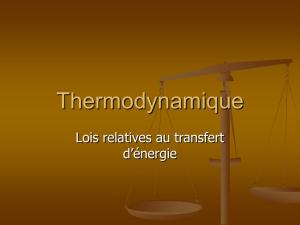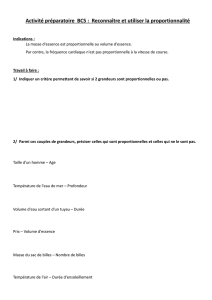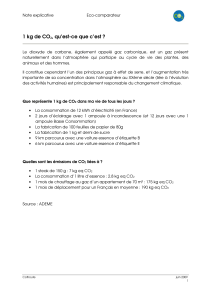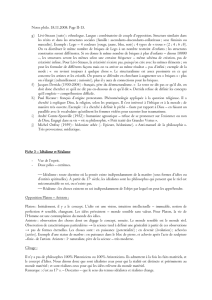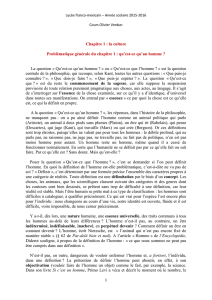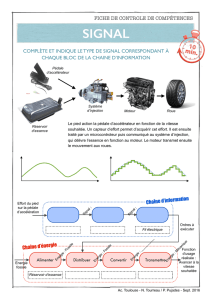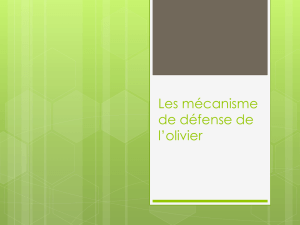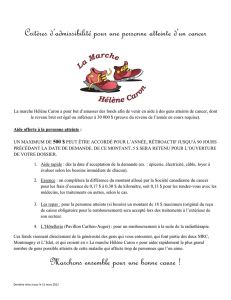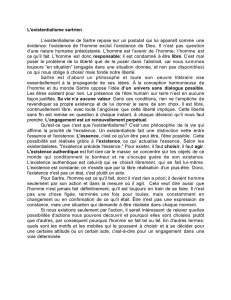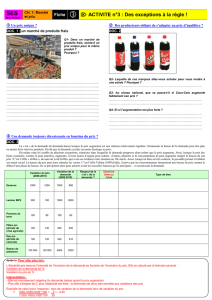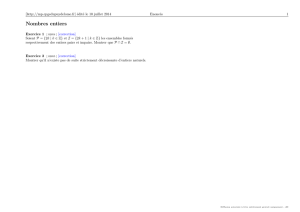L`existence et le temps

Lycée franco-mexicain – Année scolaire 2016-2017 – Cours Olivier Verdun
1
Chapitre 1, séance 6 : l’existence et le temps
L’existence a-t-elle un sens ?
Notions connexes : la conscience, la liberté, le bonheur
Repères : essentiel / accidentel, objectif / subjectif, contingent / nécessaire / possible
Objectif méthodologique : analyse d’un sujet de dissertation
INTRODUCTION
Sitôt sorti du palais où il avait été cloîtré pendant toute son enfance, le Prince Siddhârta, futur
Bouddha, fit sur la route plusieurs rencontres bouleversantes. D’abord celle d’un malade, qui lui
fait découvrir pour la première fois que l’existence peut être douloureuse. Un peu plus loin, il
découvre un vieillard et prend alors conscience que l’éternel présent de l’enfance n’est qu’une
illusion et que le temps fuit. Sa troisième rencontre le met face à face avec un mort que ses
proches conduisent à sa dernière demeure. Le futur Bouddha vient de découvrir la cruauté de la
condition humaine : notre existence est soumise au cours irréversible du temps, et la mort en est
le terme inéluctable. Notre existence est enfermée dans des limites infranchissables – celles du
temps et de la mort.
Pour les bouddhistes, c’est l’« impermanence » qui caractérise le mieux la condition humaine
et la réalité : rien n'est stable, tout change et doit disparaître; il n'existe pas derrière les
phénomènes de substance permanente, mais seulement des combinaisons provisoires de forces.
La vie est évanescente, elle est l'expérience incessante et souvent tragique du changement, de la
disparition, de la mort, de l'usure du temps. Marcel Conche, dans Le destin de solitude, donne
l'exemple de l'être aimé qu'on a rencontré jadis, avec lequel on a vécu une vie durant et qui
disparaît, emporté par la mort : « Mais les jours heureux ont une fin. Et la vie devient
foncièrement triste quand l'être aimé n'est plus. Et comme il n'y a rien d 'autre que cette vie
fugitive qui s'écoule comme de l'eau, il n'y a de secours nulle part » (op.cit., p. 29). La vie se
réduit ainsi à l'irrémédiable fugitivité ; la permanence, disait Montaigne, n'est elle-même qu'un
« branle plus languissant » (in Essais, III, II); sa tonalité fondamentale est la tristesse, « sur
laquelle s'inscrit la joie sans aucunement l'effacer » (Conche, ibid., p. 31).
Mais à quelles réalités le terme d’existence s’applique-t-il au juste ? Quand nous disons qu'une
chose n'existe pas, nous entendons par là qu'elle n'est pas réelle. A contrario, nous affirmons
l'existence d'une chose, c'est-à-dire sa réalité, lorsque nous pouvons la voir, l'entendre, la toucher.
Je parlerai ainsi indifféremment de l’existence du pays où je vis, de celle des êtres qui
m’entourent, etc. Exister, en une première acception, c’est être par opposition au rien, au
néant. Mais quand je dis d’une personne qu’elle n’existe pas vraiment ou qu’à telle ou telle
occasion je me sens exister, quand je suis amoureux par exemple, le sens du mot existence
devient différent de celui d’être : la personne qui n’existe pas vraiment n’est pas rien, elle n’est
pas dépourvue d’être. Dans un second sens, le terme d’existence désigne plutôt une certaine
façon d’être que nous réservons à la réalité humaine. C’est plutôt du sujet que de l’objet que
nous disons qu’il existe ou qu’il pourrait exister : alors que l’objet est, seul l’homme existe. Seul
le rien n’existe pas à proprement parler, car il n’a jamais existé et n’existera jamais. Autrement

Lycée franco-mexicain – Année scolaire 2016-2017 – Cours Olivier Verdun
2
dit, ce qui n’existe pas, le rien, c’est ce qui n’est dans aucun temps, ni présent, ni passé, ni futur.
Ce qui indique qu’exister veut dire être dans le temps. Certes, les choses sont dans le temps,
elles peuvent y perdre ou y acquérir de la valeur. Mais les êtres humains ne sont pas seulement,
comme les choses, dans le temps, elles sont « au temps », c’est-à-dire qu’ils se rapportent au
temps d’une autre façon que les choses, par le biais de la conscience (anticipation, regret,
nostalgie, ennui, espérance, etc.).
Cette conscience qu’a l’homme d’être au temps et de mener une existence précaire peut
donner le sentiment que cette existence est absurde (du latin absurdus, « discordant », de surdus,
« sourd » : qui n’a pas de sens), contingente (du latin contingere, « arriver par hasard », ce qui
n’a pas en soi sa raison d’être), vaine, et ce d’autant qu’elle a pour horizon indépassable la mort.
Mais la perspective de la mort n'invalide-t-elle pas toute entreprise ? Pouvons-nous donner un
sens, c’est-à-dire une signification et une orientation, à notre existence ou n’est-elle qu’une
tentative désespérée pour échapper au temps qui passe ? Où l’on voit qu'exister, pour l'homme, ne
se réduit jamais au simple fait d'être : contrairement aux choses de la nature qui simplement sont
là, seul prend conscience de son existence et pose la question du sens de cette existence :
pourquoi existons-nous ? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?
Cette existence vouée à l'œuvre incessante du temps est d'autant plus problématique que le
concept de temps est pour le moins insaisissable, difficile à définir : il est à la fois une puissance
extérieure, une réalité objective sur laquelle nous n’avons pas de prise et qu’indiquent seulement
les aiguilles d’une montre; en même temps, nous vivons avec lui comme avec une personne à
laquelle nous sommes liés subjectivement; nous ressentons les effets du temps, et dans cette
mesure nous pouvons dire que nous en avons l’expérience, mais une expérience en quelque sorte
du dedans : nous ne pouvons nous écarter du temps pour l’observer, nous n’avons aucun recul
vis-à-vis de lui hormis celui de la réflexion philosophique. Le temps est à la fois évident et
impalpable, substantiel et fuyant, familier et mystérieux : il détruit et construit, destitue et
constitue, en nous menant tout droit à la mort.
L’usage courant du terme temps recèle du reste des confusions et contradictions. Dire « le
temps passe vite » contredit ce que sous-entend l’expression « pendant ce temps » : la première
implique un temps élastique, dont la vitesse est variable ou que nous ressentons comme variable
(aspect psychologique, subjectif du temps); la deuxième sous-entend un temps homogène, le
même pour tous les événements qui se déroulent indépendamment les uns des autres, un temps
objectif, réel, extérieur à nous, dans lequel nous pouvons découper des durées, établir des
simultanéités, etc. Le temps existe-t-il véritablement en dehors de nous-même, de la vie de la
conscience ou de l’âme ? Peut-on véritablement accorder quelque réalité objective au temps ?
I) ETRE ET EXISTER
En premier lieu, exister, est-ce la même chose qu’être ? L’existence se confond-elle avec
l’essence ? Et peut-on déduire l'existence de l'essence ?
A) LA PRIMAUTE DE L’ESSENCE SUR L’EXISTENCE
On peut d’abord envisager la supériorité ou la primauté de l'essence par rapport à l'existence.
Qu’est-ce qui justifie une telle primauté et précellence ?

Lycée franco-mexicain – Année scolaire 2016-2017 – Cours Olivier Verdun
3
A.1) Essence et existence (repère : accidentel/essentiel)
L’existence, nous l'avons vu dans l'introduction, c’est d’abord le fait que quelque chose est
ou existe. Si l'existence et l'être semblent être des termes apparemment équivalents, cette
équivalence est trompeuse : dire d’une chose qu’elle est, c’est poser son existence; dire ce qu’elle
est, c’est définir son essence. L’existence renvoie à l’être, non en tant qu’essence, mais à l’être en
tant qu’il s’oppose au néant. En effet, exister, en ce sens-là, c'est le simple fait d'être, de se
trouver là concrètement. Par opposition, le néant désigne ce qui n'existe pas encore, ou
n'existe plus, ce qui, en tout cas, n'a pas d'être ou de réalité.
On distingue généralement la notion d'essence de celle d'accident : l'essence désigne ce qu'est
un être, sa nature, ce qui le définit, l'ensemble de ses propriétés, indépendamment du fait que cet
être existe, l'accident qualifie ce qui existe non en soi-même mais en une autre chose, ce qui peut
être modifié ou supprimé sans que la chose elle-même change de nature ou disparaisse. La notion
d'essence est alors proche de celle de substance, entendue comme la réalité permanente qui
sert de support aux accidents, qualités, attributs, cela même qui demeure le même tout en
subissant des modifications. Il y a ainsi une différence entre savoir s'il y a ou qu'il y a une éclipse,
et savoir ce qu'est une éclipse.
De ce point de vue, l’essence semble posséder une supériorité sur l’existence, puisqu’elle
constitue la nature permanente et universelle d’une chose : si tel triangle dessiné sur la table
peut cesser d’exister, il n'en est pas de même de l'essence du triangle. Ainsi, selon Platon,
l’existence appauvrit-elle l’essence, le passage du possible (autre nom de l'essence) à la réalité
constitue une déchéance. Donnons un exemple : nos projets, nos espoirs, par exemple, qui se
situent au niveau du possible, sont riches en comparaison de nos réalisations effectives; avec un
billet de $ 500, je puis faire d'innombrables projets d'achat, mais de ces projets je ne pourrai
jamais réaliser qu'un seul; ne pouvoir être qu'une chose à la fois, voilà le drame de l'existence
et on comprend dès lors qu'on puisse la considérer comme une dégradation.
La science, selon Platon, n'a pas pour objet la connaissance de ce qui existe : elle vise au
général et s'intéresse moins à une espèce particulière qu'à un genre englobant des espèces
multiples (aux rongeurs plutôt qu'aux souris, aux vertébrés plutôt qu'aux rongeurs, etc.). Pour que
la science constitue une connaissance du réel, il faut admettre, derrière les caractères individuels
des êtres existants, une essence qui peut se multiplier dans un nombre indéfini d'individus. Ce
n'est pas tant le réel qui est objet de la science que le nécessaire et l'universel,
caractéristiques de l’essence.
A.2) L’existence déduite de l’essence : l’argument ontologique
L'étymologie du mot « existence » (existentia, de sistens, « se tenant », et de ex, « à partir
de ») suggère que l'existence surgit à partir de quelque chose : l’acte de sortir (ex-sistence), le
fait de « paraître », de « se manifester », de « sortir de ». Est-il alors possible de déduire
l'existence, de poser un principe dont l'existence dériverait nécessairement ? C’est dans la
perspective chrétienne de la création ex nihilo qu’est introduite la distinction entre essence et
existence.
Dans la cinquième de ses Méditations métaphysiques, Descartes entend apporter la preuve de
l’existence de Dieu à travers un raisonnement que l’on a qualifié d’« argument ontologique ». Cet
argument consiste, par analyse de la simple notion que j’ai de Dieu, à conclure à l’existence de
l’objet de cette notion – Dieu. Dieu est l’être parfait et son inexistence serait une imperfection,
c’est-à-dire une privation d’être. Dieu est l’être dont l’essence est telle que l’existence ne peut en

Lycée franco-mexicain – Année scolaire 2016-2017 – Cours Olivier Verdun
4
être séparée. L’essence implique l’existence, l’existence est déduite de l’essence. Quand je songe
à un triangle, il se pourrait bien qu'il n'existât nulle part dans la nature une telle figure
géométrique. Cela ne change rien à la manière dont je pense le triangle, aux propriétés que mon
esprit est obligé de lui accorder : je suis obligé d'admettre que la somme des angles d'un triangle
est égale à deux angles droits. Dès lors, par analogie, on peut déduire de l'essence de Dieu qu'il
existe, comme on peut déduire de l'essence du triangle que ses angles sont égaux à deux angles
droits. Inversement, on ne peut pas penser Dieu sans l'existence, comme on ne peut séparer
l'idée d'une montagne de l'idée d'une vallée.
En sorte que l’existence ne constitue qu’un prédicat, qu’un attribue supplémentaire de
l’essence : l’essence de Dieu inclut la perfection, c’est-à-dire l’infinité, la toute-puissance, la
souveraine sagesse et l’existence. Dieu est donc défini comme le seul être qui existe en vertu de
sa seule essence. Les créatures ont une existence dérivée, elles existent littéralement (elles sortent
ou naissent de) à partir de Dieu. Dans cette perspective, l'existence est envisagée comme un
moindre être, puisqu'elle désigne un mode d'être dérivé, second, dépendant de Dieu qui la fait
être.
A.3) La cause ultime de toutes choses
Avec le christianisme, le problème de l’existence surgi avec acuité dès lors qu’il conçoit
l’existence d’une cause génératrice de l’ensemble du réel. Comment l’esprit de Dieu a-t-il pu, dès
lors, faire exister hors de lui l’univers et choisir de le faire exister tel qu’il est ?
Leibniz, dans ses Essais de théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine
du mal (1710), affronte cette question. Dès lors que l’on considère que Dieu est la « première
raison des choses », comment se fait-il que parmi « toute la collection des choses existantes », il
se rencontre beaucoup d’imperfections, à commencer par celle du mal moral (le péché) et du mal
physique (les souffrances) ? Si l’existence a un sens du fait qu’elle est l’œuvre de Dieu – le Sens
du sens -, l’omniprésence du mal dans la création n’annihile-t-elle pas ce sens et ne la rend-elle
pas éminemment absurde ? Comment Dieu a-t-il pu faire un monde traversé par tant de péchés et
de souffrances ? Face au mal, ou bien Dieu, qui est tout-puissant, est coupable d’avoir laissé faire
les meurtriers ; ou bien Dieu n’est pas tout-puissant : est-il possible alors d’envisager la
culpabilité et l’impuissance dans l’idée divine ? Si Dieu existe, sa présence s’impose, s’il refuse
de se manifester, c’est qu’il est immoral et inhumain, il laisse faire, il est complice, il s’est allié à
l’ennemi, à Satan. Or, l’idée d’un Dieu immoral est aussi contradictoire que celle d’un cercle
carré.
Il existe certes une infinité de mondes possibles, mais Dieu, dans sa perfection, n’a pu créer
que le meilleur, le nôtre. Dieu aurait pu créer un autre monde que le nôtre. S'il a créé celui-ci,
c'est qu'il devait le faire. La sagesse de Dieu lui fait connaître le meilleur des mondes possibles,
sa bonté le lui fait choisir et sa puissance le lui fait produire. Ce monde réalise un maximum de
diversité pour un minimum de désordre ; il est celui dont les éléments sont arrangés de façon
optimale, pour réaliser le maximum de bien pour le minimum de mal. Parmi les mondes
possibles, Dieu choisit le meilleur, celui qui contient néanmoins du mal; le critère du choix est
d'avoir « autant de variété qu'il est possible, mais avec le plus grand ordre qui se puisse »
(Monadologie, par. 58). Un monde où le mal n'existerait pas est théoriquement possible, mais
serait moins bon, c'est-à-dire moins varié, moins ordonné que le monde actuel.
La perfection est définie mathématiquement comme le rapport optimal entre l'ordre et la
variété. Une chose est plus parfaite qu'une autre, quand, à proportion, elle offre à l'entendement
une matière plus riche et mieux organisée, quand elle présente à la fois plus de détails et plus

Lycée franco-mexicain – Année scolaire 2016-2017 – Cours Olivier Verdun
5
d'ordre. La sagesse demande la variété : multiplier la même chose, si noble soit- elle, est une
pauvreté (ex. : avoir mille ouvrages bien reliés du même auteur).
Le « meilleur monde » qu’est le nôtre n'est donc pas celui qui est sans mal : un monde
absolument sans mal serait moins riche et moins parfait. Nécessité d'une imperfection
originelle des créatures : si la créature n'était pas limitée, imparfaite, elle serait Dieu lui-même.
Le meilleur des mondes est celui dans lequel un peu de mal permet le maximum de bien. Il
faudrait pouvoir tout voir et bien voir comme Dieu et on ne pourrait manquer de tout vouloir et
de bien vouloir, comme lui, de vouloir ce monde avec tous les maux qu'il comporte. Chaque fois
que nous accordons de l'importance à un mal, nous le faisons d'un point de vue trop particulier,
nous ne comprenons que les effets les plus immédiats de ce mal. Si nous nous élevons à un degré
de généralité plus grand, nous constatons que ce mal permet un plus grand bien. Tout mal est un
moindre mal.
Dieu n’est donc pas responsable du mal présent dans l’histoire; celui-ci ne résulte que de
l’imperfection inhérente à toutes les créatures. Le monde historique est alors, sinon la perfection
impossible, du moins le meilleur qui soit compatible avec l’état de cette créature finie qu’est
l’homme. Du point de vue du Tout, la part de mal que renferme le monde est la plus petite
possible. Seul notre point de vue limité peut nous donner l'illusion qu'un autre monde était
possible, qui eût comporté moins de mal que le nôtre.
Avec la thématique chrétienne de la Création, nous sommes ainsi passés de l’interrogation sur
le fait d’être à la question de ce qui fait être l’ensemble des choses existantes. La question de
l’existence et de son sens renvoie ainsi à celle de Dieu, cause ultime de toutes choses. L’existence
est alors conçue comme un prédicat de l’essence divine. Or n’y a-t-il pas une différence
irréductible entre ce qu’est une chose (son essence) et le fait qu’elle soit (son existence) ?
L’existence, en somme, n’est-elle pas autre que l’essence ?
B) LE PRIMAT DE L’EXISTENCE SUR L’ESSENCE
Il s’agit maintenant de voir en quoi l’existence ne saurait dériver de l’essence et n’a rien à voir
avec elle. Elle correspond plutôt à la position de la chose dans l’être. Exister, c'est être hors de,
c'est jaillir hors de tout système, de toute définition. L'existence est le mode d'être du sujet
individuel. Loin d'être un donné, elle désigne une conquête, un mouvement, un passage.
B.1) L’existence comme présence effective : critique de l’argument ontologique
Kant refuse l’idée que l’existence soit un « prédicat réel », c’est-à-dire une simple
détermination attribuée à la chose. Par exemple, le fait de penser à l’idée de cent pesos ne me
rend ni plus riche ni plus pauvre. En revanche, tel n’est pas le cas si on me glisse un billet de cent
pesos dans la poche : des cent pesos en idée aux cent pesos que j’ai en poche, rien ne change dans
le concept ou l’essence de 100 pesos, en sorte que l’existence n’a rien à voir avec l’essence de la
chose.
Contre Descartes, Kant montre que rien ne saurait fonder la preuve ontologique de l'existence
de Dieu. Il établit que l'existence est une donnée irréductible, qu'elle n'est pas un attribut, qu'elle
n'appartient pas à la sphère de l'essence. L'existence est, dès lors, une position absolue. De l'idée
d'un être parfait, je ne peux donc pas déduire son existence elle-même. L'existence est une
donnée que je peux seulement constater. En critiquant l'argument ontologique, Kant souligne
avec force ce qu'il y a d'original, d'irréductible, de non rationnel dans l'existence proprement dite.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
1
/
25
100%