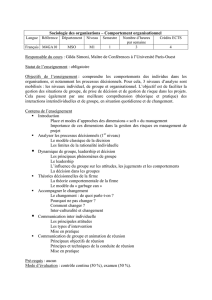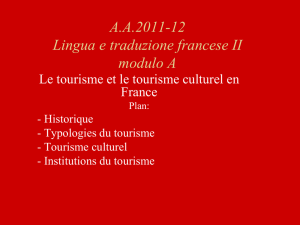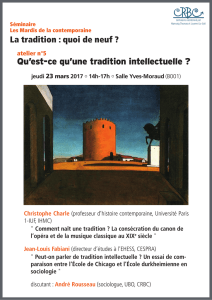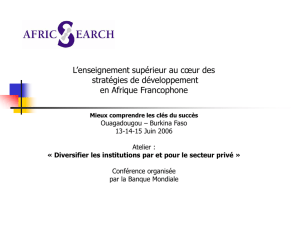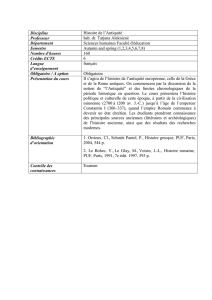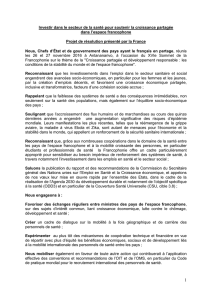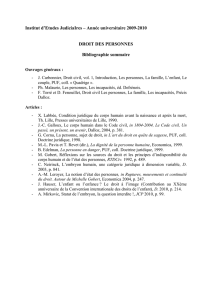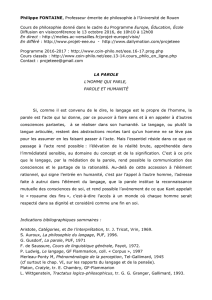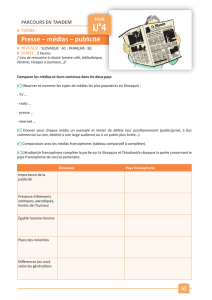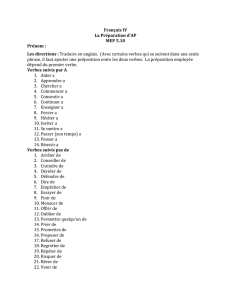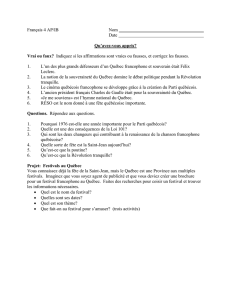Les trois temps de la pensée francophone en économie

2
Les trois temps
de Ia pensée
francophone
en économie du développement'
Philippe
HucoN
La pensée francophone a joué un rôle pionnier en économie du
développement
et elle continue, tant par son champ de rechelstls qus
par son questionnement,
à avoir une place originale dans la théorie
du développement2. Or de nombreux indices montrent que son
rayonnement
tend à se réduire (Jacquemot
1981, Hugon 1989).
Il existe,
au-delà
des débats
internes
à chacune d'elles, rles spéci-
ficités des pensées
francophones
et anglo-saxonnes.
La tradition éco-
nomique anglo-saxonne
est pragmatique, empiriste ou théeds6-sm-
pirique ; elle privilégie I'individualisme méthodologique et les tests
empiriques
et se méfie des grands systèmes
; elle s'intéresse
davan-
tage au comment qu'au pourquoi et à I'analyse du fonctiopement
qu'aux mutations structurelles des sociétés.
*,^.-l-..Unt version développee
de ce texte est parue dans la Revue d'économie politique (lc)gl).
ilous-Ûe_nons
à remercier les membres du GEMDEV et nos collègues
G. Abraham-Frois, E. Assi-
lon' U. Beaud, Ph. Coury, P. Llau, B. Lassudrie Duchêne, S. Quiers-Valette et M. Vernières
pour.
leurs précieuses
rema.rques.
Nous restons
bien entendu responsable
des erreurs que ce texte
condendrait.
* 2- Faut-il rappeler que A. Sauvy est I'inventeur du terme Tiers monde : " Car enfin ce Tiers
ilÏl*'.ig$., exploite, méprisé comme le Tiers État veut lui aussi être quelque choç , (L,obser-
vareur l4l08/54), que Perroux a joué un rôle pionnier dans la conceptualisation du développe-
Ïïtt' que les économisres ingénieurs ont élaboré des méthodes originales de " plmi;1sa1i6n 5
lL ouoç.tt" ". de comptabilité nationale ou de choix de projet ou encore que I'OR,5161V1
çq15-
ulue une structure orisinale de recherche de terra.in.

45
44 Érer nes sAvoIRS
suR LE oÉvnr-oppeMENT
Au contraire, I'arrière-plan culturel de la pensée francophone est
davantage marqué par le cartésianisme,
par une tradition philosophi-
que privilégiant le sens et se méfiant de I'empirisme (de Althusser
à Lévi-Strauss en passant par Barthes, Bachelard
ou Foucault). La
démarche
holiste s'intéresse aux systèmes et aux structures
et elle cher-
che à replacer les évolutions dans une perspective
historique. Dans
la tradition colbertiste, I'Etat est l'agent premier du développement
et le marché n'est pas supposé être autorégulateur. Enfin, I'histoire
coloniale a créé un capital spécifique de connaissances
lié aux mono-
graphies des administrateurs, aux enquêtes de terrain ou aux assistan-
ces techniques dans les anciennes
colonies. L'ensemble de ces fac-
teurs conduit à une pensée relativement spécifique.
Comparée à l'école anglo-saxonne, la tradition économique
fran-
cophone est davantage
critique et philosophique (trouver un sens au
développement), holiste (avoir une vision intégrée), tout en étant
hypothético-déductive (cartésianisme).
Les différentes écoles francophones sont toutefois largement frag-
mentées. Le pôle théorique global et analytique domine dans les ins-
tances universitaires. Le pôle théorico-empirique se trouve chez les
ingénieurs-économistes,
les planificateurs
et les experts. Le pôle anthro-
pologique
chez les chercheurs
de I'ORSTOM, les ONG et les déve-
loppeurs de terrain.
Tout en demeurant spécifique, la pensée
économique francophone
a évolué en relation avec les avancées
théoriques de la discipline et
en liaison avec les principales transformations de l'économie mondiale,
des sociétés du Tiers monde et des relations Nord-Sud.
Nous différencions,
en fonction de ces critères, trois périodes3.
L'essentiel du corpus théorique de l'économie du développement
a été forgé au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale. Les théori-
ciens néo-classiques
et keynésiens
réduisent les problèmes
de déve-
loppement à la théorie de la croissance, aux imperfections des mar-
chés ou au champ de l'économie internationale. Les constructeurs de
l'économie du développement, notarnment francophones, partent au con-
traire de la spécificité des économies sous-développées
pour forger un
corpus différent. Les débats sont alors théoriques et conceptuels.
Vers les années soixante, on constate dans un contexte de décolo-
nisation de I'Afrique, de guerres
de libération nationale, de luttes ou
3. La periodisation est liée aux grandes transformations, telles la reconstruction d'apÈs-guerre,
la décolonisation, la crise des années 70, mais également aux histoires spécifiques de I'Afrique
et des anciennes colonies francophones. Si certains débats liés aux conflits idéologiques sont
pennanents, ils émergent sur le devant de la scène en fonction dês arrières-plans socio-historiques.
Cette périodisation est évidemment simplificatrice et de nombreux travaux chevauchent les périodes.
LA PENSÉE FRANCOPHONE EN ÉCONOVTIS
de guérillas internes, une radicalisation
de l'économie du développe-
ment. A I'inverse, les épigones
réduisent les hypothèses
fondatrices
des théories du développement à la modélisation. Les affrontements
deviennent davantage idéologiques.
Puis dans le contexte de la " crise " du milieu des années
soixante-
dix et de la priorité donnée aux questions
de gestion, on note un cer-
tain rapprochement théorique des courants sur des questions concrè-
tes ; par contre sur le plan de la politique économique, I'universa-
lisme des modèles libéraux contraste avec le particularisme des modèles
alternatifs. Les enjeux sont surtout de politique économique
(Assidon,
1989).
On peut différencier trois grandes périodes permettant de caracté-
riser l'évolution de la pensée:
- le temps de la construction : le débat théorique entre l'écono-
mie orthodoxe et les structuralistes
(1945/50-1960165)
;
- le temps de la radicalisation : les affrontements idéologiques
(r960t65-1975180)
;
- le temps de la gestion : le débat entre la politique orthodoxe
et le développement
alternatif (1975/80-1990).
1. Le temps de la construction (1945/50-1960165)
Les années
d'après-guerre ont conduit à la construction de l'éco-
nomie du développement.
Sur le plan international,
le processus
de
décolonisation
touche I'Asie et I'Afrique ; les Institutions
de Bretton
Woods se mettent en place ; les Nations unies abordent les questions
de la croissance
des pays attardés, de leur industrialisation
ou de la
stabilité des prix des matières premières ; de nouvelles institutions
régionales,
telle la CEPAL, traitent de I'intégration régionale et d'une
stratégie alternative protectionniste et industrialiste.
- La pensee
economique dominante anglo-saxonne
d'après-guerre était
keynésienne
ou classico-keynésienne
lsynthèse
entre la macrô-économie
keynésienne
et la micro-économie
néo-classique
de Hicks, Hansen,
Samuelson...)
; plusieurs
travaux du développément
se situent dans le
cadre des modèles d'accumulation classique
et des modèles post-
keynésiens
de croissance.
Mais de nombrèux ouvrages
abordeni les
spécificités structurelles des pays sous-développés
; les principaux
apports concernent
le dualisme (Boeke, Lewis), la croissance
désé-
quilibrée (Hirschman, Nurske), les effets de remous et de propaga-

46 Érer oes sAvoIRs suR LE oÉvnloppeMENT
tion (Myrdal), la grande
poussée
et les seuils
(Rosenstein
Rodan,
Lei-
benstein, Rostow).
L'économie du développement se constitue
à partir de certaines
contributions
fondatrices,
s'opposant
à la synthèse
classico-keynésienne :
tels l'excédent
structurel
de I'offre de travail, la divergence entre les
prix du marché et les coûts sociaux, le rôle des institutions dans les
comportements, I'importance des séquences entraînantes
et des désé-
quilibres dans le processus
de croissance,
les effets d'asymétrie dans
la spécialisation
internationale...
Le courant institutionnel anglo-saxon se forge dans un univers aca-
démique
où domine l'économie pure. L'économie du développement
francophone
prolonge ces travaux (mais dans
un univers académique
intégrant les institutions). Elle s'élabore en opposition avec (ou en
méconnaissance de) l'orthodoxie officielle, en considérant
que les socié-
tés dualistes
sont désarticulées
et extraverties.
L'économie est partie
intégrante
des systèmes
socioculturels
; les institutions
jouent un rôle
essentiel
; les pouvoirs
et les conflits sont au cæur des
processus
éco-
nomiques
; le développement
économique est un processus
historique
déséquilibré.
Dès lors, le formalisme universel
doit céder la place à
des analyses
plus proches
des conditions
reelles des économies
en déve-
loppement, de leurs norrnes, de leurs valeurs et de leurs structures.
Les spécificités de Ia pensée francophone
La pensée
francophone a occupé une place
originale dans
la cons-
truction du corpus théorique de développement.
Les empires coloniaux constituent alors I'essentiel du champ de
référence et les économistes
participent
au débat lié à la préparation
de I'indépendance, à la mise en place
d'instruments
de politique éco-
nomique au sein des administrations
(comptabilité nationale,
services
statistiques)
et aux possibilités de mise en valeur ou de développe-
ment économique des colonies. [æs principales questions portent sur :
le rôle de I'aide, la suppression
des préférences
impériales,
l'assimi-
lation des " indigènes
", la stabilisation des matières
premières, le plan
FIDES, la zone franc ou le plan. Les principes de l'économie du déve-
loppement
se sont substitués
à ceux de l'économie coloniale
(Harroy,
Moreux, Sarrault...)
mais ils ont poursuivi les recherches sur la ques-
tion coloniale, la mise en valeur ou la coopération.
Les courants
libéraux et marxistes
sont peu développés. La pen-
sée dominante
est alors celle du keynésianisme
de la synthèse qui attri-
bue à l'État un rôle interventionniste
en vue de pallier les défaillan-
LA PENSÉE FRANCOPHoNE EN ÉCONoTrIm 47
ces ou I'inexistence
des marchés.
Cette approche
joue un rôle central
au CEPE (Gruson, Malinvaud, Boiteux) ; l'école de la planification
à la française
(Monet, Masse) conduit à la mise en place dans les
colonies des synthèses de comptabilité nationale, de modèles post-
keynésiens
et de tableaux d'échanges inter-industriels
qui permettent
la régulation étatique. La Caisse centrale de coopération économigue
favorise
la constitution
d'une economie mixte ou d'un capitalisme d'Etat
(Postel
VinaY).
Sur le plan international, la pensée
dominante francophone
est non
libérale (cf. les positions
sur l'aide et le prix des matières
premières
de Mendès
France, Philip, Uri) contre la position " Trade Not Aid ".
La tradition universitaire est humaniste et instin-rtionnaliste
(cf. Byé,
Lebret, Perroux, Philip, Weiller). Analytiquement elle est proche d'un
keynésianisme
renouvelé (Byé et Perroux de la généralisation de la
" general theory "). Elle privilégie le rôle des structures et des dyna-
miques d'encadrement dans le processus
de développement
; elle con-
sidère
que les institutions ont un rôle régulateur face au caractère ins-
table de l'économie de marché.
La pluridisciplinarité et la vision globale du développement
- Plusieurs
éclairages
disciplinaires conduisent à élargir le champ de
l'économie orthodoxe classique,
néo-classique
et keynésienne.
Dans
la tradition de Landry, A. Sauvy (1952) et les démographes
de I'INED mettent en relation le développèment
économique
et les fac-
teurs démographiques.
Ils découvrent
le concept
de transition démo-
graphique.
Ils fondent
la démo-économie
en modélisant
les relations
entre
les variables
démographiques
et économiques
en statique
(modèle
d'opti-
mum) et en dynamique en analysant
les interactions
èntre les variables.
__, !..l9.9pologie rompt avec l'ethnologie coloniale empirique qui
privilégiait l'étude des mentalités primitivès ; elle recherchè
les struc-
tures et met en relation les facteuri économiques
et les relations socia-
les, noûan'ïnent
les systèmes
de parenté
(c. Levi-strauss). L'ORSTOM
Joue' au lendemain
de la Seconde
Guerre mondiale, un rôle original
au.niveau
des recherches
de terrain et de la mise en place
d'une anthro-
lll"gi..9.:nomique. De nombreux
chercheurs
soulignent
I'historicité
lIjî"if,qr, les-..
dynamiques
du dedans
" er fondùt une anthropo-
togle urbaine (cf. Bourdieu ou Balandier) en articulant les dynami-
:::t^^d" " dedans , et du . dehors,, celles qui agissent
à l,intérieur
u€s structures et les réactions externes qui affecient iê devenir des socié-
rcs.

48 Érar oes sAVoIRs suR LE oÉvBLoppnMENT
Dans la tradition des Annales (Bloch, Febvre, Braudel), les tra-
vaux sur le développement
privilégient la longue période et le rôle
des facteurs économiques et de la qualification (cf. chez Bairoch dans
une démarche
d'Histoire comparative)
; la perspective
historique se
démarque des évolutions unilinéaires des Historistes ou de Rostow (du
moins dans sa vulgarisation).
En rupture avec la théorie néo-classique a-spatiale, l'école de l'éco-
nomie régionale française analyse le développement comme un pro-
cessus de polarisation
dans
un espace asymétrique. Dès lors qu'il existe
des inégalités structurelles, les relations de marché amplifient les iné-
galités et ne peuvent être autorégulatrices.
L'analyse " structuraliste ,> et la synthèse de Penoux
(1955, 1962)
Dans le prolongement
de l'institutionnalisme, le courant
< structu-
raliste
" français privilégie les transformations structurellesa.
Le développement
se situe dans la longue durée des structures,
des dynamiques
d'encadrement
; celles-ci
sont liées aux progrès
tech-
niques et aux forces démographiques mais également aux règles du
jeu social et politique et aux mentalités.
Les économistes francophones
du développement se situent, pour
l'essentiel,
dans une démarche
pluridisciplinaire
et refusent le mono-
économisme
; ils intègrent la démographie comme une variable
endo-
gène, ils se situent dans la longue periode historique ; ils ont une repré-
sentation relativiste des sociétés
; ils traitent I'espace comme hétéro-
gène et privilégient les dynamiques spatiales.
L'essentiel des travaux
s'inscrivent dans une vision progressive
du sous-développement
où
l'État peut jouer un rôle central pour promouvoir le dévèloppement.
Les préférences
nationales
de structures sont des tendances
de longue
durée observables par les Nations.
Ce courant " structuraliste
" francophone
s'est constitué après-guerre
à côté des écoles latino-américaines de la CEPAL (Prebisch), suédoise
(Myrdal) et américaine
(Hirschman).
4. La pensée
humaniste
et structuraliste
française
va notamment se diffrrser au sein de I'ISEA
(Cahiers de I'ISEA) (1944) puis de I'IEDES (Revue du Tiers monde 1960 dirigé par Laugier
puis par Perroux) et de I'IRFED (Développement et Civilisation, Lebret). Le terme structura-
liste est utilisé ici pour désigner le courant resituant le fonctionnement des économies dans leur
contexte structurel et analysant le développement en termes de changement institutionnel. Il se
différencie des courants anthropologiques ou marxistes dits structuralistes. Début 60 sont créées
des organisations d'aide au développement (CCFD, Terre des Homrnes, Frères des Hommes).
LA PENSÉE
FRANCOPHONE
EN ÉCONOUIN 49
L'univers sous-développé
est marqué par la coexistence
de sous-
espaces
hétérogènes,
par des coûts élevés de transaction (coûts de recru-
tement,
d'acquisition
de l'information). La théorie du développement
est une théorie des structures.
L'ambition de conceptualisation
de Perroux va au-delà
de I'insti-
tutionnalisme.
Il s'agit, dans
une approche
topologique,
de .. formali-
ser des sous-ensembles en relations
asymétriques
et irréversibles
durant
une période donnée
". Les principaux concepts
utilisés sont ceux d'asy-
métries, de domination, d'irréversibilité, de régulation ou de polari-
sation.
2. Le temps de la radicalisation (1960/65-1975/S0)
A la suite
de Bandoung
et du non-alignement
(1955), les indépen_
dances
de I'Afrique, de certains
pays asiatiques
et des cara'ibes
con-
{uis:1t à une globalisation
des problèmes
et à l'émergence
de la notion
de Tiers monde ou de périphérie. La pensée
dével,oppementaliste
se
radicalise alors sous le nom de tiers-mondisme autoùi des questions
de l'impérialisme, de l'échange
inégal, des exploitations
dei classes
par les bourgeoisies ou les féodalitéi et des luites sociales, avec une
focalisation sur I'Amérique latine (courant dépendantiste).
Les guer-
res liées à la décolonisation
et la révolution chinoise vônt jouer un
rôle important dans la pensée
francophone (cf. Fanon, Sartre, fo. Uur_
pero).
A côté de ce courant émergeant,
demeure
en France la division
entre la tradition analytico-institu-tionnaliste
ou < structuraliste , des tra-
vaux-
universitaires
et les recherches
formalisées,
techniques
et éco-
nométriques des économistes ingénieurs.
,,^,lit affrontements idéologiquL Jouti.rent alors à l,éclatement de
t obJet
de l'économie du dévâoppement.
La pensée radicale : néo-marxisme et dépendantisme
l#ffir***r*l**:ç***fi

50 Éter oes sAvorRs suR LE oÉvnLoppsMENT
les bourgeoisies
" compradores
". Elle dénonce également le discours
dominant des bourgeoisies périphériques sur le volontarisme étatique,
I'analyse privilégiant la politique, le culturel, les mentalités ou le cadre
national et oubliant les luttes des classes.
La pensée francophone est influencée (cf. le rôle de Furtado à
I'IEDES) par le courant latino-américain
; celui-ci, issu de Prebisch,
privilégie I'intégration au capitalisme comme facteur déterminant
du
sous-développement
; il rejette généralement
le projet de modernisa-
tion pour celui de rupture avec I'intégration au marché international
et de substitution des importations. A la périphérie, I'accumulation du
capital sous dépendance technologique favorise la concentration des
revenus
au profit des capitalistes
; il en résulte des distorsions secto-
rielles favorables aux biens de luxe et biens d'équipement
; les acti-
vités fortement capitalistes conduisent à un chômage urbain, à une
hypertrophie du tertiaire et à un manque de débouchés.
Le sous-développement
n'est plus défini comme un retard ou un
écart du développement
mais comme un produit du développement
capi-
taliste. Il n'est plus interprété comme une histoire qui se répète (sous-
développement retard) ou qui est comparée
(sous-développement
écart)
mais comme une histoire qui s'impose avec violence. Sous-
développement et développement ne sont que les deux faces d'une
même réalitê: I'accumulation
du capital à l'échelle mondiale,
l'impé-
rialisme, l'économie mondiale capitaliste.
Trois principaux axes sont développés, dans le cadre des catégo-
ries marxistes : celui externe ou mondialiste
qui privilégie I'accumu-
lation mondiale et I'insertion de la périphérie
dans l'économie mon-
diale ; celui interne
ou anthropologique
qui privilégie une analyse
en
termes de spécificité des modes de production et de leur articulation
et celui praxéologique
en terme de sectionnement
de I'appareil pro-
ductif et de planification de I'accumulation.
Les travaux de Bettelheim sur l'Inde, sur la planification et le sur-
plus ont joué un rôle pionnier. Dans la tradition des travaux de pla-
nification marxistes
(Mahalanobis,
Feldman)
et des analyses en terrne
de surplus (Baran, Sweezy),
un courant marxiste privilégie les régi-
mes d'accumulation à partir d'un découpage du système
productif en
sections
productives.
De Bernis, dans ses travaux sur I'Algérie, prolonge les travaux
de Perroux tout en renouant
avec la tradition marxiste, avec le schéma
d'industrie industrialisante
(De Bernis, 1966).
L'æuvre de Samir Amin constitue
une synthèse francophone de
ces courants dépendantistes
(Amin, l97l) qui fait le pendant
de Pre-
bisch pour le monde latino-américain.
Dans le cadre de I'accumula-
LA PENSEE
FRANCOPHONE
EN ÉCONOUM 51
tion à l'échelle mondiale, il y a blocage
de l'accumulation
à la péri-
phérie
et écart
croissant entre le centre, lieu d'accumulation
du capi-
tal, et la periphérie bloquée
dans son accumulation.
Au centre la crois-
sance
est développement,
c'est-à-dire qu'elle intègre
; à la périphérie
la croissance
n'est pas développement
car elle désarticule
(Amin, l97l).
La permanence des écoles de la première génération
A côté de la pensée
radicale qui domine la scène
dans les débats
tiers-mondistes,
la pensée
francophone du développement
reste large-
ment segmentée
autour des clivages anciens. A. Emmanuel (1969),
auteur
hétérodoxe,
va toutefois
brouiller les cartes
en rejoignant, au-
delà du langage marxiste, la tradition classique
en lançant un débat
dans Ie cadre néo-ricardien sur l'échange inégal tout en renouant
avec
H. Denis avec la question
des débouchés
préalables.
Le maintien de la tradition universitaire o structuraliste ,
et analy
tico-
i n s
titu tionnal
i ste
Le < structuralisme à la française ' domine dans les manuels uni-
versitaires
(cf. Austruy 1965, Freyssinet 1966, penouil 1979, Gen-
darme 1963,
Lambeft lg74). pour Austruy (1965), le développemenr
ne peut être compris que comme un enchaînement
structurei dont le
L:r9.t est Ie pouvoir. Selon Freyssinet (1966) l,économie sous_
oevetoppée
est caractérisée
par la coexistence
durable de deux sec_
Ï:":r,T3q"nistes non intégrès : un secteur traditionnel qui résulte de
ra qeslntégration
du système
pré-capitariste
et un secteur
moderne,
excroissance
des éconômies
câpitalistes
dominantes.
Les travaux de terrains, notamment
ceux consacrés
à l'Afrique,
i:"i:1ïl^gul: lu.tradition
perrouxienne
tout
en intégrant
l,anthropo_
rvË'rc
er les aDDorts
du dualisme
(cf. en France,
Geirdarme
en 1959
3,1-Huson
en't'gog
ou en Belgique
les travaux
de l,université
de Lou-
va'n poftant
pour l'essentier'ru.
r" congo Belge (Dupriez,
staevag-
nen,
Bezy,
Pèemans)).
un apport
àriginài
.on""rne
l,étude
en longue
f,T,T.,j..rprix (H. Dupri#, p";;;;t, le marché
du rravail et le
#:" (G. Dupriez,
Lux) dans'r"" ;d;a;à d. ,"gn,.ntarion
er de dua_
usme
structurel.
"..11_9*Oec, la pensée
économique
sur le développement
est
domi-
ài*::..t-t^stirutionnalisme
er t" .Ëto.rir*e ; les i.àuuu*
théoriques
us .rô$t,* se situent
davantage
dans la tradition structuraliste.
En
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%