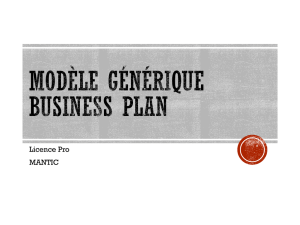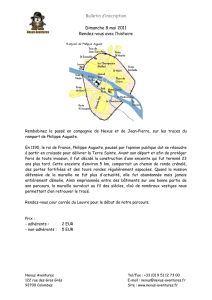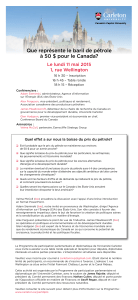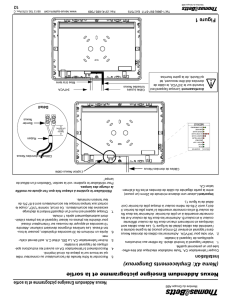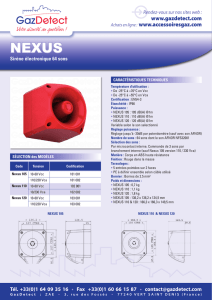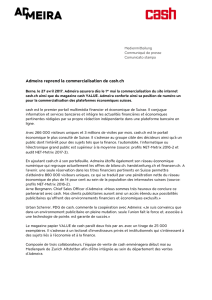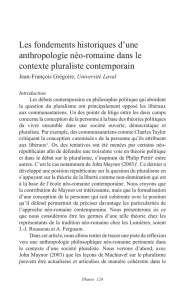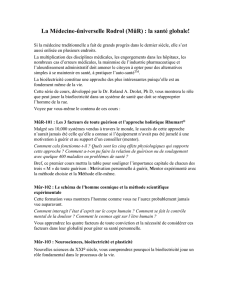Ferguson, un économiste romantique

114
Sociétal
N° 36
2etrimestre
2002
L E S L I V R E S E T L E S I D É E S
Ferguson,
un économiste romantique
MARC FLANDREAU*
Parti pour écrire l’histoire du marché financier
«
global », Ferguson s’engage dans une réflexion
brillante, parfois déroutante, sur la dynamique
des sociétés modernes, l’argent et le pouvoir.
L’économie, dit-il, est une clé nécessaire, mais non
suffisante. La volonté de puissance est le facteur
explicatif prépondérant, la guerre est la matrice
des transformations de la société. Une vision
The Cash Nexus, Money and
Power in the Modern World ,
1700-2000
par Niall Ferguson
Ce Cash Nexus1est le dernier
né de l’un des meilleurs
spécialistes modernes d’histoire
politique et financière internatio-
nale contemporaine. Après The
Pity of War et sa monographie
consacrée aux Rothschild, The
World’s Banker2Ferguson livre là
le résultat de ses dernières
réflexions sur la dynamique
historique du capitalisme dans
le dernier quart du second
millénaire.
Tout a commencé, paraît-il, dans
les couloirs sombres de la Banque
d’Angleterre où l’auteur a été
pendant un an visiteur. Il collecte
alors des données nécessaires à
un projet ambitieux sur l’histoire
du marché obligataire « global ».
Et puis, tout d’un coup, le livre
prend forme, s’élabore, perd de vue
ses objectifs initiaux et devient
autre chose, un drôle d’ouvrage
fait d’histoire, d’économie, de
science politique, de morale et
de philosophie, un étrange essai
qui renoue avec un certain style
de la première moitié du XIXe
siècle, vers lequel les préférences
littéraires de l’auteur vont à
l’évidence.
Par plus d’un aspect, ce Cash
Nexus est un ouvrage « hénaurme ».
En 423 pages sans compter les
notes, annexes statistiques, index,
bibliographie, l’auteur réussit, dans
un style brillant, tumultueux,
toujours divertissant, parfois
confondant, un tour de force. Le
propos n’est rien de moins que
l’exploration du « lien monétaire »
qui unit les hommes et dessine
leur destinée. L’expression, em-
pruntée à Carlyle et analysée
méticuleusement, serait à en-
tendre dans le sens latin de
nectere qui signifie relier. Contre
les déterminismes économiques
« ancie ns » (m arxiste s) et
« nouveaux» (néo-classiques ou
« fukuyamesques » ), Cash Nexus
propose, sinon un modèle (le
terme déplairait sans doute à
Ferguson), du moins de nouvelles
pistes d’analyse, tentant par ce
canal de spéculer sur le devenir de
l’Occident.
Tout compte-rendu qui se res-
pecte devrait permettre, pour ce
type d’ouvrage, de fournir au
lecteur les moyens de « se faire
une idée » en distinguant entre le
fond et la forme, entre le propos
et l’administration de la preuve.
Mais Ferguson a trop les qualités
d’un écrivain pour qu’on puisse
envisager cet exercice. Car la
fibre d’écrivain, surtout dans la
tradition romantique, veut qu’il y
ait une communauté de substance
* Professeur à l’Institut d’études politiques de Paris.
1Niall Ferguson,
The Cash Nexus,
Money and Power
in the Modern
World, 1700-
2000, Londres,
Penguin Books,
2001, 552 pages.
2Commenté par
Luca Einaudi
dans Sociétal,
n° 26, 1999
(ndlr).

115
Sociétal
N° 36
2etrimestre
2002
FERGUSON, UN ÉCONOMISTE ROMANTIQUE
entre l’esprit et l’humeur, entre
la forme et la matière, entre ce
qu’on raconte et la façon dont
on le raconte. De sorte qu’il est
impossible de dire comment
Ferguson démontre si l’on
n’explique pas ce qu’il raconte, et
vice-versa.
S’il reste bien ici et là des
éléments qui évoquent le
projet initial (une histoire du
développement des marchés
financiers globaux), avec
notamment de nombreuses
investigations quantifiées, un peu
cachées en appendice mais
dévoilées aux tournants clés des
principaux chapitres, ou encore
des attaques régulières contre
des ennemis bien repérés et
préalablement salués, l’arme
rhétorique principale s’apparente
à l’attaque-éclair. Comme ces
batteries d’artillerie dont il nous
dit qu’elles gouvernent les desti-
nées du monde, Ferguson bourre
son livre de tous les projectiles
qu’il a pu trouver en chemin. De
Disraeli à Wallerstein, de Carlyle
à Max Weber, d’Hobsbawm à
Lipset, de Tocqueville à Sombart,
de Frank Baum (l’auteur du
Magicien d’Oz) à Braudel, et de
Marx à Ian Fleming, tout le monde
y passe. Tout le monde, c’est-à-dire
le Gotha des auteurs qui ont
traité de pouvoir et d’argent, ce
qui fait beaucoup. Comme à la
fête foraine, Ferguson s’offre avec
bonheur une série de « cartons »,
sans trop s’attarder pour vérifier
s’il a mis dans le mille – il sait bien
qu’en dernière analyse, tout est
affaire d’appréciation.
Et le propos ? Ne cherchons pas
trop un fil directeur : les cartésiens
ne rentreront pas dans leurs frais.
Ainsi, le « carré du pouvoir »,
schéma para-scientifique qui
résume dans l’introduction la
structure institutionnelle et poli-
tique du système britannique
(Parlement, banque centrale,
dette publique, bureaucratie de
collecte des impôts) présentée
comme le socle historique (lui-
même issu de la guerre) du
développement britannique, et la
base du modèle de développement
européen, s’émousse au fil du
livre. Dans la conclusion, il cède
le pas à des « cercles d’intérêt »
imbriqués, où la même structure
est désormais revue du point de
vue de ses acteurs (électeurs,
employés du gouvernement,
pensionnés, contribuables).
Quant à la structure du livre, on
est clairement dans le monde des
jardins anglais, grand lieu commun
des romantiques. Ferguson fait
semblant de justifier ses chapitres
comme des réponses à des
« questions de cours » : « Qu’est-
ce qui détermine le taux payé
par les gouvernements lorsqu’ils
empruntent sur les marchés
mondiaux ? » (chapitre 6). « La
croissance économique est-elle
la cause de la démocratisation,
ou est-ce l’inverse ? » (chapitre 12),
etc. Là, ceux qui achètent en
lisant l’étiquette seront déçus,
car la réponse à la question posée
n’est en général pas donnée :
nombre de chapitres se terminent
comme pendus en l’air, dans
l’ « ever working Chaos of Being »
de Carlyle – et c’est bien mieux
ainsi.
CONTRE TOUS
LES DÉTERMINISMES
En réalité, les chapitres du livre
sont comme autant de variations
sur un thème commun. Contre le
vieux déterminisme marxiste du
primat de l’économie, contre le
nouveau déterminisme néoclassique,
Ferguson propose une autre ma-
nière de lire l’histoire économique
et financière : partant des concepts
de l’économie, qu’il maîtrise à
merveille, il cherche une nouvelle
frontière, plus philosophique peut-
être, en tout cas moins rébarbative.
L’explication économique serait
« nécessaire mais pas suffisante », et
la question du pouvoir se retrouve-
rait intacte, en bout de course.
Donc, l’économie ne serait que
le moyen de la politique (la pour-
suite de la politique par d’autres
moyens ?), et les motivations de
la politique se révèleraient indéci-
dables. Tout au plus pourrait-on,
grâce à l’histoire, suivre ses effets,
qui se manifesteraient par la
guerre. C’est ainsi que Cash Nexus
décrit la formation de l’Etat mo-
derne à partir des conséquences
économiques de ses besoins de
puissance. La conduite de la guerre,
la nécessité qu’elle implique de
brutales levées de ressources, ont
contribué à dessiner ces structures
que l’Angleterre a développées
la première, asseyant ainsi son
hégémonie, et du coup assurant
la propagation de son système à
d’autres pays : l’économie est le
moyen, mais la politique est la fin.
De même,l’évolution des taux
d’intérêt serait explicable d’abord
et surtout par des variables poli-
tiques. Ainsi, Ferguson souligne
l’importance des conflits militaires
dans les convulsions boursières.
À l’inverse, la convergence des
taux d’intérêts nationaux à cer-
taines époques serait interprétable
par l’existence d’un climat politique
moins tendu, ou perçu comme tel.
Au total, non seulement la forme,
mais aussi les vicissitudes finan-
cières des Etats modernes au-
raient toujours été commandées
par la chose militaire.
UN ANTI-ESSAI
Après cette première partie
de Cash Nexus, intitulée
« dépenser et taxer », le livre se
précipite en s’étirant. Le lecteur
qui chercherait la poursuite d’une
démonstration risquerait fort de
s’égarer. L’ouvrage devient une sorte
d’anti-essai, déclinant une série de
négations. Chaque chapitre com-
mence comme un raisonnement
économique qui se déroule selon sa
logique propre, et qui tout d’un coup
grince et tombe en panne.
Premier exemple : sur les structures
institutionnelles du modèle britan-

116
Sociétal
N° 36
2etrimestre
2002
L E S L I V R E S E T L E S I D É E S
pousser vers la conséquence
naturelle de son propos. Si la
guerre est la principale manifes-
tation du pouvoir, si elle est à
l’origine des institutions modernes,
si elle est la machine qui les a
peu à peu transformées, bref si
elle est la matrice du monde, ne
représente-t-elle pas, par voie de
conséquence, sinon notre avenir,
du moins notre frontière ?
Ferguson ne le dit nulle part
clairement, mais nombre de ses
digressions se terminent sur
des tonalités lugubres. Il conclut
en nous laissant avec le Tolstoï
de Guerre et Paix : au second
épilogue, où Tolstoï se met à
« philosopher en rond » sur la
nature de l’histoire, l’auteur de
Cash Nexus nous dit préférer le
premier, où Pierre et Natacha
joignent les mains au-dessus du
berceau de leur nouveau-né,
dans cette « alliance des justes »
contre le mal – alliance qui
n’aurait été rendue possible que
par « la guerre qui résulta de la
Révolution française ». Et les
dernières lignes sur les causes
monétaires de l’échec napoléo-
nien, dont une connaissance
exhaustive, selon l’auteur, nous
serait toujours refusée, nous
confirment dans la conviction
d’avoir bien peud’affinités avec
l’homo oeconomicus – ce « monstre
impossible à rencontrer ». S’il
faut reconnaître en Niall Ferguson
un authentique économiste, il
faut certainement le classer dans
la catégorie des économistes ro-
mantiques.l
la politique économique mais
l’économie de la politique (finan-
cement des partis, des campagnes,
etc.). L’auteur, pessimiste, prédit
que la tendance actuelle, notam-
ment en Europe, à contrôler les
moyens des partis aboutira à une
dérive monopoliste au profit des
partis en place. Avec, comme
conséquence, une aggravation de
la violence.
Faut-il croire que
c’est la finance qui
gouverne le monde ?
Là encore, Ferguson
commence par l’éco-
nomie. Mais, nous
dit-il, celle-ci est le
moyen, pas la cause :
« Dire que les mar-
chés financiers gou-
vernent le monde
revient à dire que le plancton
gouverne la mer ». La globalisation
financière est un processus plus
qu’une volonté, un moyen et non
une fin. En fait, le principal problème
de la finance serait précisément
qu’elle ne gouverne rien. On a
lâché le plancton, mais où sont les
baleines ?
LA GUERRE,
MATRICE DU MONDE
Donc, contrairement au nou-
veau déterminisme exprimé
notamment par Fukuyama, qui
annonce croissance et prospérité
sur fond de démocratie, les
conflits ne disparaissent pas, ils
se transmutent. Et les modalités
de ces transmutations sont régies
par des facteurs qui en fin de
compte sont essentiellement po-
litiques. La construction euro-
péenne, la dynamique du capita-
lisme impulsée par la forme
particulière du système améri-
cain, le problème des nationalités
et des cultures (que la globalisa-
tion révèle plus qu’elle ne les af-
faiblit), tout est politique.
Ainsi, par touches successives,
Ferguson semble vouloir nous
nique, des montagnes de dettes ont
pu s’accumuler. Le talon d’Achille
de ce système fut le caractère
insuffisamment démocratique du
processus d’endettement, puisque
les créanciers de l’Etat n’étaient
pas ceux qui souffraient des hausses
d’impôts. Dans l’entre-deux-guerres,
le problème se compliqua jusqu’à
des seuils insoutenables, au point
que, les rentiers
dévorant le produit
des recettes fiscales,
il fallut les « euthana-
sier ». On rendit
aussi les systèmes de
taxation plus démo-
cratiques de façon
à limiter ce conflit.
Plus récemment, les
besoins des Etats et
les progrès des tech-
niques de défense
des épargnants (fonds de pension,
etc.) ont permis de renouer avec
le mécanisme de suraccumulation
de dettes publiques : en sécurité,
penserait-on ? Non, car chez Fergu-
son, comme chez Braudel, chaque
système a la pathologie de ses
structures. Aujourd’hui, le conflit
potentiel est entre une population
d’électeurs âgés et les myriades
de futurs contribuables, jeunes
ou pas encore nés. Or ceux-ci ne
sont pas électeurs, et le vieux
conflit est voué à renaître, mais
sous une forme nouvelle. La lutte
des classes sera une lutte des
classes d’âge.
De même, on aurait tort de
croire que l’économie gouverne
les élections. L’idée selon laquelle
la popularité d’un gouvernement
serait directement reliée à la
situation économique est battue
en brèche à coups de contre-
exemples. La corrélation entre le
taux de croissance, le taux d’intérêt
et les résultats du gouvernement
en place, ou sa cote de popularité,
est toujours instable, parfois
contre-intuitive, en tout cas sus-
ceptible de retournements. En fait,
nous dit Ferguson, le Cash Nexus
est ailleurs : l’important n’est pas
Aujourd’hui, le
conflit potentiel est
entre une population
d’électeurs âgés
et les myriades de
futurs contribuables,
jeunes ou pas encore
nés.
1
/
3
100%