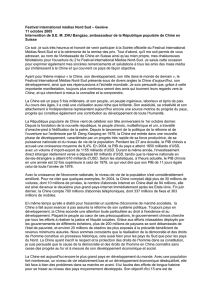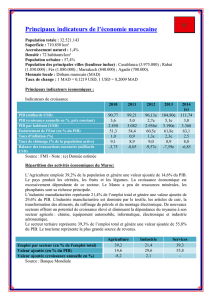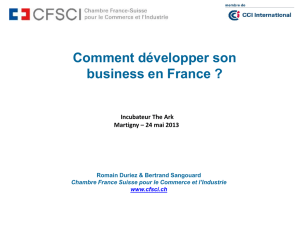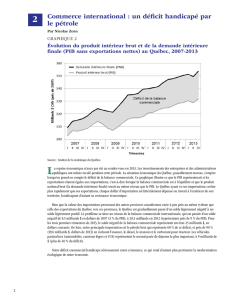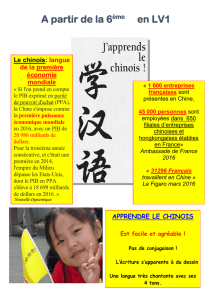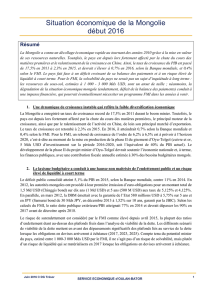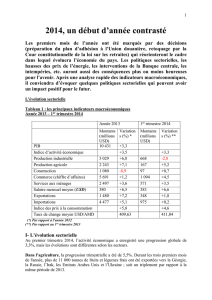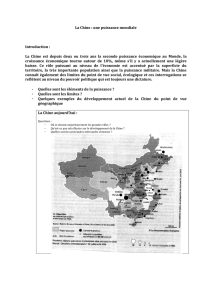Les comptes extérieurs chinois : transition et transformation

Les comptes extérieurs chinois :
transition et transformation
Christine Peltier
Les comptes extérieurs chinois connaissent des
changements importants depuis quelques années. Les
excédents courants se sont réduits, sont désormais
proches de 3% du PIB et ne dépendent plus seulement
de l’évolution des exportations de marchandises. Les
entrées nettes d’investissements directs diminuent, les
épisodes de fuites de capitaux se répètent, et le rythme
d’accumulation des réserves de change ralentit. Enfin,
la présence de la Chine sur la scène financière
internationale s’accroît. Les évolutions du compte
courant et du compte financier de la balance des
paiements sont étroitement liées aux changements en
cours du modèle de croissance chinois et au processus
de libéralisation des mouvements de capitaux. Quelles
en sont les implications sur les dynamiques de liquidité
et de solvabilité externes, et sur la conduite de la
politique macroéconomique du pays ? Alors que Pékin
souhaite que le renminbi soit intégré dans le lot de DTS
(Droits de Tirage Spéciaux) du FMI d’ici la fin de
l’année, la Chine a-t-elle intérêt à accélérer le processus
d’ouverture de son compte de capital ? 1
De moindres excédents courants
La balance des transactions courantes de la Chine a
connu des transformations depuis 2008. Les excédents
dégagés se sont nettement réduits et leur composition
s’est modifiée, conséquences de l’évolution du modèle de
croissance du pays. Alors que la progression des
échanges de marchandises a perdu de sa vigueur dans
un environnement mondial devenu moins porteur, la
montée en gamme des produits exportés s’est poursuivie,
et les activités d’assemblage de produits importés et de
réexportation ont perdu leur rôle de principal moteur de la
performance du commerce extérieur. En outre, alors que
l’évolution de la balance des paiements courants a
longtemps suivi de près celle de la balance commerciale,
ses autres composantes ont gagné en importance depuis
2010, signe cette fois de l’accroissement des transactions
des agents résidents chinois avec le reste du monde.
Excédent courant, épargne et investissement : quelques
signes de rééquilibrage
L’excédent de la balance des transactions courantes
atteignait des records historiques à la veille de la crise
financière internationale de l’automne 2008. Il s'est
fortement réduit dans les trois années qui ont suivi,
passant de 9,2% du PIB en moyenne sur la période
2006-2008 à 1,8% en 2011. Cette baisse est allée de
pair avec la très forte augmentation des ratios
d’investissement, encouragée par le plan de relance
introduit fin 2008 pour contrebalancer les effets de
l’effondrement du commerce mondial (cf. graphique 1).
Sur la période 2012-2014, en revanche, l’excédent
courant a oscillé entre 1,5% et 2,5% du PIB, les taux
d’investissement et d’épargne nationale se réduisant de
concert. Ces évolutions semblent signaler un début de
rééquilibrage des sources de la croissance, dans un
contexte de ralentissement de l’économie (i.e. la
contribution de l’investissement à la croissance se réduit
au profit de celle de la consommation, qui augmente
parallèlement à la baisse du taux d’épargne des
ménages). D’une part, la progression de l'investissement
a fléchi, en raison de l’atonie de la demande mondiale,
mais aussi sous l'impulsion des autorités. Celles-ci ont
mis en œuvre des mesures visant à réduire certaines
distorsions du modèle de croissance : resserrement des
conditions de crédit en réponse à l'excès de dette interne,
resserrement de la politique immobilière pour encourager
une correction d'un marché en surchauffe, réduction des
capacités de production dans les secteurs industriels en
surcapacité. D'autre part, des réformes ont été introduites
depuis 2011 pour encourager une baisse de la
propension à épargner des ménages et ainsi stimuler la
consommation privée2.
Juillet-Août 2015 Conjoncture 21

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
30
35
40
45
50
55
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Investissement
Epargne nationale
Excédent courant
% du PIB
Graphique 1
Excédent courant, épargne et investissement
Sources : FMI, projections BNP Paribas
% du PIB
p
p
-10
0
10
20
30
40
50
60
2007 2009 2011 2013 2015
Manufacturier
Immobilier
Minier
Infrastructure
Graphique 2
Investissement par secteur :
en valeur, cumul sur l'année, g.a., %
Source : CEIC
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
% du PIB Milliards USD
Graphique 3
Balance commerciale
Source : SAFE
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Prix à l'exportation
Prix à l'importation
Termes de l'échange
2002=100
Graphique 4
Termes de l'échange de la Chine
Sources : FMI, SAFE, BNP Paribas
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Exportations en valeur
Exportations en volume
Importations en valeur
Importations en volume
Variation annuelle, %
Graphique 5
Evolution du commerce extérieur
Sources : FMI, SAFE
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
0
50
100
150
200
250
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Indice des prix des matières premières (2005=100)
Commerce mondial, variation en volume, %
Graphique 6
Environnement international
Source : FMI
Juillet-Août 2015 Conjoncture 22

Ces baisses parallèles des taux d’épargne et
d’investissement devraient continuer à moyen terme,
dans l’hypothèse où le processus de rééquilibrage du
modèle de croissance se poursuit. Les excédents
courants pourraient donc se maintenir à un niveau
relativement stable, autour de 3% du PIB, dans les
prochaines années.
Pour 2015, toutefois, la réduction du taux
d’investissement s’annonce particulièrement
prononcée, et l’excédent courant devrait augmenter
pour s’établir entre 3,5% et 4% du PIB sur l’ensemble
de l’année (contre 2,1% en 2014). Ces évolutions sont
moins le signe d’un rééquilibrage contrôlé et orchestré
par les autorités, que celui d’une sévère aggravation
de la correction à la baisse de l’investissement après
plusieurs années de surinvestissement et
d’endettement excessif. Le récent recul de
l’investissement a, en effet, principalement touché les
secteurs souffrant de capacités de production
excédentaires et/ou très dépendants du crédit, tels que
les activités minières, métallurgiques et immobilières
(cf. graphique 2).
Echanges commerciaux : des évolutions dictées par
l’environnement international et des facteurs internes
Après cinq années d’augmentation spectaculaire,
l’excédent de la balance commerciale chinoise s’est
contracté de 30% pendant la crise de 2009 pour s’établir
à USD 250 milliards, ou 4,9% du PIB (cf. graphique 3). Il
est resté relativement stable en valeur en 2010-2011 (et
en légère baisse en pourcentage du PIB), puis est
reparti à la hausse depuis 2012, mais les ressorts de
cette progression ne sont plus les mêmes que ceux qui
prévalaient pendant la période d’avant-crise.
Sur la période 2004-2008, l’expansion de la base
d’exportations, accompagnée d’une accélération plus
modérée de la croissance des importations, a permis
une hausse rapide des excédents commerciaux alors
même que les termes de l'échange se dégradaient
(augmentation rapide des prix à l'importation,
partiellement compensée par celle des prix à
l'exportation). Inversement, depuis 2012, la hausse des
excédents commerciaux dérive principalement de
l’amélioration des termes de l'échange liée à la chute
des prix à l'importation, alors que la progression des
volumes de biens échangés a fortement fléchi (cf.
graphiques 4 & 5). Simultanément, la composition des
échanges extérieurs a évolué.
Les raisons de ces évolutions sont à la fois
externes et internes. Premièrement, l’environnement
mondial a changé (cf. graphique 6). La croissance
des échanges commerciaux internationaux s’est
essoufflée entre la période des cinq années
précédant la crise de 2009 et la période 2012-2014,
ce qui a pesé sur la progression des volumes
d’exportations (et donc d’importations) de
marchandises de la Chine. Ses exportations n’ont ainsi
augmenté que de 7,6% par an en moyenne sur la
seconde période, contre 20% au cours de la première.
Dans cet environnement externe beaucoup moins
porteur, les prix des matières premières sont restés
orientés à la baisse depuis 2012, profitant largement
aux prix à l’importation chinois. Les matières
premières (hydrocarbures, produits miniers et
agricoles) ont en effet un poids considérable dans les
importations du pays puisqu’elles représentaient un
tiers du total en 2014 (ou 44% des importations
"ordinaires", qui excluent les biens importés pour
l’assemblage et la réexportation), contre 22% en 2005.
Deuxièmement, l’évolution du commerce extérieur
souligne certaines transformations du modèle de
croissance chinois, tant du point de vue de la demande
que de celui de l’offre. D’une part, le ralentissement
marqué de l’investissement a aggravé l’affaiblissement
de la progression des volumes d'importations, passée
de 13,6% par an en moyenne en 2004-2008 à 7,8% en
2012-2014. Cette dynamique a elle-même constitué un
facteur clé de la tendance baissière des prix mondiaux
des matières premières, étant donné le poids de la
Chine dans la demande mondiale3. Volumes et prix des
importations chinoises sont donc corrélés. D’autre part,
la hausse des prix à l’exportation de la Chine a limité
l’augmentation de ses parts de marché. L’industrie a
toutefois su faire évoluer son offre pour s’adapter à la
perte de compétitivité prix (cf. infra).
Les tendances observées depuis 2012 se sont
accentuées en 2015. L’excédent commercial s’est
encore élargi, atteignant USD 118 milliards au T1 2015
contre USD 40 milliards sur la même période en 2014.
La Chine a bénéficié d’un choc positif sur les termes de
l’échange grâce à la chute des prix des matières
premières alors que les volumes d’importations ont
continué de fléchir sur fond de ralentissement de la
demande interne. La performance des exportations est
quant à elle restée médiocre en raison d’une demande
mondiale toujours faible et de l’appréciation du yuan en
termes effectifs.
Juillet-Août 2015 Conjoncture 23

L'industrie exportatrice souffre…
Au cours de la dernière décennie, la hausse des
coûts des facteurs de production du secteur
exportateur et l’appréciation continue du yuan ont
entretenu l’augmentation des prix à l’exportation, en
termes absolus mais aussi relativement aux
principaux concurrents et partenaires commerciaux.
La tendance à la hausse a été interrompue par la
crise de 2009, pour repartir dès 2010. Elle a
néanmoins pris un tour plus modéré en 2013-2014.
Un certain nombre d’entreprises ont ainsi baissé
leurs marges pour maintenir leurs parts de marché,
ainsi que répercuté la baisse des prix de l’énergie et
des prix industriels dans leurs coûts de production.
Néanmoins, la perte de compétitivité prix du secteur
exportateur chinois devrait se poursuivre dans les
années à venir sous l’effet de facteurs structurels.
Des distorsions longtemps présentes dans
l’industrie ont garanti le maintien d’une forte
compétitivité-prix des exportations de biens
manufacturés 4. La situation a considérablement
changé depuis quelques années, avec le
renchérissement de la main d’œuvre, mais aussi
l’augmentation des prix des terrains et la montée des
coûts liés à la réduction de la pollution et à la
protection de l’environnement. L’augmentation du
salaire moyen est restée soutenue tout au long de la
dernière décennie (+13,5% par an en moyenne en
termes nominaux et +11,6% en termes réels).
Cependant, alors que les salaires réels et la
productivité évoluaient de façon parallèle jusqu’en
2008, le lien s’est nettement distendu dans la période
d’après-crise. La progression des salaires réels a
fléchi (+8,6% par an depuis 2010), mais dans une bien
moindre mesure que celle de la productivité
(phénomène imputable à la détérioration de
"l’efficacité" de l’investissement et du crédit, qui
témoigne des limites du modèle de croissance
chinois).
En conséquence, la hausse du coût salarial
unitaire a accéléré depuis 2011, signe d’une perte de
compétitivité-coût de l’économie chinoise (cf.
graphique 7). Sur la période 2011-2014, il s’est accru
de 13% par an en moyenne en monnaie locale,
contre 6% en 2004-2008. Etant donné l’appréciation
continue du yuan, le coût unitaire salarial mesuré en
US dollars a augmenté encore davantage, de 10%
par an en moyenne en 2004-2008 et de 16% en
2011-2014.
0
5
10
15
20
25
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
En monnaie locale
En USD
CSU, gliss. annuel %
Graphique 7
Coût salarial unitaire de la Chine
Sources : NBS, BNP Paribas
La poursuite de cette dynamique semble inévitable,
sous l’impulsion des autorités (la hausse de la part des
salaires dans le PIB doit participer au processus
d’expansion de la consommation des ménages) et du
fait d’une contrainte démographique grandissante : la
population active d’une part, et l’excédent de travailleurs
ruraux prêts à venir travailler dans l’industrie d’autre
part, vont commencer à décliner, tirant un peu plus les
salaires à la hausse5.
La hausse des coûts salariaux unitaires devrait donc
rester soutenue à court-moyen terme. L’écart entre
l’augmentation des salaires et les gains de productivité
devrait en effet persister, en attendant les effets positifs
des réformes structurelles déjà initiées ou envisagées
par les autorités (libéralisation financière,
restructurations industrielles, innovation technologique,
rationalisation du secteur public, amélioration des droits
de propriété et de la mobilité des travailleurs…).
… mais se transforme
La perte de compétitivité-prix de l’industrie exportatrice
a commencé à ralentir ses gains de parts de marché pour
certains produits, voire à lui en faire perdre dans les
secteurs à plus faible valeur ajoutée (par exemple dans le
secteur de la chaussure, cf. graphique 8). Mais elle a
également été accompagnée d’une réduction de la part des
activités de processing en Chine (i.e. assemblage de
produits semi-manufacturés et de réexportation) et de
montée en gamme de ses exportations. La part du
processing est ainsi passée de 55% des exportations et
41% des importations en 2005, à 38% et 27%,
respectivement, en 2014. Ce mouvement, qui va de pair
avec une baisse du contenu en importations des exportations
de marchandises, participe également au ralentissement
tendanciel des importations.
Juillet-Août 2015 Conjoncture 24

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Chine Chine + Hong Kong Asean-5
Graphique 8
Parts de marché mondial :
Chaussures
Sources : Comtrade N.U., BNP Paribas
% du total des exportations mondiales
Simultanément, le secteur industriel, soutenu par les
autorités, a développé des stratégies pour s’adapter à la
hausse de ses coûts de production. La montée en
gamme des biens exportés (que ce soit dans les
secteurs du processing ou non) est la première d’entre
elles. Ceci est illustré par l’évolution de la composition
des exportations au cours de la dernière décennie,
avec, par exemple : une hausse de la part des
équipements de télécommunication et plus récemment
de celle des produits électroniques, et une baisse de la
part des vêtements et textiles et plus récemment de
celle des machines de bureau (cf. graphique 9).
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
% du total des exportations chinoises
Graphique 9
Composition des exportations chinoises,
principaux produits
Sources : OMC, BNP Paribas
Circuits et composants électroniques
Matériel de transport
Equipements de télécommunication
Machines et appareils de bureau
Vêtements et textiles
A ceci s’ajoute une réorganisation géographique de
la production : les régions côtières à l’est restent le
centre économique du pays (à l’origine de la moitié du
PIB en 2013) et accueillent les entreprises les plus
avancées en termes de montée en gamme. Dans le
même temps, certaines industries ont relocalisé leurs
activités de production de biens à moindre valeur
ajoutée dans les régions de l’intérieur où les coûts
salariaux sont moins élevés. Par exemple, la part des
régions de l’est dans la production nationale avait déjà
baissé de 89% en 2005 à 77% en 2011 dans le secteur
de l’habillement, et de 84% à 74% dans le secteur des
machines et appareils électriques, au profit notamment
des régions du centre6.
Les autorités ont été proactives pour accompagner
les changements dans la structure de production de
l’industrie, notamment via le développement des
infrastructures, la hausse des dépenses en R&D (2% du
PIB en 2012 contre 1,3% en 2005) et l’élévation du
niveau d’enseignement (17% de la population avait un
niveau d’éducation tertiaire en 2012, contre 9% en
2005).
Pour quelques années encore, la Chine devrait
conserver sa place de leader mondial pour un bon
nombre de biens industriels. Elle dispose tout d’abord
d’une position encore ultra dominante dans de
nombreux secteurs (40% du marché mondial des
vêtements et des chaussures en 2013, 38% du marché
des machines de bureau ou encore 20% du marché des
appareils et machines électriques), qu’elle peut
entretenir grâce à la relocalisation de sa production vers
des régions à plus bas salaires. Elle poursuit dans le
même temps sa montée en gamme pour gagner des
parts de marché dans des secteurs à plus haute valeur
ajoutée (par exemple dans le secteur des machines et
appareils électriques, cf. graphique 10). En outre,
l’industrie chinoise bénéficie d’une productivité encore
élevée malgré sa récente détérioration (notamment par
rapport aux pays potentiellement concurrents d’Asie du
sud-est), et d’une compétitivité hors prix très solide.
Ainsi, la Chine est 28ème sur 160 pays dans le
classement de la Banque Mondiale notant les
performances de la logistique7.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Chine Chine + Hong Kong Asean-5
Graphique 10
Parts de marché mondial :
machines et appareils électriques
Sources : Comtrade N.U., BNP Paribas
% du total des exportations mondiales
Juillet-Août 2015 Conjoncture 25
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%