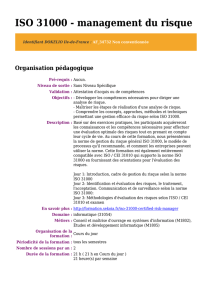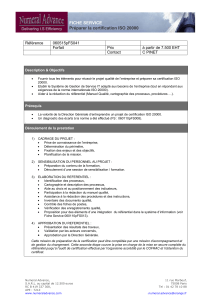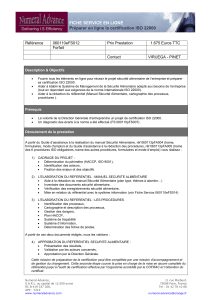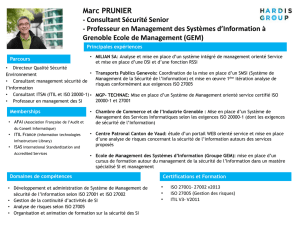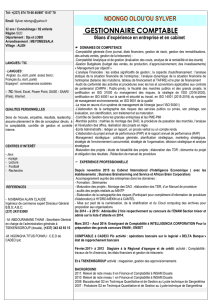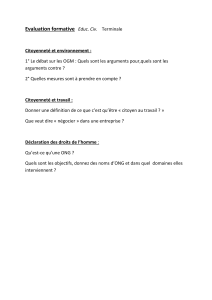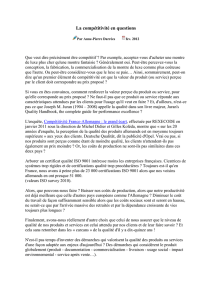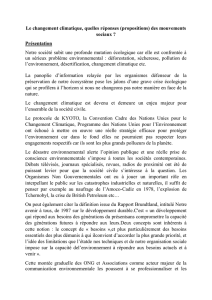ONG et management fondé sur la qualité: terre des hommes ou terre

Itinéraires
institut universitaire
graduate institute
d’études du développement
of development studies
iuéd
genève
ONG et management fondé
sur la qualité. Terre des hommes
ou terre des normes ?
Justine ROSSELET
Etudes du développement no19
Sculpture en céramique et photos de Claude Albana Presset, Rivière, 2004.


ITINÉRAIRES
Etudes du développement
nº 19
ONG et management
fondé sur la qualité :
terre des hommes
ou terre des normes ?
Justine ROSSELET
© iuéd, septembre 2003
CHF 12.–
INSTITUT UNIVERSITAIRE D’ÉTUDES DU DÉVELOPPEMENT
Service des publications
Case postale 136 – CH-1211 GENÈVE 21

Mémoire de diplôme d’études supérieures (DES) en études du développement,
présenté en décembre 2002.
Directeur de mémoire : Gilbert RIST
Jury : Christophe DUNAND, directeur de Réalise

5
Table des matières
Avant-propos 7
Introduction 9
Première partie
Les normes ISO 15
L’origine historique des normes ISO 15
Au début du siècle : Taylor et l’industrie de l’armement 15
Les transformations du capitalisme 21
L’internationalisation de la qualité et la création de l’ISO 22
Les personnes à l’origine de la norme qualité 23
La définition des normes par l’ISO 24
Fonctionnement de l’ISO et aperçu des différentes normes 26
La norme qualité, principes et exigences 28
Les présupposés de la norme qualité 30
La qualité, norme supposée idéale et universelle 31
L’homme intéressé 32
Le marché comme seul modèle de société possible et souhaitable 32
« Plus » est égal à « mieux » 33
La technique et le progrès comme solutions 34
Les valeurs qui fondent les normes 36
La norme, un enjeu de pouvoir et de contrôle 36
Commentaire critique 38
Seconde partie
Le discours des ONG sur la certification 43
Présentation des organisations et des personnes interrogées 43
Exigence économique 44
Recherche d’efficacité 44
La qualité 45
Exigence politique 46
Recherche de distinction 47
Enjeu : la crédibilité sur un marché saturé 47
Les avantages 48
Les inconvénients 49
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
1
/
76
100%