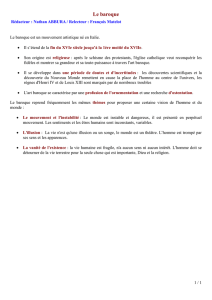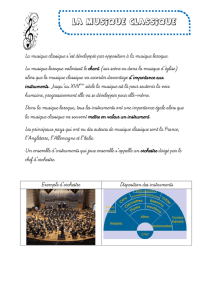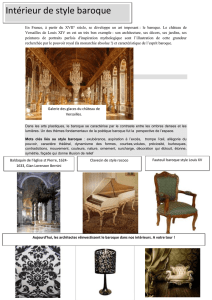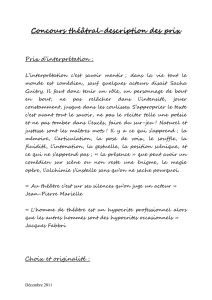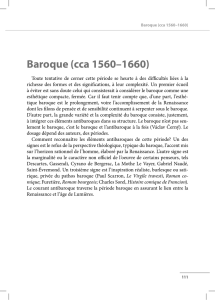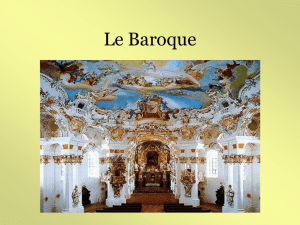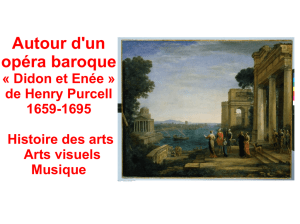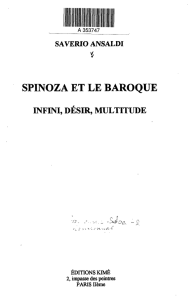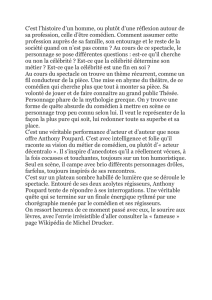La scénographie du théâtre baroque en France : quand le

La scénographie du théâtre baroque en France :
quand le comédien n’était pas enfermé dans une cage
par
Anne Surgers
et
Fabien Cavaille
« De weereld is een speeltooneel –
[Le monde est un théâtre]1 »
Joos VAN DEN VONDEL
Le présent article a été travaillé et écrit à quatre mains, il
comporte deux parties, abordant la question de l’espace théâtral du
premier XVIIe siècle en suivant deux lignes différentes. Pour
contribuer à une plus juste compréhension du théâtre baroque, il
nous semble en effet souhaitable de réfléchir sur le théâtre dans
son ensemble : à la fois les mots écrits pour être joués par des
corps dans un lieu ; le spectacle reçu par d’autres corps,
l’assistance ; enfin la représentation incarnée se nourrissant de
lieux de mémoire, appelée à devenir, à son tour, image de
mémoire. Notre participation à une étude globale du théâtre du
XVIIe siècle consiste en l’interprétation d’une maquette du Théâtre
du Marais, construite à partir des contrats de charpenterie passés,
en 1644, entre la propriétaire du jeu de paume du Marais et la
troupe de Le Noir, pour réaménager le lieu en théâtre. Nous avons
souhaité voir dans l’espace et en volume les conditions qui
président à la scénographie, au jeu des comédiens et à leur
réception.
1 Joos Van Den Vondel, sentence peinte sur l’architrave de la porte
d’entrée du Schouwburg d’Amsterdam, 1637.

LA SCÉNOGRAPHIE DU THÉÂTRE BAROQUE
93
I.
Conditions scénographiques d’un théâtre-emblème.
Du modèle parisien au modèle européen
À l’âge baroque2, jusque dans les années 1670, l’action que
nous nommons « entrée en scène » était conçue, pensée et désignée
comme une « sortie ». Les textes de théâtre et les didascalies en
attestent. En d’autres termes, depuis le début du XVIIIe siècle, notre
conception – et notre perception – du lieu de la représentation se
sont retournées comme un gant : le système qui fonde la
représentation baroque est à ce point étranger à notre pensée
contemporaine que nous avons des difficultés à comprendre qu’une
entrée en scène ait pu être considérée comme une sortie. En
2 Pour éviter les malentendus et parce qu’en France l’emploi du mot
provoque encore des débats, parfois âpres, je souhaiterais préciser
d’entrée de jeu dans quel sens sera entendu le mot « baroque » dans le
présent article. Au XVIIe siècle, l’adjectif « baroque » n’était employé
qu’en joaillerie, à propos de perles « qui ne sont pas parfaitement
rondes » (Furetière). Par extension, la notion d’imperfection et
d’irrégularité a progressivement contaminé le sens premier. Ainsi,
l’édition de 1878 du Dictionnaire de l’Académie entérine l’acception
morale de l’adjectif : « baroque » signifie alors « irrégulier, bizarre,
étrange. Il se dit des choses physiques et des choses morales ». Dans son
ouvrage Der Cicerone paru à Bâle en 1860, Jakob Burckhardt choisit
l’adjectif « baroque » pour désigner une période de l’histoire de l’art
s’étendant environ de la Contre-Réforme au milieu du XVIIe siècle,
période succédant à la Renaissance et précédant la réadoption des
« règles » de l’architecture antique. Le choix du mot « baroque » est le
reflet tant d’un jugement de valeur dépréciatif que d’une histoire de l’art
et de la pensée établies en fonction du postulat qu’il y aurait « progrès »
et « amélioration », à partir du moment où seraient respectées les règles
de l’architecture antique, celles de la perspective linéaire déduite de la
géométrie d’Euclide et celles de la poétique aristotélicienne. Malgré les
écueils que le mot recèle, nous emploierons ici « baroque » pour désigner
un courant de pensée, dont le spectacle a été l’une des expressions
privilégiées, et qui s’est développé en Europe, dans la seconde partie du
XVIe siècle et les deux premiers tiers du XVIIe siècle environ.

ANNE SURGERS ET FABIEN CAVAILLE
94
France, même les traces textuelles en ont été effacées dans les
différentes rééditions, jusqu’à la fin du XXe siècle3.
D’autres préjugés obscurcissent notre compréhension : depuis
le XVIIIe siècle, les écoliers, les étudiants et les enseignants français
ont été nourris de la pensée néo-aristotélicienne, à qui l’on doit le
retour aux règles et à l’unité « classiques », après les désordres
« baroques » de la première partie du XVIIe siècle. La conséquence
directe de ce jugement de valeur érigé en vérité est la dépréciation
des auteurs, des acteurs et de la représentation qui avaient précédé
le retour à l’ordre. On entend encore dire, par exemple, qu’en
France les comédiens s’installaient au hasard dans des lieux
d’emprunts, des tripots mal famés, que l’exiguïté de la scène
condamnait les acteurs à une quasi-immobilité, frontale de surcroît,
ou que le décor à compartiments était de pure convention. Pour
contribuer à démêler le vrai du faux nous proposons une étude
s’appuyant sur des sources contemporaines de l’objet étudié4. Dans
la première partie de l’article, nous nous intéresserons au lieu de
représentation, à son architecture, à sa composition, à son
organisation spatiale, et à son décor. L’étude part du dessin pour
comprendre le dessein, puisqu’au XVIIe siècle les deux mots étaient
encore homophones et homographes. À partir de la maquette, nous
proposons une visite archéologique dans un jeu de paume aménagé
en théâtre, à Paris, en 1644, cas particulier présentant tous les
3 Pierre Pasquier m’a offert de travailler sur ce sujet, dont il avait, avant
moi, pressenti l’ampleur : qu’il trouve ici l’expression publique de ma
gratitude et de mon amitié. Mes remerciements vont aussi à Gilles
Declercq, qui m’accompagne dans cette recherche et à Fabien Cavaillé,
pour les longues heures de travail partagé, de doutes, de conversions
laborieuses et de découvertes échangées ou faites en commun, avec joie
[A.S].
4 En particulier grâce à Wilma Deierkoff et Alan Howe, qui ont eu la
patience de dépouiller les archives des notaires, des comédiens, des
maîtres paumiers parisiens, pour retrouver aux Archives nationales des
traces tangibles de la vie théâtrale baroque. Wilma DEIERKAUF-
HOLSBOER, Le Théâtre du Marais, Paris, Nizet, 1954, tome I ; Alan
HOWE, Le Théâtre professionnel à Paris, 1600-1649, Paris, Centre
historique des Archives nationales, 2000.

LA SCÉNOGRAPHIE DU THÉÂTRE BAROQUE
95
caractères d’un type plus général, puis nous traduirons en mots ce
qu’écrivent dans l’espace les lignes de construction de la salle et de
la scène, la répartition des lieux, des places, des territoires, pour
proposer une interprétation : se dégagera alors le lien essentiel qui
unit la représentation du théâtre baroque à d’autres représentations
contemporaines, en particulier à l’emblématique5.
1. Un jeu de paume aménagé en théâtre, à Paris, au milieu du
XVIIe siècle
Nous avons travaillé à partir d’un mémoire conservé aux
Archives nationales à Paris, publié par Wilma Deierkauf, puis par
Alan Howe. Ce mémoire a permis de proposer une restitution en
maquette du jeu de paume du Marais et des aménagements que la
propriétaire y fit faire après l’incendie de 1644, à la demande des
comédiens. Ce travail d’archives et de maquette montre que le jeu
de paume est un bâtiment prestigieux : avant d’être un théâtre, il
accueillait ceux qui s’exerçaient au « Roi des jeux »6. En ville, il
est l’un des lieux de divertissement de l’aristocratie,
particulièrement dans le quartier du Marais au début du XVIIe
siècle : Henri IV venait régulièrement jouer au jeu de paume de la
Sphère, rue Vieille du Temple7. La construction en est donc
luxueuse : les murs et le dallage sont en pierre de taille, la haute
charpente en chêne (en berceau au Marais après 1644). L’idée que
5 À propos de l’emblème humaniste, voir Anne-Elisabeth SPICA,
Symbolique humaniste et emblématique. L’évolution et les genres (1580-
1700), Paris, Champion, 1996.
6 À propos des jeux de paume, voir en particulier : Jeu des rois, roi des
jeux. Le jeu de paume en France, catalogue de l’exposition, Musée et
domaines nationaux du château de Fontainebleau, 3 octobre 2001-7
janvier 2002, Paris, RMN, 2001.
7 Le jeu de paume de la Sphère était situé à l’emplacement de l’actuel
n° 76 de la rue Vieille du Temple. Le jeu de paume-Théâtre du Marais
était situé une centaine de mètres plus au nord, dans la même rue, sur le
même trottoir, à l’emplacement du n° 90 actuel. Avant de s’installer au
jeu de paume des Maretz, la troupe de Le Noir a loué le jeu de paume de
la Sphère, à partir du 15 décembre 1631, pour trois mois (voir Alan
HOWE, Le Théâtre professionnel à Paris. op. cit., p. 112).

ANNE SURGERS ET FABIEN CAVAILLE
96
les scènes baroques en France étaient exiguës est infirmée par les
mesures connues pour les jeux de paume, vastes rectangles de
vingt-cinq à trente cinq mètres de long par douze à quinze de large.
Illustration 1. À gauche, un jeu de paume à Paris (1622). À droite,
photographie d’une maquette du jeu de paume du Marais (1644) : la salle
vue du théâtre. © Maquette A. Surgers & F. Cavaillé – 2007.
Le Marais était particulièrement vaste, puisque les mesures qui
nous sont parvenues indiquent 17 toises 4 pieds de longueur
(environ 35 mètres), 6 toises de large (environ 11,70 mètres)8 et
environ 10 mètres de hauteur sous plafond. Ces mesures
correspondent à celles des grandes salles palatiales, utilisées pour
8 Indication donnée in Elie COTTIER, Le Comédien auvergnat Montdory,
Clermont-Ferrand, Imprimeries Mont-Louis, 1937, p. 129, et confirmée
par le contrat de 1644.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
1
/
32
100%