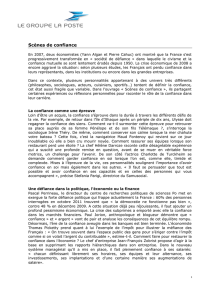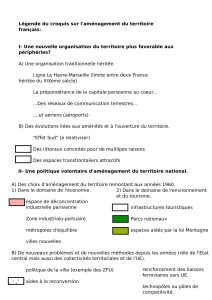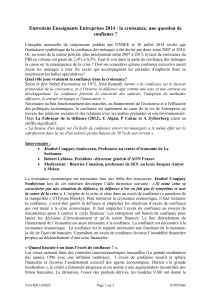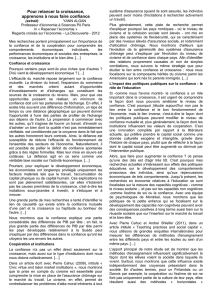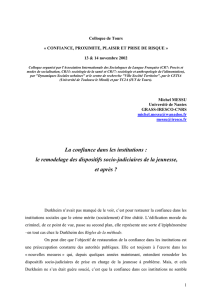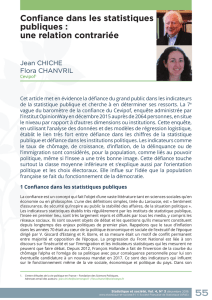Peut-on construire une société de confiance en France

Peut-on construire une société de confiance en France ?
Yann Algan (Science Po, CEPR, CEPREMAP, OFCE)
Pierre Cahuc (Ecole Polytechnique, CEPREMAP, CREST)
En France, la défiance règne. Les Français se défient beaucoup plus de leurs concitoyens que dans la
plupart des autres pays développés. Ils se défient également souvent plus souvent de la justice, du
parlement, des syndicats, de la concurrence et du marché. Ce constat, dressé dans notre ouvrage, La
Société de défiance, a suscité de nombreux débats. Notre analyse des conséquences et des causes de la société
de défiance a également rencontré un certain écho.
Selon notre analyse, la défiance des Français n’est pas une tare culturelle. Le fait que les Français
soient beaucoup plus nombreux que les habitants des autres pays développés à penser qu’il faille
contourner les règles pour réussir révèle un véritable dysfonctionnement de nos institutions et de notre
modèle social qui était supposé assurer la solidarité et la coopération entre les citoyens. Nous avons
souligné l’importance de deux caractéristiques bien identifiées de notre modèle social susceptible
d’entraver la confiance : le corporatisme et la centralisation hiérarchique des décisions par l’Etat. Notre
modèle social, basé sur un fonctionnement corporatiste qui octroie les droits sociaux en fonction du statut
et de la profession de chacun, segmente la société en institutionnalisant les différences entre citoyens, et
opacifie les relations sociales. La centralisation hiérarchique des décisions par l’Etat vide le dialogue social
et la démocratie politique de tout contenu en régulant de façon verticale l’ensemble des domaines de la
société civile. Au contraire les pays nordiques ont développé un modèle de redistribution égalitaire et
universaliste, et des corps intermédiaires pour la démocratie sociale et politique, qui sont favorables à la
coopération entre citoyens et à la confiance dans les institutions.
Notre constat, loin de suggérer que la Sécurité sociale en soi désolidarise, souligne que c’est son
mode de fonctionnement à la Française qui peut conduire à une telle défiance. La Sécurite sociale des pays
scandinaves, fondée sur des règles transparentes, égalitaires et universalistes, explique une grande partie de
la confiance mutuelle des citoyens de ces pays. De même les pays nordiques ont développé une véritable
démocratie sociale et politique. C’est donc par manque et non par excès de sécurité sociale égalitaire et de
démocratie sociale que la France souffre. Nous profitons de la parution de cet ouvrage collectif pour
compléter cette analyse à l’aune des différents débats qu’elle a nourri.

La société de défiance : Le constat
Le constat d’une Société de défiance en France est bien établi grâce aux d’enquêtes internationales qui
existent depuis le début des années 1980. Ce diagnostique a largement été étayé dans la littérature
internationale dont nous détaillons certains travaux ici. L’enquête la plus représentative, le World Values
Survey, couvre des échantillons représentatifs de milliers d’individus dans chaque pays au cours de cinq
vagues d’enquêtes en 1981, 1990, 1995, 1999 et 2008. Cette enquête mesure la confiance à l’égard d’autrui
avec la question suivante : « D’une manière générale, diriez-vous qu’on peut faire confiance à la plupart
des gens ou qu’on n’est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres ?”.
A partir de l’analyse de ces enquêtes, Ronald Inglehart, politologue à l’université du Michigan, directeur du
World Values Survey, constate dans La transition culturelle dans les sociétés industrielles avancées (1993), que : "Les
Français et les Italiens se retrouvent avec une étonnante régularité, au bas de l'échelle en ce qui concerne
un syndrome d'attitudes, appelé librement, culture civique. Parmi les pays pour lesquels nous avons des
données de 1973 à nos jours, la France et l'Italie accusent les plus bas niveaux de satisfaction à l'égard de la
vie, du bonheur, de la satisfaction politique et de la confiance." Ce constat a aussi été largement étayé par
des par les chercheurs spécialisés sur les valeurs des Français et Européennes ; à l’instar de Pierre
Bréchon1 et Pierre Bréchon et Jean-François Tchernia2. Plus récemment Olivier Galland3 a confirmé ces
résultats avec les dernières données de l’enquête en 2008 dans un ouvrage collectif consacré aux valeurs
des Français. Cet auteur montre que seul un quart des Français déclare pouvoir faire spontanément
confiance aux autres, chiffre très faible par rapport aux autres pays. Olivier Galland analyse des
dimensions complémentaires de la confiance. Une première question demande de se positionner sur
échelle de 1 à 10 à la question suivante : « les gens s’occupent surtout d’eux-mêmes » (1) ou « les gens
essaient de rendre service » (10). La note moyenne est de 4,92. Les Français ont donc plutôt tendance à
penser que l’égoïsme règle les relations entre les individus : 42% des Français se situent sur les positions
allant de 1 à 4 sur cette échelle, donc proches de la position « les gens s’occupent surtout d’eux-mêmes ».
Sur le même thème, 31% des Français sont « tout à fait d’accord » et 35% sont « plutôt d’accord » avec la
phrase suivante : « chacun doit s’occuper de ses affaires sans trop s’intéresser à ce que disent ou font les
autres ». Ces résultats conduisent Olivier Galland à conclure : «Non seulement les Français sont nombreux
à ne rien attendre des autres, mais ils adoptent eux-mêmes cette philosophie individualiste pour leur
conduite personnelle. Ce comportement semble d’ailleurs logique : si l’on suppose que les autres sont
1 Pierre Bréchon « Confiance à autrui et sociabilité : analyse européenne comparative », Revue Internationale et Politique
comparative, vol. 10, 2003
2 Pierre Bréchon et Jean-François Tchernia, 2002, « Les valeurs des Européens. Les tendances de long terme », Futuribles, n° 277,
juillet-août 2002
3 Olivier Galland « La confiance dans les autres», dans « Les Valeurs des Français », éditeur Pierre Bréchon, Presses Universitaires
de France 2008.

indifférents à votre égard, pourquoi devrait-on tenir compte de leurs opinions ou de leurs actions dans la
conduite de sa vie personnelle ? La défiance par indifférence réciproque s’entretient ainsi elle-même ».
Ce constat est également validé par des enquêtes internationales qui utilisent des formulations différentes
pour la question de confiance à autrui. Une ambiguïté potentielle de la question traditionnelle du World
Values Survey est d’être dichotomique et trop polarisée. L’enquête European Social Survey propose une
échelle de réponses plus large à la question concernant la confiance. Les réponses possibles peuvent
s’étaler de 1, pour la réponse « On est jamais assez prudent », à 10 pour « On peut faire confiance à la
plupart des gens ». L’enquête est menée tous les deux ans depuis 2002 et couvre la plupart des pays
européens. La confiance moyenne reportée en France est relativement basse et stable, atteignant 4,44 pour
la vague 2008-2009. La majorité des Français sont donc plutôt d’accord avec le fait qu’on ne peut pas faire
spontanément confiance à autrui. Pour la vague 2008-2009, la France se classe au 12ème rang parmi les 17
pays recensés. Mais l’ensemble des pays où le niveau de confiance déclaré est plus faible que celui de la
France est constitué, à l’exception du Portugal, de pays d’Europe de l’Est, dont l’histoire récente en termes
de crises économiques sociales et politiques les classe sans doute à part. Enfin les enquêtes internationales
montrent régulièrement que cette faible confiance à l’égard d’autrui s’accompagne également d’une plus
grande défiance vis-vis institutions, mêmes régaliennes, et des entreprises.
Qu’est ce que la confiance ?
Notre livre a suscité certaines interrogations sur la contrepartie réelle des questionnaires
internationaux que nous avons reportés. Les comparaisons internationales sur la confiance à l’égard
d’autrui sont basées sur des enquêtes d’opinion déclaratives. Dans quelles mesures ces déclarations
traduisent-elles des comportements réels de coopération? Et quels sont les déterminants de la confiance à
l’égard d’autrui mesurés par ces enquêtes ?
La recherche internationale a récemment proposé de nouveaux protocoles expérimentaux pour
mesurer les comportements de coopération associés aux réponses aux enquêtes de confiance. Le résultat
principal, comme nous allons le montrer ci-dessous, est que les personnes qui déclarent pouvoir faire
confiance à autrui ont aussi des comportements coopératifs réels, en montrant soit une plus grande
confiance, soit d’avantage de réciprocité, dans leurs échanges avec les autres.
Le point de départ de ces travaux est de partir d’une interprétation comportementale de la
confiance. A la suite de la définition proposée par Coleman (1990)4, un individu sera considéré comme
confiant s’il met des ressources à disposition d’une autre partie, en l’absence de contrat formel, en espérant
en retirer des bénéfices. La confiance définie de cette façon peut-être mesurée par des protocoles
4 Coleman, J., 1990, Foundations of Social Theory. Harvard University Press.

expérimentaux simples développés au cours des dernières années par les sciences comportementales et
économique. Ces protocoles reposent sur des jeux d’interactions entre individus qui reproduisent
directement, dans le cadre d’expériences contrôlées, des situations réelles d’échanges économiques,
d’investissement ou de coopération pour financer des biens publics. La conclusion de ces études est que
les questions de confiance reflètent bien soit des actes de confiance, soit des actes de réciprocité. A
l’inverse la défiance exprimée dans ces questions est associé à des sentiments de crainte d’être trahi et
injustement traité.
A titre illustratif, nous décrivons l’expérience du jeu de confiance, qui mesure le degré de
confiance et de réciprocité dans un investissement entre deux individus. Le premier joueur (l’envoyeur) est
doté d’une somme d’argent. Il peut décider d’investir dans une relation avec l’autre joueur (le receveur) en
lui envoyant tout ou partie de la somme. La somme envoyée est doublée ou triplée par un arbitre qui
remet la somme totale au receveur. Le receveur peut alors décider de renvoyer tout ou partie de la somme,
ou de tout garder pour soi. Le comportement de confiance peut se mesurer par la somme envoyée
initialement par l’envoyeur. Le comportement de réciprocité peut se mesurer par la partie de la somme
renvoyée par le receveur. Ces protocoles expérimentaux sont devenus l’alpha et l’omega des différentes
sciences comportementales, et ont été testés dans une large variété de situations, des étudiants de Harvard
jusqu’aux tribus d’Amazonie, en passant par les plateformes de commerce en ligne.
Les chercheurs de Harvard Glaeser et al. (2000)5 ont mesuré la relation entre les questions de
confiance posées dans les enquêtes, et les comportements de coopération dans le jeu de confiance. Cette
étude a été menée en posant la question de confiance à 274 étudiants d’Harvard, puis en les plaçant dans le
rôle de l’envoyeur ou du receveur dans un jeu de confiance. Les auteurs montrent que la confiance
déclarée est corrélée avant tout avec le comportement de réciprocité du receveur, mais pas nécessairement
avec la confiance de l’envoyeur. Autrement dit, cette question mesurerait bien un comportement
coopératif selon les auteurs, mais qui relève plus d’actes de réciprocité que d’actes de confiance. Les
chercheurs Ermish et al. (2007)6 trouvent des résultats similaires sur un panel plus représentatif de
ménages britanniques, à qui il est demandé non seulement de répondre à la question de confiance à l’égard
d’autrui mais également de jouer à une variante du jeu de confiance. Karlan (2003)7 confirme ce résultat en
étudiant le pouvoir prédictif des questions de confiance sur le comportement réel de villageois du Pérou
dans le recouvrement de leurs emprunts. Les villageois qui déclarent faire confiance à autrui remboursent
beaucoup plus fréquemment leurs emprunts et ont un comportement de réciprocité plus fréquent dans les
jeux de confiance. D’autres études confirment la relation entre les enquêtes d’opinion sur la confiance et
un comportement de coopération, mais d’avantage liée à l’acte de confiance lui-même. C’est le cas de
5 Glaeser, Laibson, Sheickman et Soutter, 2000, “Measuring Trust”, The Quarterly Journal of Economics.
6 Ermish, J., Gambetta, D., Laurie, H., Siedler, T. et Uhrig, N., 2007, “Measuring People’s Trust”, ISER working paper.
7 Karlan, D., 2005, “Using Experimental Economics to Measure Social Capital and Predict Financial Decisions”, American
Economic Review.

l’étude sur un échantillon représentatif des ménages allemands menée en par Fehr et al. (2003)
8. Ces
auteurs trouvent que la question de confiance prédit bien l’investissement initial et donc la confiance de
l’envoyeur dans le jeu de confiance, mais moins la somme renvoyée, c'est-à-dire le comportement de
réciprocité. Sapienza, Toldra et Zingales (2007)9 trouvent le même type de résultat sur un échantillon
d’étudiants avec des cursus beaucoup plus hétérogènes que le seul groupe d’étudiants en économie
étudiés par Glaeser et al. Sapienza, Toldra et Zingales concluent que la question de confiance mesure
véritablement un comportement de confiance lorsque l’on s’intéresse à des interactions entre individus
plus hétérogènes, représentatifs de la population, et qui ne se connaissent pas entre eux. C’est le cas de
leur étude ou de celle de Fehr et al. basée sur un échantillon représentatif des ménages allemands. Dans ce
cas, c’est en effet vraiment la confiance spontanée à l’égard d’inconnus qui est en jeu.
Ces protocoles de recherche semblent donc confirmer que les questions sur la confiance
traduisent bien des comportements. Mais encore faut-il que les actes de confiance et de réciprocité dans
ce type de protocoles soient vraiment influencés par des préférences pro-sociales. Et si les questions de
confiance et les comportements dans les jeux de confiance n’étaient qu’une variante de l’attitude face aux
risques ?
Une autre possibilité est que la question sur la confiance, ou le jeu de confiance, mesure
simplement l’aversion au risque : la défiance envers les autres pourrait être la conséquence d’une aversion
à l’égard du risque plus marquée, et non refléter les croyances envers les comportements d’autrui. La
recherche récente invalide cette interprétation à partir d’un champ très varié d’études. L’une des plus
convaincantes nous vient de la neurobiologie. Il est connu depuis bien longtemps que l’ocytocine,
hormone sécrétée notamment lors de l’allaitement et de l’accouchement, est associée aux sentiments
d’affinité et de socialisation. En particulier, les recherches en neurobiologie ont montré que cette hormone
joue un rôle central dans les comportements d’attachement social, tels que les relations parentales, les
relations d’accouplement. Cette hormone diminue aussi de façon significative le stress et l’angoisse dans
des situations d’interactions sociales. L’ocytocine est connue pour désactiver la transmission du sentiment
d’angoisse lié à la crainte d’être trahi. Les chercheurs Kosfeld et al. (2005) 10 ont eu l’ingénieuse idée
d’évaluer l’effet de l’ocytocine sur les comportements pro-sociaux des individus participant à des jeux de
confiance. Les auteurs proposent également des protocoles expérimentaux additionnels pour distinguer les
préférences pro-sociales des comportements de prise de risque et des croyances telles que l’optimisme des
participants. Les participants à cette recherche étaient répartis de façon aléatoire en deux groupes. Le
premier groupe inhalait de l’ocytocine sous forme de spray, le second inhalait un placebo et servait de
groupe de contrôle. Le résultat de cette expérience est très instructif. Les individus recevant de l’ocytocine
8 Fehr, Fischbacher, Schupp, Von Rosenbladt et Wagner, “A Nation Wide Laboratory. Examining Trust and Trustworthiness by
integrating behavioral experiments into representative surveys”, CESifo working paper.
9 Sapienza, P., Toldra, A., et Zingales, L., 2007, “Understanding Trust’’, NBER Working Paper.
10 Kosfeld, M., M. Heinrichs, P. J. Zak, U. Fischbacher, et Fehr, E., 2005, “Oxytocin Increases Trust in Humans’’, Nature, 435,
673-676.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
1
/
25
100%